30/07/2014
Leur misère donnait à toutes une grâce florentine
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« J’ai vu la tribune aux harangues. Je me suis trouvé incapable d’y ressusciter Démosthène. Le contact des objets et la vue de ce petit canton hellénique, loin de servir mon imagination, la gênent, la désorientent. L’hellénisme, pour nous autres bacheliers, c’est un Olympe, un ciel, le pays des abstractions académiques. Nul moyen de camper, sous ce beau ciel, mon Démosthène des classes, qui était un type vague, un pâle esclave des professeurs. Au contraire, sans nul effort et presque malgré moi, je vois sur cette pierre, à la fois fat et généreux, Alphonse de Lamartine, tel qu’il s’y complut un soir d’août 1832, à comparer le sort de l’orateur avec le sort du poète. Il se promettait de réunir leurs deux destinées : "Hélas ! disait-il, les hommes, jaloux de toute prééminence, n’accordent jamais deux puissances à une même tête." Avidité d’une âme ardente à la vie ! Sur le tard, Lamartine paya cette vaine gloire de sa jeunesse. "Pourquoi ai-je réveillé l’écho qui dormait si bien dans les bois paternels ? Il me poursuit maintenant que je voudrais dormir à mon tour." On apprécie toutes les nuances d’une telle vie, et l’on aime Lamartine ; mais ses malheurs font à Démosthène une draperie de théâtre, aussi belle qu’indifférente.
Dans cette saisonoù les cerisiers en fleurs atténuent les rocailles, j'ai tenté quelques courtes promenades. J'aurai voulu retrouver à Karetea cette cabane d'Albanais où M. de Chateaubriand crut mourir de la fièvre ; dans son délire, il chantait la chanson d'Henri IV, il regrettait son ouvrage interrompu et Mme de N..., tandis qu'une jeune indifférente, de dix-sept ans et pieds nus, vaquait à ses travaux dans la pièce.
Je me suis promené sous les oliviers peu nombreux de Colone. Depuis longtemps, je m’étais promis d’y murmurer comme une formule magique le couplet de Sophocle : "Étranger, te voici dans une contrée célèbre par ses chevaux et le meilleur séjour qui soit sur la terre, c’est le sol du blanc Colone. Les rossignols font entendre leurs plaintes mélodieuses dans ces bois sacrés, impénétrables à la lumière ; les arbres chargés de fruits y sont respectés des orages, et dans ses fortes allégresses, Bacchus aime de promener ici le cortège de ses divines nourrices. Chaque jour, la rosée du ciel y fait fleurir le narcisse aux belles grappes et le safran doré, couronne antique des deux grandes déesses. La source du Céphise y verse à flots pressés une onde qui ne dort jamais..." La présence réelle des oliviers, des grèves où devrait couler la rivière et des pures montagnes d’Athènes, n’ajoutait rien à la force de Sophocle, mais plutôt me communiquait la tristesse d’une déception.
On me conseilla d’aller voir les danses qui, chaque année, le jour de Pâques, se déroulent en feston sur la colline aride de Mégare. Elles commémorent, dit-on, les exploits de Thésée et cherchent à figurer les replis du Minotaure.
À une heure et demie d’Athènes (par le chemin de fer de Corinthe), en face de l’île de Salamine, la misérable Mégare, d’aspect tout oriental, resserre six mille âmes dans des maisons blanches pareilles à des cubes de plâtre. Nous nous assîmes au café, sur l’antique Agora. Quel ennui de décrire ce rassemblement ! Le député portant beau, fumant et riant, distribuait des poignées de main à des hommes en fustanelle. Des vendeurs ambulans criaient et offraient des pistaches ou de la menthe. Des petites filles en costumes locaux s’approchèrent de nos tables. Plusieurs avaient de beaux yeux ; leur misère donnait à toutes une grâce florentine. Elles nous regardaient sans bouger. Au moindre geste, fût-ce si nous prenions nos verres, elles tressaillaient, tortillaient leurs doigts, cachaient leurs cheveux. Vous aurez idée de cette délicatesse par les oiseaux de nos jardins publics qui s’apprivoisent si l’on ne bouge pas. Aucune ne mendiait ; elles prirent seulement quelques pastilles de menthe avec des petits doigts si durs que je crus sentir dans le creux de ma main les coups de bec d’une poule.
La fête commença. Toutes les femmes de Mégare, jeunes ou vieilles, formaient d’étranges lignes de danse, de marche, plutôt, conduites par un musicien. Sous le vaste soleil, les couleurs franches de leurs costumes traditionnels donnaient à l’œil un plaisir net. Ni les tons, ni les gestes ne se brouillaient. Ces femmes faisaient trois pas en avant, deux pas en arrière, soutenues par ces lentes mélopées que nous appelons orientales. En vain attendait-on, il n’y avait à voir que ce remuement de leurs pieds et puis certaines manières incessamment variées d’enlacer leurs mains, cependant qu’un public mal discipliné encombrait tout le terrain.
Cette danse a quelque chose de religieux, de simple et de grave. On la nomme, je crois, tratta. Il est difficile de dégager l’impression qu’elle communique. Est-ce un néant d’intérêt ? ou bien notre goût, émoussé comme celui des lecteurs de romans forcenés, ne sait-il plus apprécier des effets délicats ?
Des jeunes filles anglaises mangeaient des sandwichs trop gros pour leur appétit et semblaient n’être venues que pour faire le bonheur des chiens de Mégare.
Les évolutions lentes et cadencées se succédèrent indéfiniment.Je me suis renseigné à l’École française d’Athènes. "Danses albanaises, m’a-t-on répondu. Mais un Athénien fort érudit m’affirme qu’elles appartiennent à la meilleure tradition grecque. »
Maurice Barrès, Un voyage à Sparte
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



















































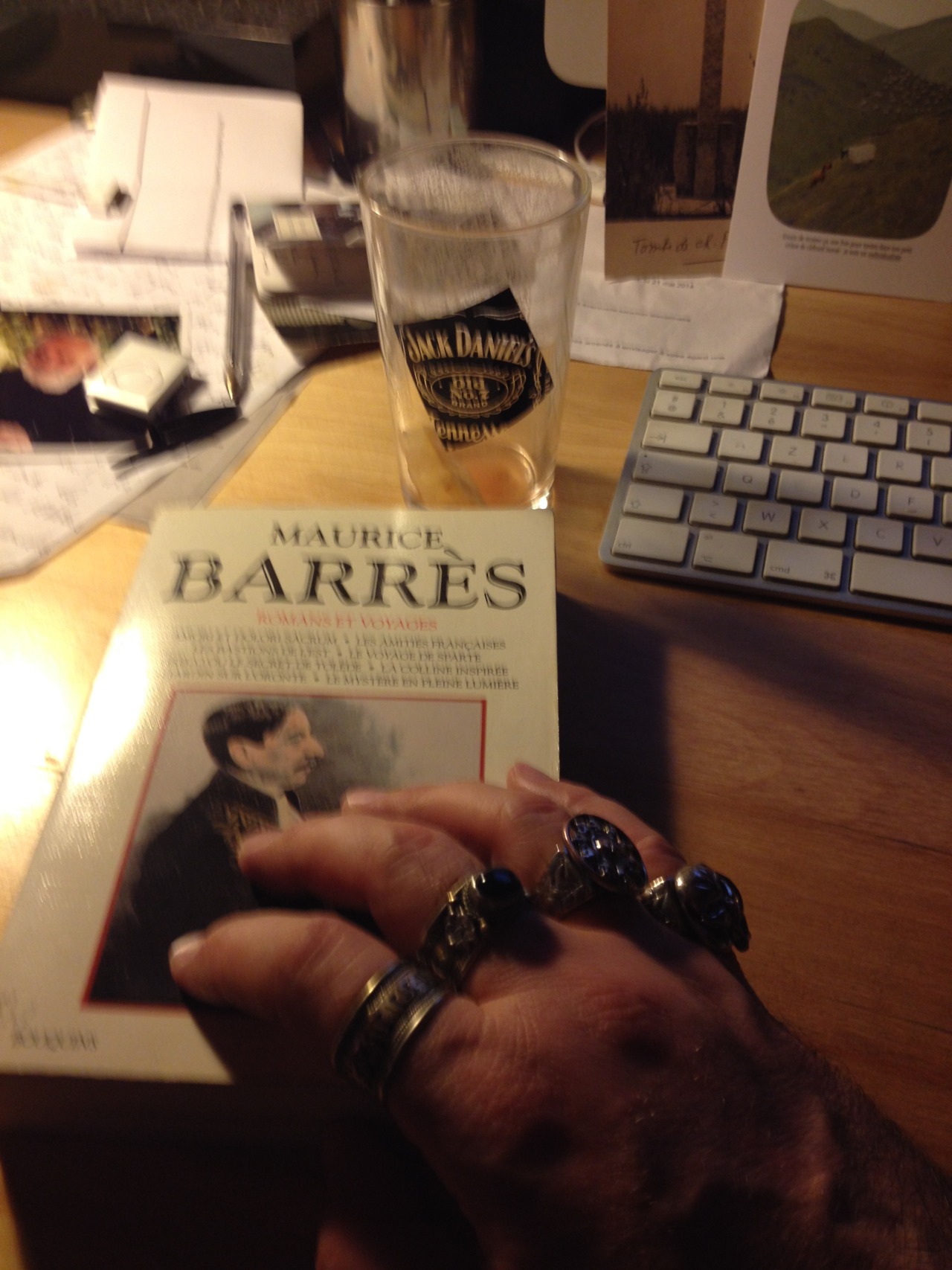
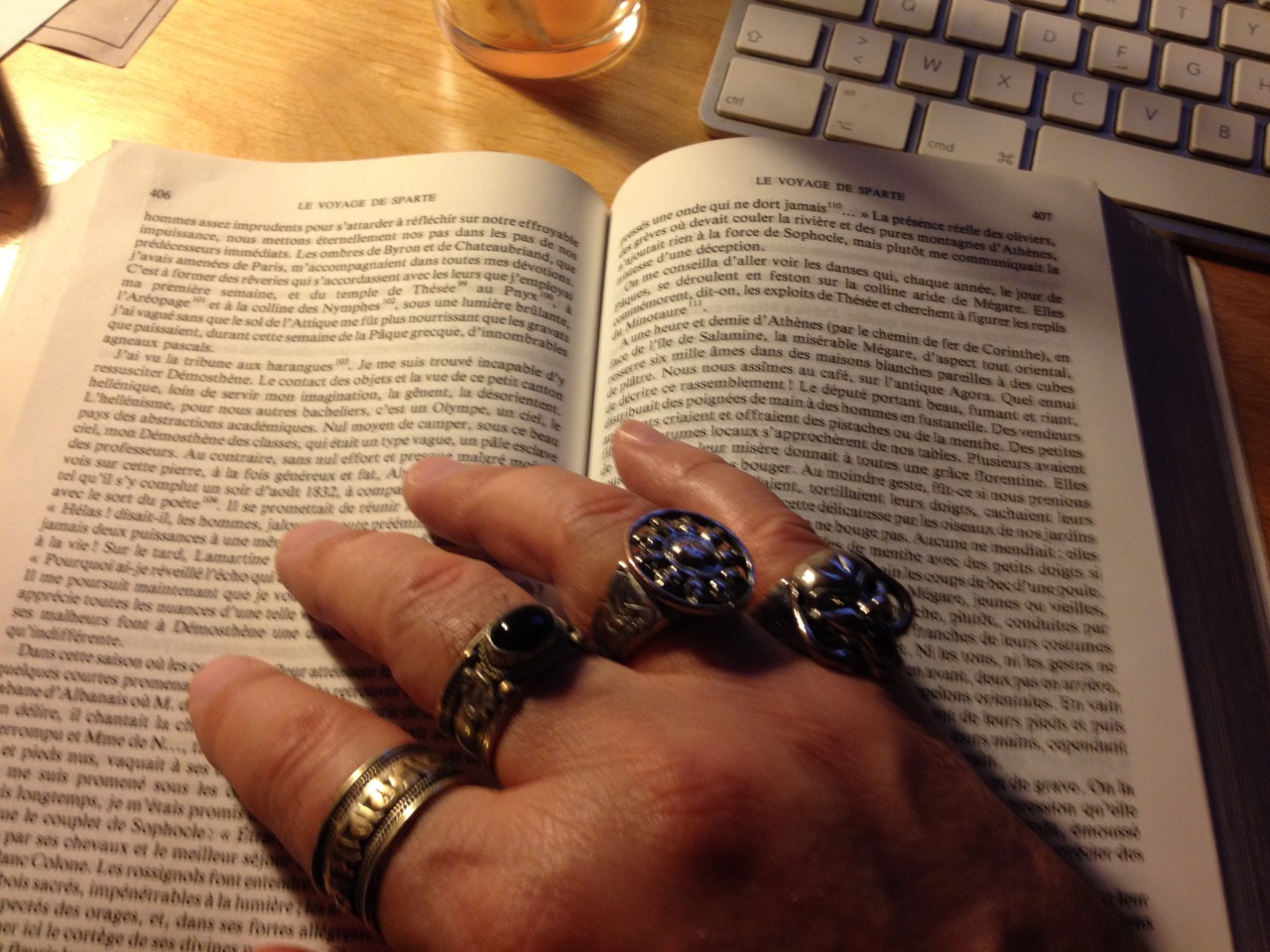
Les commentaires sont fermés.