14/05/2015
L’avilissement des cœurs...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le monde va finir. La seule raison, pour laquelle il pourrait durer, c’est qu’il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci : Qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? — Car, en supposant qu’il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du Dictionnaire historique? Je ne dis pas que le monde sera réduit aux expédients et au désordre bouffon des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l’état sauvage, et que nous irons, à travers les ruines herbues de notre civilisation, chercher notre pâture, un fusil à la main. Non; car ces aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges. Nouvel exemple et nouvelles victimes des inexorables lois morales, nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien, parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes, ne pourra être comparé à ses résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. De la religion, je crois inutile d’en parler et d’en chercher les restes, puisque se donner la peine de nier Dieu est le seul scandale, en pareilles matières. La propriété avait disparu virtuellement avec la suppression du droit d’aînesse ; mais le temps viendra où l’humanité, comme un ogre vengeur, arrachera leur dernier morceau à ceux qui croient avoir hérité légitimement des révolutions. Encore, là ne serait pas le mal suprême.
L’imagination humaine peut concevoir, sans trop de peine, des républiques ou autres États communautaires, dignes de quelque gloire, s’ils sont dirigés par des hommes sacrés, par de certains aristocrates. Mais ce n’est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle, ou le progrès universel ; car peu m’importe le nom. Ce sera par l’avilissement des cœurs. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l’animalité générale, et que les gouvernants seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d’ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie ? — Alors, le fils fuira la famille, non pas à dix-huit ans, mais à douze, émancipé par sa précocité gloutonne ; il la fuira, non pas pour chercher des aventures héroïques, non pas pour délivrer une beauté prisonnière dans une tour, non pas pour immortaliser un galetas par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour s’enrichir, et pour faire concurrence à son infâme papa, fondateur et actionnaire d’un journal qui répandra les lumières et qui ferait considérer le Siècle d’alors comme un suppôt de la superstition. — Alors, les errantes, les déclassées, celles qui ont eu quelques amants et qu’on appelle parfois des Anges, en raison et en remerciement de l’étourderie qui brille, lumière de hasard, dans leur existence logique comme le mal, — alors celles-là, dis-je, ne seront plus qu’impitoyable sagesse, sagesse qui condamnera tout, fors l’argent, tout, même les erreurs des sens! Alors, ce qui ressemblera à la vertu, que dis-je, tout ce qui ne sera pas l’ardeur vers Plutus sera réputé un immense ridicule. La justice, si, à cette époque fortunée, il peut encore exister une justice, fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune. Ton épouse, ô Bourgeois! ta chaste moitié, dont la légitimité fait pour toi la poésie, introduisant désormais dans la légalité une infamie irréprochable, gardienne vigilante et amoureuse de ton coffre-fort, ne sera plus que l’idéal parfait de la femme entretenue. Ta fille, avec une nubilité enfantine, rêvera, dans son berceau, qu’elle se vend un million, et toi-même, ô Bourgeois, — moins poète encore que tu n’es aujourd’hui, — tu n’y trouveras rien à redire ; tu ne regretteras rien. Car il y a des choses, dans l’homme, qui se fortifient et prospèrent à mesure que d’autres se délicatisent et s’amoindrissent; et, grâce au progrès de ces temps, il ne te restera de tes entrailles que des viscères! — Ces temps sont peut-être bien proches ; qui sait même s’ils ne sont pas venus, et si l’épaississement de notre nature n’est pas le seul obstacle qui nous empêche d’apprécier le milieu dans lequel nous respirons ?
Quant à moi, qui sens quelquefois en moi le ridicule d’un prophète, je sais que je n’y trouverai jamais la charité d’un médecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoyé par les foules, je suis comme un homme lassé dont l’œil ne voit en arrière, dans les années profondes, que désabusement et amertume, et, devant lui, qu’un orage où rien de neuf n’est contenu, ni enseignement ni douleur. Le soir où cet homme a volé à la destinée quelques heures de plaisir, bercé dans sa digestion, oublieux — autant que possible — du passé, content du présent et résigné à l’avenir, enivré de son sang-froid et de son dandysme, fier de n’être pas aussi bas que ceux qui passent, il se dit, en contemplant la fumée de son cigare : "Que m’importe où vont ces consciences ?"
Je crois que j’ai dérivé dans ce que les gens du métier appellent un hors-d’œuvre. Cependant, je laisserai ces pages, — parce que je veux dater ma colère. »
Charles Baudelaire, Fusées
00:07 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



















































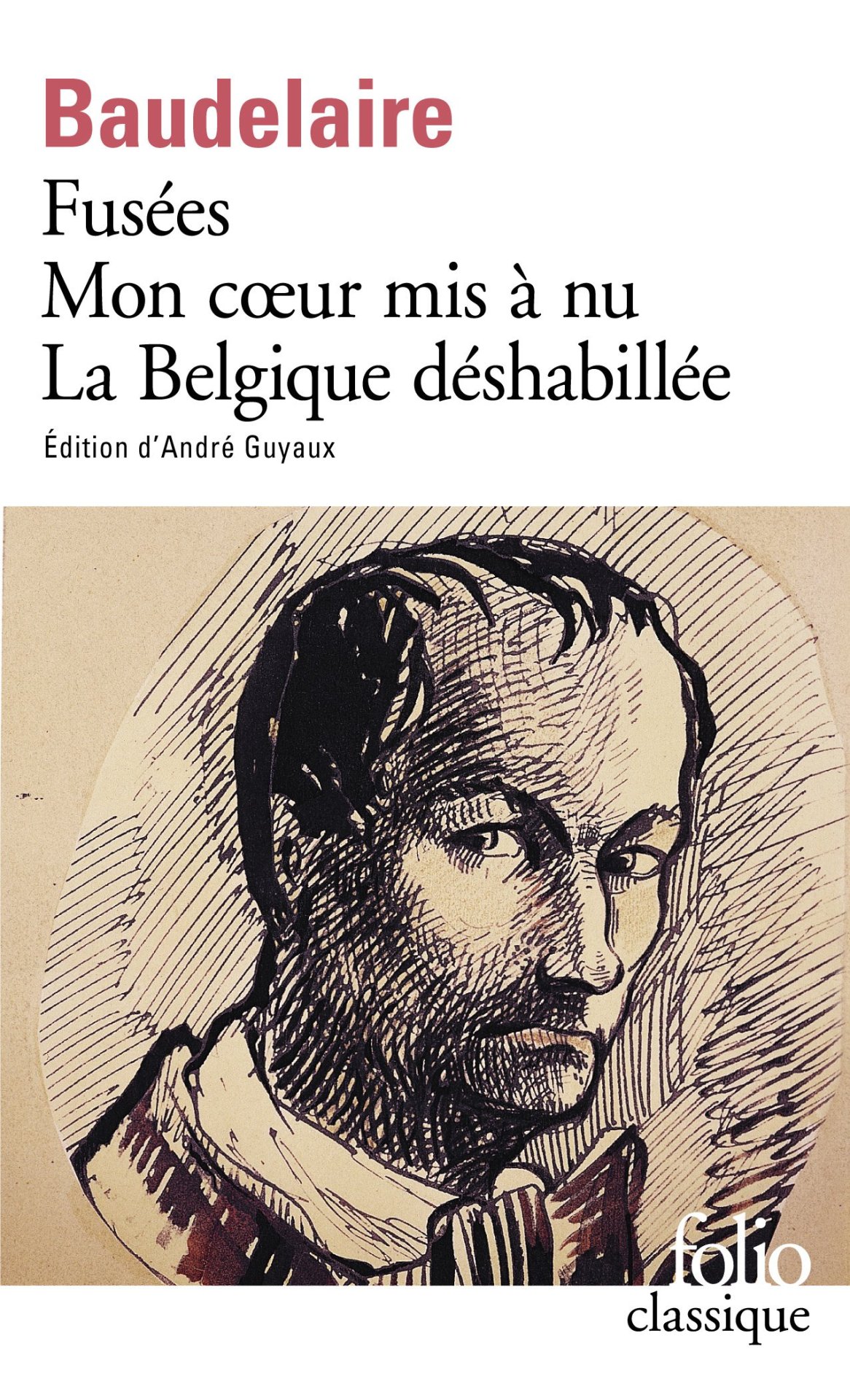

Les commentaires sont fermés.