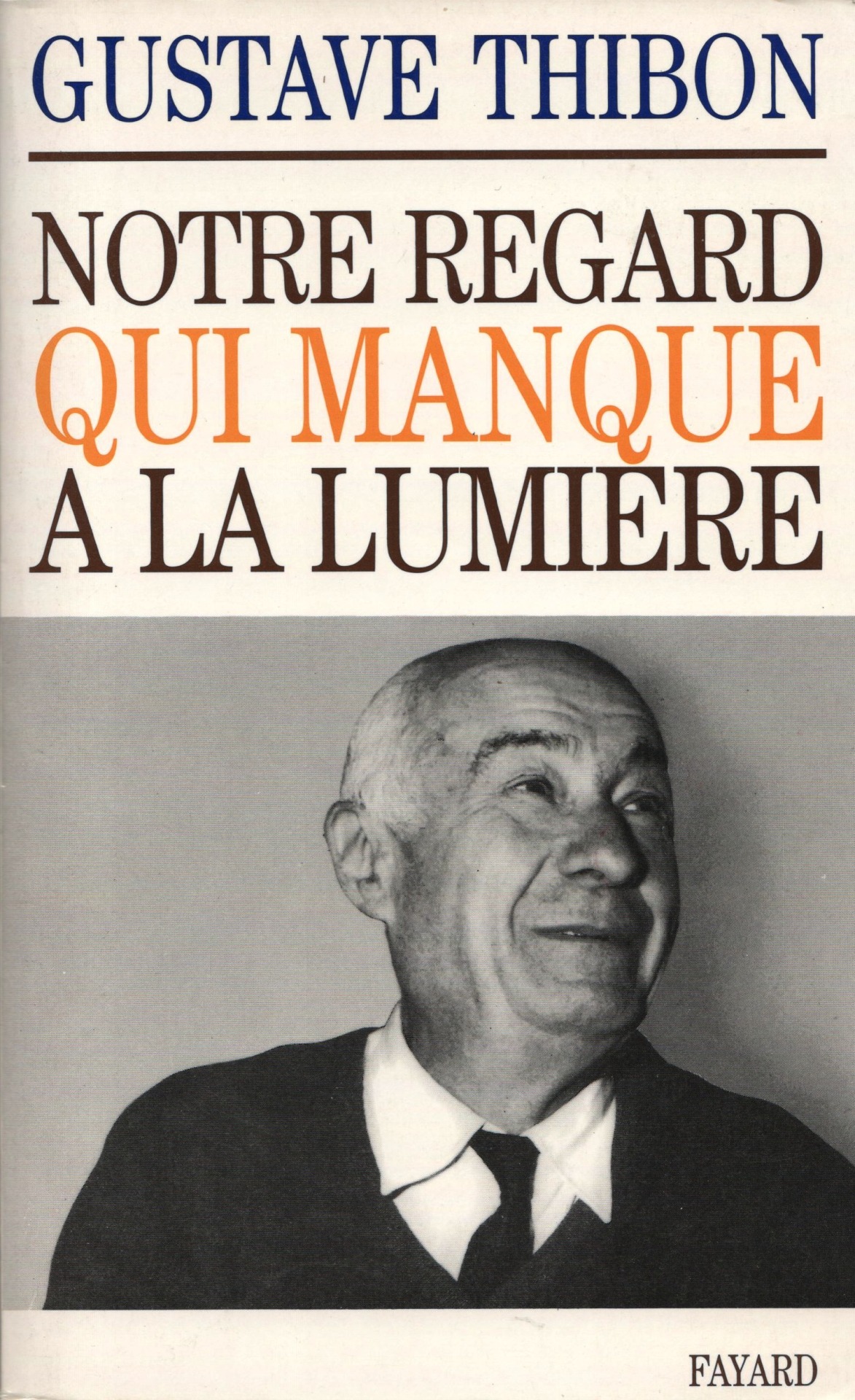23/08/2015
L’effacement progressif des différences et des hiérarchies
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Je me réjouissais tout à l’heure de voir l’homme assez dépouillé de lui-même pour n’avoir plus de recours qu’en Dieu. Mais je me demande à d’autres instants s’il lui reste assez de substance humaine pour que le divin puisse s’y greffer. Le viol généralisé des rythmes de la nature et de la vie, l’effacement progressif des différences et des hiérarchies, l’individu transformé en grain de sable et la société en désert ; la sagesse remplacée par l’instruction, la pensée par l’idéologie, l’information par la propagande, la gloire par la publicité, les mœurs par les modes, les principes par des recettes, les racines par des tuteurs ; l’oubli du passé stérilisant l’avenir ; la disparition de la pudeur et du sentiment du sacré ; la machine rejaillissant sur l’âme et la recréant à son image – tous ces phénomènes d’érosion spirituelle alliés à l’orgueil prométhéen de nos conquêtes matérielles ne risquent-ils pas de nous conduire jusqu’à ce degré d’épuisement dans les choses vitales et de suffisance dans l’artifice au-delà duquel la pitié de Dieu assiste, impuissante, aux déchéances de l’homme ? »
Gustave Thibon, Notre regard qui manque à la lumière
16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La philosophie est l’apprentissage de la mort. Cette perspective n’apparaît funèbre qu’à ceux qui voient les choses à l’envers.
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Comment parler aux hommes ? demandait Saint· Exupéry juste avant d’entrer dans le silence éternel. C’est le tourment de tout homme qui écrit, non pour assembler des mots ni même pour répandre des idées, mais pour partager avec ses frères une vérité et un amour plus vivants en lui que lui-même: où sont les paroles qui atteignent l’être dans sa source, comment trouver les mots qui mènent au-delà des mots ?
Et d’abord, qu’est-ce que l’homme? Une chose qui pense et qui aime èt, en même temps, qui va mourir et qui le sait. Peu importe qu’il s’évertue à l’oublier et qu’il se fasse un bandeau de toutes les apparences: l’oeil de l’âme ne s’aveugle pas comme l’oeil du corps, et il le sait tout de même. C’est son unique certitude, la seule promesse qui ne faillira point et le paradoxe d’une vie dont la suprême vérité est dans la mort. Nous mourrons, moi qui parle et vous qui m’écoutez – et toute parole entre nous est vaine qui n’a pas d’écho dans cette ultime enceinte de l’âme où règne déjà la mort immortelle. Seule a un sens, parmi le tapage du monde, la voix solitaire qui sait réveiller dans l’homme le Dieu endormi.
Non pas seulement le Dieu qui dort, mais le Dieu qui rêve, le Dieu qui se cherche à tâtons, parmi les ombres qui l’aveuglent et les fausses lumières qui l’éblouissent.
Quoi qu’il fasse et quoi qu’il désire, qu’il se cramponne au passé ou qu’il coure vers l’avenir, qu’il se cherche ou qu’il se fuie, qu’il se durcisse ou qu’il s’abandonne, dans sa vertu comme dans son péché, dans sa sagesse comme dans sa folie, l’homme n’a qu’un voeu et qu’un but: échapper au filet du temps et de la mort, franchir ses limites, être autre chose qu’un homme. Sa vraie demeure est un au-delà, sa patrie réside en dehors de ses frontières. Mais son malheur veut – et là gît le noeud de cette perversion que nous appelons erreur, péché ou idolâtrie – que, trompé par des apparences et cherchant l’éternel au niveau de ce qui passe, il s’éloigne encore davantage de cette unité perdue, de cette perfection entrevue en songe.
Il faudrait montrer aux hommes de quelle réalité divine leur rêve est le pressentiment et le tombeau. Leur faire sentir que la faim de Dieu nourrit ce qu’ils croient être le plus étranger au divin: leurs démarches quotidiennes, leurs passions terrestres, leur matérialisme même, car la matière n’a de valeur que comme signe de l’esprit. En réalité, tout le monde cherche Dieu puisque tout le monde demande à la terre ce que la terre ne peut pas donner, tout le monde cherche Dieu puisque tout le monde cherche l’impossible. Si la lumière se fait, si le réveil se produit, tous les quiproquos du rêve s’évanouissent et chaque chose reprend sa vraie place dans la clarté retrouvée. Les idoles mêmes cessent d’être des idoles en devenant transparentes: le voile traversé par la lumière n’est plus un voile; la simplicité du regard abolit le dualisme entre le temps et l’éternité.
Si la suprême valeur de l’homme est dans le dépassement de l’humain et dans l’aspiration, formulée ou tacite, vers l’être ineffable qu’un Père de l’Eglise grecque appelle « l’Au-delà de tout », notre siècle ne m’apparaît pas indigne du baiser de l’éternité. Jamais peut-être encore l’homme ne s’était senti aussi mal à l’aise dans ses limites: comme il a désintégré les atomes, il a fait éclater en lui toutes les dimensions de l’humain; il s’est tellement vidé de son équilibre naturel et de ses assurances terrestres qu’il ne peut plus être retenu sur la pente du néant que par le contrepoids de l’absolu. C’est le grand signe de notre temps que la révélation de l’inanité des compromis, des demi-mesures, des vertus utilitaires et ornementales; le dilemme: Dieu ou rien ne se présente plus comme un thème de dissertation philosophique ou d’envolée oratoire: il a pénétré jusqu’au noeud de notre chair et de notre âme, il se pose avec l’urgence d’une manoeuvre de sauvetage à bord d’un navire en perdition.
Cette manoeuvre est si simple qu’elle défie tous les mots. Il suffit d’ouvrir les yeux jusqu’à l’âme et de se laisser pénétrer par l’évidence. Je n’apporte ici aucune recette nouvelle, aucune formule originale dans l’art du salut : pauvre en réalité de tout ce qui manque à l’homme et riche en puissance du bien infini que Dieu offre à tous, je ne m’excepte ni de la commune misère ni de la commune espérance, et je ne me sens aucun privilège pour révéler aux autres le secret qu’ils portent en eux: mon unique ambition est d’inviter ceux qui me liront à faire coïncider leur regard avec cette goutte de lumière éternelle qui est le vestige et le germe de Dieu dans l’homme. Car la mort – le seul avenir exempt de mensonge – nous attend, suivant l’altitude de nos voeux, comme une fiancée ou comme un bourreau, et rien ne subsistera, de tous les mouvements de notre âme, que notre participation à ce qui, n’étant pas engendré par le temps, ne mourra pas avec lui. Chronos ne dévore que ses propres enfants.
Ce souci du bien nu et transcendant m’a peut-être rendu parfois trop sévère pour certaines valeurs temporelles qui répondent à d’indiscutables nécessités, mais que l’idolâtrie des hommes transforme sans cesse en refuges contre l’infini. Je veux parler non seulement des innombrables conformismes moraux et sociaux, mais de toutes les vertus humaines qui ne cachent pas au fond d’elles-mêmes je ne sais quelle amertume d’exil et le germe de leur propre dépassement. Et que dire des idoles qui appartiennent spécialement à notre siècle et qui captent la sève religieuse encore plus près des racines: le conformisme du non-conformisme qui fait de la révolte un esclavage et de l’évasion une prison, le mythe du progrès et du « sens de l’histoire » qui noie l’éternité dans le flot du temps, le mythe du social qui est la négation et l’ersatz de la charité ?
Je me réjouissais tout à l’heure de voir l’homme assez dépouillé de lui-même pour n’avoir plus de recours qu’en Dieu. Mais je me demande à d’autres instants s’il lui reste encore assez de substance humaine pour que le divin puisse s’y greffer. Le viol généralisé des rythmes de la nature et de la vie, l’effacement progressif des différences et des hiérarchies, l’individu transformé en grain de sable et la société en désert; la sagesse remplacée par l’instruction, la pensée par l’idéologie, l’information par la propagande, la gloire par la publicité, les moeurs par les modes, les principes par des recettes, les racines par des tuteurs ; l’oubli du passé stérilisant l’avenir; la disparition de la pudeur et du sentiment du sacré; la machine rejaillissant sur l’âme et la recréant à son image – tous ces phénomènes d’érosion spirituelle alliés à l’orgueil prométhéen de nos conquêtes matérielles ne risquent-ils pas de nous conduire jusqu’à ce degré d’épuisement dans les choses vitales et de suffisance dans l’artifice au-delà duquel la pitié de Dieu assiste, impuissante, aux déchéances de l’homme ?
Mistral, dans un éclair prophétique, parle quelque part des "vessies qui s’enflent et des mamelles qui tarissent". Le mot dit tout. Devant ces multitudes humaines arrachées au sein maternel de la nature et qui, nourries de fumée, ont perdu jusqu’au désir des vraies nourritures, je me retourne avec une nostalgie angoissée vers la santé biologique, les vertus élémentaires, les traditions éprouvées – tout ce qui représente la vie, même sous ses formes les plus inférieures – cette vie que la grâce brise et retourne, mais dont elle a besoin comme le laboureur de la terre qu’il tourmente afin de lui confier la semence. La "dégradation du vivant en mécanique" dont parlait Bergson, nous la voyons s’accomplir sous Notre regard qui manque à la lumière 13 nos yeux avec une ampleur et une accélération qui relèvent de la mécanique plus que de la vie: elle triomphe dans l’élaboration de ce type d’humanité anonyme, fait d’imagination passive et d’intelligence désincarnée, que nous appelons l’homme des foules – ces foules au sein desquelles des individus qui ne ressemblent à rien se ressemblent tous. Chaque époque produit des oeuvres qui sont le reflet de son âme: nous en sommes au stade de la machine à penser. Ne serait-ce pas, pour les psychotechniciens et les spécialistes du "viol des foules", le prototype idéal de l’humanité future ? Or Dieu est la vie – et le vivant se greffe sur le vivant et non sur le mécanique.
Mais comment ouvrir les hommes à cette dimension divine qui, en leur donnant l’infini, les guérit de la démesure ? J’ai souvent ouï dire que les recettes de l’apologétique classique ne répondaient plus ou goût d’aujourd’hui. Faut-il en inventer de nouvelles, plus adaptées à la sensibilité contemporaine et qui soient comme des modulations du "dernier cri" de la mode ? La mode passe si vite qu’on s’essouffle en vain à la suivre. C’est de l’altitude qu’il faut prendre et non de l’avance; ce n’est pas en collant servilement à ce qui passe, mais en s’élevant vers ce qui demeure qu’on répond le plus profondément aux besoins de l’homme moderne qui, sous les oripeaux éphémères de l’actualité, restent les besoins de l’homme éternel. "Le sage, disait Nietszche, ne doit pas faire chorus avec son temps, il ne doit même pas savoir comment on fait chorus."
C’est en grattant la pierre et non en passant une nouvelle couche de peinture sur le vieil enduit qui s’écaille qu’on restaure un édifice. De même, c’est l’homme éternel qu’il faut retrouver et émouvoir dans l’homme moderne. Peu importent les formules – et les mots les plus nus sont ici les mieux entendus – pourvu qu’on l’atteigne au vif de sa blessure et de sa solitude, au point d’articulation de l’espérance et de l’impossible. – Le mot Dieu – ce mot "Notre regard qui manque à la lumière" qui ne dit plus rien parce qu’il dit tout – est comme ces signes sténographiques polyvalents qui s’éclairent par leur contexte, et le contexte ici, c’est l’expérience de la misère de l’homme. Cet homme moderne, avant de lui parler de Dieu, il faut l’amener à prendre conscience du néant et du mensonge de tout ce par quoi il essaye en vain de remplacer Dieu. Lui découvrir, suivant le mot de sainte Thérèse, que son désir est sans remède. Ce désir là doit être pris pour une réalité. Il est plus vrai que tous les objets dont il fait sa proie. Et il suffit qu’il soit reconnu comme tel pour qu’il mène à Dieu. Le diagnostic indique le remède. Dénuder la soif, c’est montrer la source.
Il serait plaisant qu’un philosophe de la transcendance refusât d’être transcendé lui-même. Mon désir est moins d’apporter un enseignement que de susciter un dialogue. Je ne suis pas un de ces "maîtres à penser" dont l’autorité, repoussant toute discussion, impose son joug et ses limites à la pensée des autres. Si j’ambitionnais une maîtrise, ce serait plutôt celle qui consiste à "faire penser". Et pas nécessairement dans le sens où je pense moi-même. Je préfère une contradiction vivante à une approbation morte. "On n’a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours disciple", disait Nietzsche avec cette suprême humilité de l’orgueil terrassé par la vérité inaccessible. Les orthodoxies privées m’inspirent autant de crainte que de pitié : elles trahissent d’abord, en congelant ce qui doit rester une source, la pensée où s’accroche leur servile fidélité. Il m’importe d’être dépassé plutôt que d’être suivi. La vraie influence ne consiste pas à modeler du dehors l’esprit d’autrui à notre image, mais à réveiller en lui l’artiste latent qui sculptera de l’intérieur une statue imprévisible à notre pensée et peut-être étrangère à nos voeux.
On sait, depuis Socrate, que la philosophie est l’apprentissage de la mort. Cette perspective n’apparaît funèbre qu’à ceux qui voient les choses à l’envers. Si la mort mûrissait dans nos âmes comme elle mûrit dans nos corps, nous irions vers elle comme la fleur s’ouvre à la lumière et la vie d’ici-bas, loin d’être assombrie par son approche, baignerait déjà dans un rayonnement transfigurateur. Car les choses du temps sont perméables à l’éternité et Dieu, qui est l’au-delà de tout, est aussi présent à tout. Je ne me lasserai jamais de citer un des mots les plus sauveurs qu’aient jamais prononcés des lèvres humaines: celui de sainte Catherine de Sienne répondant à quelqu’un qui se plaignait d’être écrasé par les tâches temporelles : "C’est nous qui les rendons temporelles, car tout procède de la bonté divine." En fait, le conflit entre la terre et le ciel n’existe qu’au niveau de notre aveuglement. Ce n’est pas la lumière qui manque à notre regard, c’est notre regard qui manque à la lumière. Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu. Et ils le verront "partout" puisqu’il est partout. Les choses du temps se présentent d’abord à nous comme une illusion et une épreuve : l’illusion dissipée, l’épreuve surmontée, elles nous révèlent leur côté éternel, leur sens divin. Le monde retrouve dans l’âme des saints l’unité sacrée de son origine : Dieu y règne, suivant le mot de l’Evangile, "sur la terre comme au ciel". Hors de cette rédemption, l’existence temporelle n’est qu’écoulement absurde et pâture de mort. C’est le sens de la phrase qui conclut et qui résume ce livre : "Tout ce qui n’est pas de l’éternité retrouvée est du temps perdu".
30 mars 1955, Saint-Marcel-d’Ardèche. »
Gustave Thibon, Avant-Propos à Notre regard qui manque à la lumière
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook