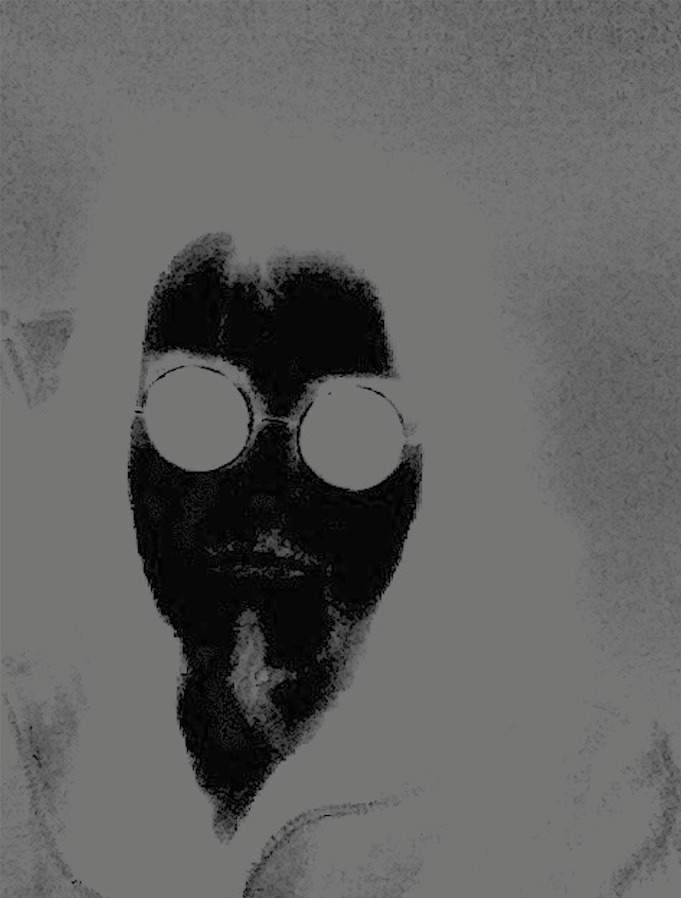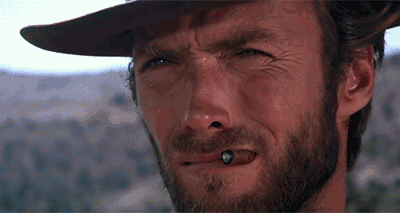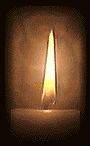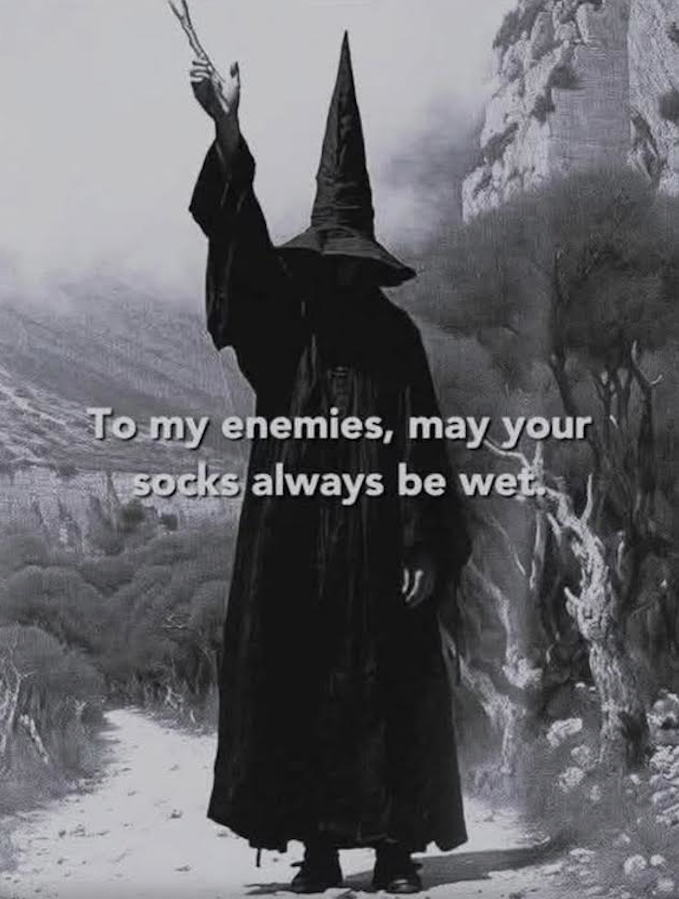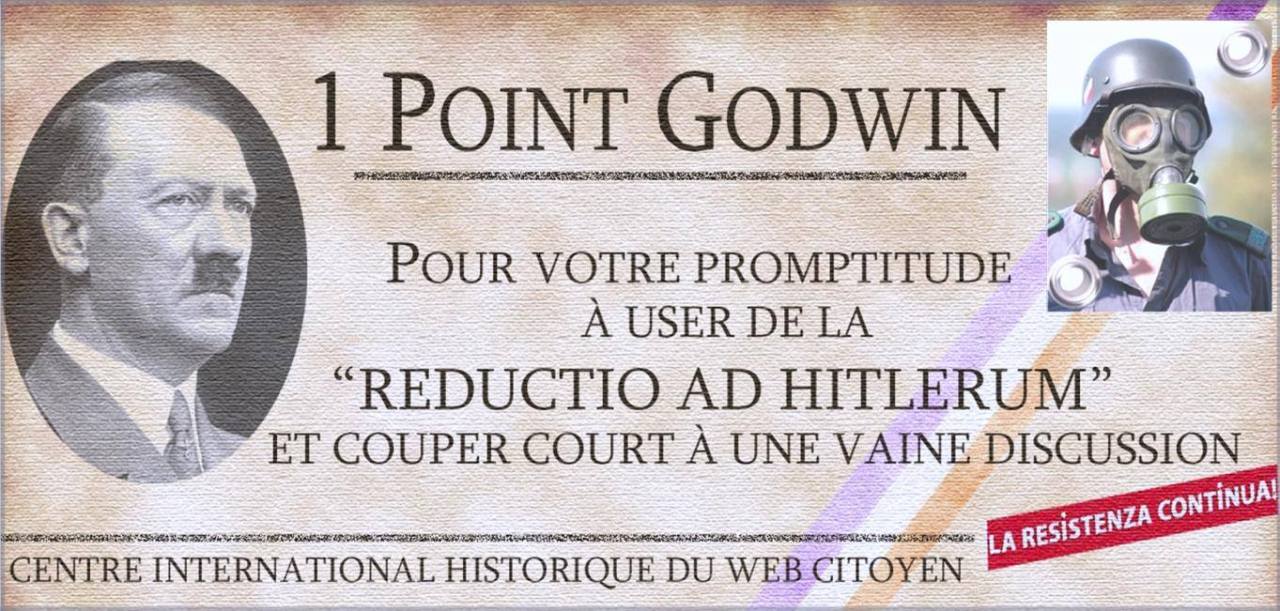13/03/2011
"L’islam face à la mort de Dieu"
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

Schizophrénie des intellectuels musulmans.
Abdennour Bidar, dans son livre "L’islam face à la mort de Dieu", cite Jean Jaurès : « Cette joie sublime d’amener tous les hommes à la plénitude de l’humanité. » Ce fut précisément l’argument principal du socialiste Jean Jaurès pour justifier la colonisation de la République Française sensée apporter les Lumières et l’émancipation aux peuples inférieurs.
Dans le même livre, Abdennour Bidar cite le philosophe musulman Mohamed Iqbal, fin connaisseur de la philosophie occidentale, poète important et initiateur de la partition pakistanaise qui allait donner naissance à ce pays, qui confessait : « Ma vie a été principalement consacrée à l’étude de la philosophie occidentale, et cette manière de penser est presque devenue chez moi une seconde nature. Je ne parviens pas à exprimer en ourdou ce qui est dans mon cœur. »
Je me demande ce qu’il penserait aujourd’hui, Mohamed Iqbal, de ce Pakistan en proie aux pires fléaux archaïques, avec ses zones tribales au sein desquels les seigneurs de guerre font la loi, appliquent la Sharia et vomissent, eux, tout ce que l’Occident a pu accoucher de lumineux. Il a rêvé, comme tout homme éclairé, d’une "individuation" possible du musulman, mais c’était sans compter sur le poids culturel et cultuel considérable qu’impose le monde islamique à sa Oumma. Car il y a une antinomie réelle entre la voie occidentale et la voie islamique quelle que soit la forme que prend cette dernière et cette antinomie est de taille. Abdennour Bidar cite d’ailleurs Carl Gustav Jung à ce sujet : « J’emploie l’expression d’individuation pour désigner le processus par lequel un individu devient un individu psychologique, c’est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. La voie de l’individuation signifie : tendre à devenir un être réellement individuel et dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière et irrévocable, il s’agit de la réalisation de son Soi dans ce qu’il a de plus personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot d’ "individuation" par "réalisation de soi-même" ou "réalisation de son Soi". » (L’énergique psychique, in Ma vie)
La tentative de tous ces intellectuels étrangers à l’univers mental occidental et qui ont goûté à ses saveurs particulières est un essai intéressant, mais au final maladroit, de dépasser leur métaphysique traditionnelle et menacée par l’entropie. Ils sont parvenus à atteindre un niveau d’abstraction essentiel pour comprendre et saisir les postulats des penseurs qui ont éclairé l’Occident puis ont essayé de se servir des outils acquis dans leur confrontation à ce monde contraire pour repenser la Voie qui était la leur. Seulement à part y insuffler des constructions nouvelles, souvent poétiques et charmeuses, je n’ai pas le sentiment qu’ils soient arrivés à leurs inavouables fins : helléniser leur psychisme et faire accéder les personnes de leurs communautés à l’individuation dont parle Jung. C’est une différence fondamentale entre l’islam et l’Occident qui n’a pas fini de provoquer les controverses que vous devinez. Je puis certes me tromper dans la mesure où je ne suis aucunement un spécialiste en un domaine qui nécessiterait un travail méticuleux de comparaison, mais avec le peu de connaissances acquises en la matière je peux arguer qu’il y a là de quoi comprendre l’écart considérable qui existe entre le monde occidental et le monde musulman, et ce malgré l’existence d’hommes d’esprit comme Abdennour Bidar ou Mohamed Iqbal, sans parler des Rûmî, Hallaj ou Khayyam qui ont illuminé un passé islamique de leur intelligence en recueillant les foudres des muftis, imams et mollahs de leurs temps.
Le simple fait qu’à l’origine de notre Culture se trouve ce postulat théologique qui stipule que l’Homme serait fait à l’image de Dieu fonde, même aujourd’hui pour les non-croyants, ce fameux principe d’individuation évoqué par Jung comme base de notre développement individuel et commun. C’est l’irruption civilisationnelle qui est la nôtre et qui invite à la Singularité, à la distinction pas seulement dans le cadre des hiérarchies sociales, mais aussi des chemins spirituels et intellectuels qui ont porté l’Occident à la place qui est la sienne dans l’Histoire de l’humanité. Ainsi lorsque Iqbal postule que l’ego humain ne serait pas parvenu au faîte de lui-même, il cherche par le biais du Soufisme à atteindre à la même conception de l’Être Humain qu’au sein de notre Civilisation qui l’a fécondé pour lui faire tirer du Coran une herméneutique dont les tenants de l’islam conventionnel ne veulent pas entendre parler. Abdennour Bidar précise : « Hallaj a été supplicié à Bagdad en 922 pour s’être écrié "Je suis la Vérité créatrice". L’interprétation d’Iqbal manifeste toute la portée de ce qui fut considéré alors comme un attentat blasphématoire contre la transcendance de Dieu. Il montre que cette parole signifie non seulement que l’homme est devenu "partie de Dieu" ou "égal de Dieu" (ce qui est déjà insupportable pour l’orthodoxie religieuse), mais que la totalité du divin s’est trouvée littéralement aspirée et infusée en l’homme. Il y a là un résultat que même les maîtres soufis de Hallaj ne pouvaient accepter, et ce sont eux d’ailleurs qui le livrèrent au châtiment des autorités… Dans sa filiation, la conception iqbalienne de l’Ego ultime représente un renversement complet de la conception soufie classique, selon laquelle le saint accompli s’est "éteint" en Dieu et agit ensuite "par Dieu" en toutes choses. Ils nomment cela fana (extinction) et baqa (subsistance en Dieu et par Dieu). Le commentateur Javed Majeed a pu écrire à cet égard qu’Iqbal "bouleverse considérablement la notion soufi de fana ("extinction de l’homme en Dieu’’) puisqu’il la renverse en extinction de Dieu en l’homme". Tandis que le soufisme considère que l’individualité de l’homme devenu saint s’éteint dans la personnalité suprême de Dieu, Iqbal ose concevoir l’inverse : c’est dieu qui disparaît en l’homme, la personnalité divine qui passe toute entière dans l’individualité de l’homme. Le saint n’a donc pas perdu son Ego, mais il en jouit désormais comme plénitude absolue d’un Soi (Khûdî) qui est la totalité de ce que la religion populaire comme la métaphysique soufie classique appellent "l’être en Dieu".
(…)
La vie spirituelle chemine ainsi dans le sens de la découverte et de l’appropriation d’un degré suprême d’individuation. »
Si demain les choses venaient à se gâter davantage dans ce pays, d’une manière ou d’une autre, et je dis dans ce pays mais, au train où vont les choses ces derniers temps je pourrais dire au sein de l’Europe, il est évident que les grands perdants du clash qui s’en viendrait seraient, à n’en pas douter, ces quelques explorateurs musulmans qui osent défricher leur culture et leur tradition avec un esprit curieux et audacieux car il y a un réveil identitaire en ce moment sur ce continent, en Grande-Bretagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne et même en France, ce pays qui a accouché avec la Révolution Française du prêt-à-penser délivré en kit dès 1789 et la terreur qui s’en est suivie. Un consensus perce tout juste la couche opaque des clivages politiques qui ont fait oublier un peu trop facilement et pendant trop longtemps aux divers militants de gauche comme de droite, et d’un extrême à l’autre, que bien qu’opposés sur la question de la manière à mettre en œuvre pour gérer les affaires de la Cité, ils étaient avant tout les habitants d’un même pays liés de façon organique pour les ressortissants de souche par des valeurs, une langue et un art de vivre et pour les immigrés, comme moi, ayant réussi leur « intégration » voire leur « assimilation » en s’enracinant respectueusement dans cette terre d’accueil et en en épousant l’Histoire, le sens et la vision. Ce consensus qui perce dit : « Ya basta ». Ça suffit. Les histoires de Bisounours nous racontant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on en a jusqu’à la nausée. Nous voulons que la France reste le pays de Montaigne et de Rimbaud, des moralistes au grand style et des bals populaires, des sacrifiés de la Commune et des cathédrales lumineuses, des libertins licencieux et des surréalistes sublimes. Et non pas Dar al islam, Frankistan balkanisé et libanisé, cohortes de « dhimmis » rasant toute leur vie des murs. Je dis que ces musulmans vraiment modérés, trop rares (car je ne souscris pas à l’idée faussement répandue que « la grande majorité des musulmans en France » serait modérée), seraient les grands perdants car je ne pense pas que la tourmente prenne des gants quand il s’agit d’agir et il n’y a rien de pire en sanglante tripaille que les troubles sociaux quand, poussés à leur paroxysme (comme c’est de plus en plus le cas aujourd’hui), ils basculent dans la guerre civile. Chaque fois que les musulmans de France ont eu l’occasion de fermement montrer leur attachement à ce pays contre leurs co-religionaires dangereux et archaïques ils se sont faits discrets voire inexistants. Ce qui, par une vue d’ensemble, me semble être plutôt un assentiment aux vociférations hystériques et névrosées des imams et muftis agitant leurs menaces et dégueulant leurs fatwas contre tout ce que l’occident a de lumineux en comparaison à leur monde qui, politiquement, culturellement et socialement, est un désert.
Abdennour Bidar fait partie de ces hommes cherchant à faire accéder sa communauté à la modernité critique tout comme Senghor rêvait, secrètement, que l’Afrique noire tout en conservant son identité s’hellénise. Paradoxe des paradoxes, le concept de « négritude » doit beaucoup à Barrès et à la Grèce antique.
Abdennour Bidar dans "L’Islam face à la mort de Dieu", par son analyse de la pensée de Mohammed Iqbal fait référence à une conception de la foi musulmane qui n’a jamais existé que dans les cœurs des esprits libres qui ont tenté, tant bien que mal, de changer radicalement la conception étriquée et sclérosée de la réception littérale du Coran. Après la lecture du Coran, on est en droit de se demander comment les soufis ont pu s’y prendre, mais lorsque l’on sait, par exemple, que le soufisme indien a été fortement influencé par d’anciens Brahmanes convertis à l’islam et qui ont su utiliser les outils acquis par la pratique de leur religion initiale pour penser leur religion nouvelle, on comprend aussitôt pourquoi les tenants du salafisme, du wahabisme et autres saloperies totalitaires estiment que ce sont là des éléments étrangers à la Sharia et que, de ce fait, le soufisme ne peut être perçu que comme une hérésie sectaire et dangereuse pour l’établissement d’un éventuel Califat sensé apporter la Paix de Dieu par la soumission aux cinq piliers révélés par le prophète Mohammed. Mais Iqbal, dit Bidar, fait référence à Rûmi en personne :
« "Comme Roumi j’ai fait l’appel à la prière dans la Ka’aba/Et j’ai appris de lui les secrets de l’âme/Il était fait pour relever le défi du temps passé/Je suis fait pour relever le défi du temps présent."
Restons quelques instants sur cette vision d’Iqbal en muezzin de La Mecque.
Cette fonction de muezzin dans le lieu le plus saint de l’islam est une allusion symbolique à celui que le soufisme désigne comme le Qouth, le sage suprême d’une époque, "Chef" ou "Pôle spirituel de son temps". Qui est-il ? Quelle sagesse détient-il ? Selon les soufis, chaque époque a sa sagesse. Il faudrait même dire que pour eux chaque instant a sa sagesse. Ils se nomment d’ailleurs eux-mêmes les "fils de l’instant". Autrement dit, la sagesse n’est pas un savoir établi, un secret déposé quelque part et qui traverserait les âges sans varier. Pourquoi n’en est-il pas ainsi ? Parce que la sagesse est la connaissance de la façon dont l’absolu se manifeste dans le relatif, dont l’infini entre dans le fini, dont l’éternité entre dans le temps. Chaque époque, chaque culture, chaque individualité, chaque instant de chaque individualité, sont l’expression d’un nouveau visage de l’absolu — qui est donc à la fois toujours lui-même, et toujours autre que lui-même. Or c’est exactement de cela que le Qouth d’un temps est suprêmement conscient. Il voit l’absolu dans la moindre bribe de son existence et du monde. Il reconnaît l’intention du Soi créateur dans l’esprit et les formes de son temps. Les soufis disent qu’il est détenteur du Sirr (secret) de son époque et du Idhn (autorisation) de communiquer aux autres hommes ce qu’ils peuvent en recevoir. »
Et quel est le penseur qui a permis à Mohammed Iqbal de repenser sa religion ? La réponse est dans le titre du livre que Bidar a consacré à Iqbal : "L’Islam face à la mort de Dieu" : Friedrich Nietzsche.
A lire impérativement : MOHAMMAD IQBAL, A PROPOS DE NIETZSCHE
01:38 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (5) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
11/03/2011
Troublantes alliances masquées...
=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=
De l'art et la manière de nous enduire la rondelle de vaseline...
20:32 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
10/03/2011
Frank Zappa, le conservateur pragmatique
=--=Publié dans la Catégorie "Music..."=--=
"Dans son autobiographie, Zappa consacre un chapitre à ses vues théoriques et pratiques sur la musique… et quatre chapitres à la vie politique des États-Unis d’Amérique. Il plaide notamment pour une nette séparation de l’Église et de l’État (que prévoit d’ailleurs la constitution des Etats-Unis) ainsi que pour une réforme de la fiscalité, de l’éducation, de la défense et de la politique étrangère de manière à éliminer les passe-droits des plus riches, à gérer le bien commun de manière rationnelle et à réduire le poids de l’État sur les citoyens.
Paradoxalement, il refuse d’adhérer à quelque structure collective que ce soit, qu’il s’agisse d’une formation politique ou d’une association professionnelle de musiciens. « Si Zappa émet une critique radicale de la société américaine, il ne prône aucune révolution et n’adhère à aucun projet politique, souligne Marc-André Gagnon, un essayiste québécois. Il ne cherche qu’à résister aux restrictions que la norme sociale tente d’imposer à sa liberté de composer.(16) »
L’universitaire américain Kelly Fisher Lowe ajoute : « Zappa était la quintessence du petit homme d’affaires quasilibertarien . Il a le sentiment que le rôle de l’État est de créer un espace où tout le monde (dans son cas, l’artiste) puisse être libre de faire ce dont il a envie (dans son cas, créer).(17) » Zappa est sans aucun doute un nihiliste, ce qui ne l’empêche pas de croire sincèrement à l’american dream : il est convaincu qu’un travail passionné, intègre et soutenu finira par porter ses fruits, surtout s’il n’est pas entravé par de grandes organisations qui contrôlent le marché.(18)
Dans le contexte nord-américain, la pensée politique de Zappa est assez singulière. Bien qu’il se montre sensible à certains idéaux de gauche, il se comporte de manière très individualiste. Comme bien des Américains, il se méfie instinctivement de l’État, mais il redoute aussi (et ici sa pensée est plus originale) le pouvoir des grandes entreprises, notamment des multinationales du divertissement. Son système politico-économique de prédilection, qu’il qualifie de « conservatisme pragmatique », repose sur la cellule familiale et de petites entreprises indépendantes encadrées par un État-nation aussi discret, rationnel et efficace que possible, exempt de toute trace d’idéologie.
Zappa plaide en fait pour la réconciliation de ce qui, aux Etats-Unis, appartient aux extrêmes : la liberté de l’individu, qui doit demeurer inaliénable (« je crois que les gens ont le droit de décider de leur destin. Un être s’appartient »(19)), et la justice sociale. « Une nation n’est réellement puissante que lorsque tout le monde récolte une part du gâteau. Je dis bien : tout le monde », souligne-t-il en 1988 à propos de l’économie de son pays. (20)
16. Marc-André Gagnon, « Frank Zappa : un intellectuel ‘’spécifique’’ », Conjonctures n°29, Montréal, printemps-été 1999, p. 140.
17. Kelly Fisher Lowe, op. cit., p.88.
18. Sur l’american dream et Zappa, voir Kelly Fisher Lowe, ibid.., p. 13 et suivantes.
19. Frank Zappa, Peter Occhiogrosso, op. cit., p. 344.
20. Ibid, p. 336
« Le petit wazoo, initiation rapide, efficace et sans douleur à l’œuvre de Frank Zappa » Jean-Sébastien Marsan
23:35 Publié dans Music... | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook