28/01/2020
La vocation spirituelle de la France
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« On croit aujourd’hui mon pays divisé contre lui-même. Il ne l’est qu’à l’égard des mystiques qu’on prétend lui imposer du dehors et qui répugnent à sa tradition et à son génie, mais qu’il s’efforce, malgré cela, d’assimiler, ou du moins de rendre intelligibles, parce que sa vocation est de tout comprendre, de tout risquer pour comprendre. Notre honneur, et aussi notre malheur, est que nous restons sincères parmi les menteurs, humbles parmi les orgueilleux, raisonnables parmi les fous.
On nous accuse de douter de nous. Mais il faut plaindre davantage les peuples qui, pour croire en eux-mêmes, ont besoin de s’exciter jusqu’à la frénésie, qui ne se trouvent qu’à la limite du délire collectif et qui redeviendront des esclaves dès qu’ils cesseront de se proclamer des dieux au roulement de cent mille tambours. […]
Je souhaite que la France ne perde pas trop de temps à combler cette espèce d’orifice ouvert dans son histoire et d’où monte une odeur sinistre. Qu’elle jette une planche dessus et qu’elle passe outre. En avant ! en avant ! Une humiliation ne se répare pas, elle se venge.
Il est facile de trouver des excuses à notre défaillance, nous préférons mille fois qu’on ne lui en cherche aucune, nous refusons de plaider pour la déroute. C’est la propagande ennemie qui commence à se charger de ce soin, inspire çà et là de timides réserves contre un jugement trop hâtif, trop dur, nous invite sournoisement à rejeter sur un petit nombre d’hommes le poids du désastre de la nation, comme si la France n’était pas assez grande pour l’assumer. Je dis la France, la France de quarante rois, de deux empires, de trois révolutions, la France de la Marne et de Verdun. Prennent-ils donc la plus vieille chrétienté d’Europe pour un enfant mineur, victime de mauvaises fréquentations, et en faveur duquel l’avocat plaide l’irresponsabilité ?
Il est honteux de voir de jeunes Français bien intentionnés je suppose, mais sans doute justement inquiets pour leur génération du jugement de l’histoire, lier leur cause à celle du pays. "En faisant douter de nous, disent-ils, vous allez faire douter de la France." Et ils s’efforcent de dresser un bilan favorable des efforts d’avant-guerre, de ces diverses "Renaissances" — littéraires, sportives, morales, religieuses — dont ils avaient si soigneusement jadis établi les plans sur le papier. Ils versent ces pièces précieuses au dossier. Hé bien la France ne veut pas de dossier ! Il ne saurait être question pour elle de s’en remettre à son banquier, à son avocat, ou même à son confesseur, dans une affaire où son honneur est engagé.
Quelle que soit, en effet, l’opinion qu’on ait sur l’armistice, un fait est certain, indiscutable : nos armées ont été dispersées, Paris rendu, notre territoire conquis de la Meuse aux Pyrénées en un peu plus de vingt jours. Le caractère foudroyant d’une telle catastrophe a quelque chose de suspect. La France ne peut supporter d’être soupçonnée d’une sorte de faillite frauduleuse, ce soupçon fût-il injuste. C’est ce que comprendront sans peine mes plus déterminés contradicteurs, et parmi eux mon distingué confrère, M. le Directeur du Meio-Dia (1), car, si loin que nous entraîne parfois le démon de la polémique, ce proverbe de mon pays est toujours vrai qu’entre honnêtes gens, n’est-ce pas ? On finit toujours par s’entendre.
Bref, au risque de renier ce qu’elle doit, la France préfère celui de payer ce qu’elle ne doit pas. Des deux hypothèses qui se proposent à sa conscience, elle admet la pire, elle signe au monde un chèque en blanc. Après tout, elle devait à ce monde une victoire, elle lui a donné une défaite, elle n’en discutera pas les causes. Une nation de son rang ne supporte pas de décevoir, fût-ce le plus humble de ceux qui ont cru en elle — et celui-là moins qu’un autre. Il se peut que notre défaite soit honorable, il se peut que notre honneur soit sauf, mais ce n’est pas assez qu’il se puisse, il faudrait que ce fût évident, que cette évidence s’imposât du premier coup à tout homme de bonne foi. Dans le doute, la France préfère répondre de la déroute, et nous avec elle.
Car enfin, la défaite, c’est nous. Jeune ou vieux, tout Français aujourd’hui vivant doit accepter sa part de honte. Les anciens services rendus, les sacrifices consentis, les maux soufferts, ne comptent plus. Que les jeunes Français acceptent de jeter dans la fosse sans gloire leurs "Renaissances" ratées, leurs ambitions déçues, leurs bonnes intentions, d’autrefois, inutilisables maintenant, nous y jetons bien, nous les vieux, nos vies usées, nos pauvres lauriers de l’avant-dernière guerre. La France choisira plus tard, beaucoup plus tard, entre ces reliques poussiéreuses, ce qui lui paraîtra pouvoir encore servir. Aujourd’hui nous ne pouvons rien, nous nous reconnaissons insolvables, voilà tout. Il faut que notre pays réponde, pour ses fils prodigues. La France avait tiré une traite sur nous, et sous prétexte que nous avons laissé passer l’échéance, elle ne laissera pas protester sa signature. Elle ne regarde même pas le tas de papier qui s’accumule à ses pieds depuis trois mois, elle dédaigne d’en vérifier le compte, elle regarde le monde en face — amis ou ennemis — et elle dit simplement : "Je paierai tout !"
Les jeunes réalistes peuvent bien croire que ce que j’écris ici, c’est de la littérature. Leur jugement m’importait peu hier, il m’importe encore moins aujourd’hui. La France dont je parle n’est pas un mythe, une image poétique, elle existe réellement. C’est même la seule qui compte, car c’est celle qu’on aime, l’amour la fait vivante, mille fois plus réelle et plus vivante que celle qui négocie, épargne, spécule, fabrique. Toutes ces Frances-là ne seraient rien sans elle, car c’est à elle qu’on croit. Pour me mettre à la portée des jeunes réalistes, je dirai que notre crédit lui-même, en dernière analyse, se fonde moins sur l’or de nos coffres que sur le juste renom de l’honneur français. […]
Les ennemis de mon pays m’accusent probablement d’orgueil, et je n’ai jamais été moins orgueilleux qu’aujourd’hui, j’ai ressenti jusqu’aux moelles l’humiliation de mon pays et, doutant parfois de lui — non de son passé, certes ! mais de son avenir —, je ne suis que trop tenté de désespérer de moi-même, de mes livres, de tout ce que j’ai fait. Je reste debout non par orgueil, comme ils vont faire semblant de le croire, non pour les défier eux-mêmes — car je ne les méprise nullement, et peut-être nous aimerions-nous si nous nous connaissions mieux —, mais parce que je ne puis parler que debout, c’est une position qui m’est naturelle, et d’ailleurs je ne parle qu’aux hommes debout ! Oui, le geste naturel de ma race devant Dieu, c’est de se lever, de se mettre debout, d’attendre ainsi ses ordres, ce n’est pas de se coucher par terre, en frappant le sol du front, comme on fait ailleurs. Un chrétien français ne devrait se coucher que pour mourir.
Nous n’ignorons pas, et je n’ignore moins que personne, quelle faute nous venons de commettre, quelle déception nous avons donnée. Notre seule manière d’en demander pardon est de nous lever pour les réparer. Nous les réparerons à notre manière, nous les réparerons "à la française". Nous sommes la chrétienté de France. Nous ne dédaignons pas les autres chrétientés. Nous savons qu’elles ont chacune leur vocation particulière, et que toutes ces vocations particulières retourneront un jour à leur source, qui est la Sainte Charité de Jésus-Christ. Mais sous prétexte de repentir ou d’humilité, nous n’inclinerons pas devant d’autres traditions historiquement moins glorieuses et moins pures que la nôtre, la tradition des aïeux. […]
Il est si facile d’avoir raison contre la France ! On pourrait presque écrire que notre histoire est l’histoire de nos fautes, ou du moins elle parait telle au regard des hommes graves, des hommes sérieux, et en général de toute espèce d’animaux à sang froid. Les hommes graves voient les fautes, en calculent les conséquences, mais ils ne vivent jamais assez longtemps pour reconnaître qu’ils se sont trompés dans leurs calculs, que les mêmes erreurs qui eussent consommé leur ruine n’ont ralenti qu’un moment l’élan de notre peuple, ou plutôt ne l’ont ralenti qu’en apparence, car le rythme de la vie française n’est pas celui de leur propre vie.
Un homme même grave, même conservé par l’ennui, ne dure pas beaucoup plus d’un demi-siècle, et dix siècles, pour une nation, ce n’est rien. D’ailleurs, on n’a jamais vu une nation mourir de vieillesse ou de maladie, les nations sont moins fragiles que les races, parce qu’elles sont riches d’hérédités diverses, parfois contradictoires, elles ont plus de nerfs que de muscles, au lieu que les races réservent aux historiens les mêmes déceptions que les colosses aux médecins.
Les mêmes femmes qui bien portantes font la fortune des pharmaciens triomphent d’affections aiguës dont la moindre mènerait au cimetière un champion. Je sais bien que ce que je vais dire ne me vaudra pas l’estime des lecteurs qui ont soif de vérités surprenantes, paradoxales, mais, sincèrement, croyez-vous qu’un pauvre bonhomme, en vingt ans d’expériences de bibliothèques — sans parler du temps qu’il donne à ses petites affaires, au bridge, à l’Académie, à d’autres soins plus frivoles encore —, puisse comprendre quelque chose au destin d’une nation qui a un millénaire derrière elle, et plusieurs millénaires par-devant, pour qui les siècles sont des jours ?
Oh ! sans doute, ils passent pour s’instruire les uns les autres, d’âge en âge, on dit qu’ils se transmettent le flambeau. Il faut donc que ce flambeau n’éclaire jamais le même pan d’ombre, car ces Messieurs ne s’accordent pas du tout entre eux sur ce qu’ils voient, sur ce qu’ils ont vu. C’est peut-être qu’ils ne regardent vraiment qu’eux-mêmes. Ils attendent de l’histoire de France qu’elle les justifie d’être ce qu’ils sont, de penser ce qu’ils pensent. Ils voudraient que cette histoire fût aussi sérieuse, aussi ennuyeuse que la leur, on les étonnerait bien en leur disant qu’elle ressemble beaucoup plus à la vie d’une femme passionnée qu’à l’honorable et studieuse carrière d’un membre de l’Institut. Les événements ne leur apprennent rien, parce qu’ils s’efforcent de les relier entre eux par la même logique arbitraire qui gouverne leur destin, ils refusent de croire à ces réactions spontanées, imprévisibles, foudroyantes, qui font tout le mystère des grandes âmes et des grands peuples.
L’histoire est un perpétuel recommencement, disent-ils. Quelle erreur ! C’est eux qui recommencent toujours, c’est eux qui ne changent jamais. On voit ainsi, dans mon doux pays de Provence, les vieux "retraités", chauffant leurs rhumatismes au soleil, assis gravement côte à côte sur les bancs de la petite place. Ils regardent jouer les enfants, mais ils ne comprennent plus rien à leurs jeux. Ils regardent passer les amants, mais ils ne comprennent plus rien à l’amour. Parce qu’ils ne comprennent plus rien au jeu ni à l’amour, ils se croient sages, ils remâchent amèrement leur sagesse, haussent les épaules, branlent la tête, jusqu’au jour où leur place est vide, aussitôt remplie par un autre vieux qui leur ressemble comme un frère, qui reprendra la même vaine méditation au point où l’autre l’aura laissée, avant d’aller bientôt le rejoindre au cimetière.
Je me suis toujours efforcé de comprendre la France, parce qu’elle m’est toujours apparue depuis l’enfance ainsi qu’un être vivant, vraiment vivant, c’est-à-dire capable d’aimer. Je ne souhaitais pas seulement de l’aimer, comme si mon amour était un don précieux, volontaire, qu’elle dût accepter avec gratitude. Je désirais de tout mon cœur qu’elle m’aimât, qu’elle me comprît, qu’elle me reconnût pour l’un des siens, que son regard se posât sur moi, ne fût-ce qu’un moment, qu’elle se révélât le temps d’un éclair, une fois, une seule fois, comme le bon Dieu daigne se révéler aux saints.
Et pour voir se réaliser ce souhait magnifique, je ne comptais nullement sur la chance d’une carrière heureuse, ou glorieuse, qui m’imposât un jour à son attention, car je savais déjà, je sais encore aujourd’hui, que la grandeur et les honneurs sont peu de chose à ses yeux, que nous ne devons rien attendre que de son royal bon plaisir, de son libre et gracieux choix. Je me suis toujours efforcé de comprendre la France, mais à présent il me faut la comprendre coûte que coûte, je ne puis plus me passer de la comprendre, rien ne m’importe plus que de la comprendre. Jamais je ne l’ai sentie si loin de moi, et c’est peut-être qu’elle n’a jamais été plus proche, qu’elle m’impose la suprême épreuve non de souffrir pour elle, comme il y a vingt ans, mais de souffrir par elle, de ne plus reconnaître son visage humilié.
Notre peuple a été vaincu, il est aujourd’hui tenté. On ne doit traiter à la légère ni la tentation, ni le tentateur. Nous n’ignorons rien des fautes du passé, ni des arguments qu’elles peuvent fournir aux agents de l’ennemi. L’ennemi fait beaucoup de promesses, et peut-être en tiendra-t-il quelques-unes, peut-être ne refusera-t-il pas quelques menues faveurs à sa belle proie pourvu que, se prosternant, elle l’adore. Le Maître nous tend sa main à baiser, "Baisez-la, qu’importe" murmurent les entremetteurs et les casuistes, les intellectuels pourris, les vieillards macérés dans l’impuissance et la rancune comme un cadavre dans les aromates.
Ainsi parlaient-ils déjà, voilà bien des siècles, à l’oreille de Jeanne d’Arc. Elle était seule devant eux, les mains nues. Et ils avaient tout. Ils avaient la force, la science, le prestige du ministère sacré. Ils argumentaient au nom du bon sens, de la raison, de la foi catholique, de Dieu même. La seule chose qu’ils ne pouvaient faire, c’était de parler au nom de l’honneur. L’honneur de la France était dans ces mains nues, innocentes. Hé bien ! il y est encore aujourd’hui. Les frêles doigts, les doigts enfantins que toute la force de la puissante Angleterre des Plantagenêts n’a pu réussir à desserrer, ne s’ouvriront pas aujourd’hui entre les mains d’un rustre allemand. […]
Pour être tout à fait sincère, il ne suffit pas, comme le pensent tant de bienheureux et de bienheureuses formés par les casuistes, de s’abstenir de mentir. Il est nécessaire de s’avancer avec toute la part de vérité dont on dispose, part qui, si modeste soit-elle, est presque toujours beaucoup plus précieuse qu’on ne le pense soi-même : car il nous est difficile de jauger d’emblée la valeur de ce qui nous a coûté tant d’efforts et que nous avons dû attendre si longtemps, au-dedans de nous-mêmes. C’est pourquoi, chaque fois que je vous parle de mon pays, je reste consterné en faisant le compte du petit nombre de choses que j’ai à vous dire, une fois que j’ai achevé la tâche d’écarter toutes celles qui ne me paraissent pas nécessaires.
Il serait évidemment plus avantageux pour moi de ne pas me montrer aussi sévère dans ce choix, et cela flatterait la vanité d’un certain nombre de lecteurs, qui probablement ne se sont jamais donné la peine de comprendre la France, mais se donnent beaucoup de mal pour garder l’illusion qu’ils l’ont comprise ; il accueillent évidemment les recettes fournies par des intellectuels dont le rôle se ramène à transporter de livre en livre et de capitale en capitale quelques idées sommaires et brillantes, faciles à placer, comme ils transporteraient des échantillons dans une valise. Tous les pays possèdent de tels parasites, mais, conformément au proverbe « corruptio optimi pessima », les exemplaires les plus ridicules de cette espèce sont fournis par quelques artistes et écrivains français, devenus fournisseurs attitrés de pacotille destinée à l’exportation.
Je ne prétends aucunement que de tels individus soient des imbéciles, bien au contraire. Ils seraient très capables d’exercer une autre profession, mais ils ont choisi celle-là comme étant mieux accordée à leur nature, comme s’ils étaient venus au monde pour ce genre de succès. Ils connaissent admirablement les points faibles du public et s’entendent à lui épargner tout effort de discernement, à substituer à l’idée vraie une banalité prétentieuse, au sentiment sincère le jeu sentimental. Il est consternant d’observer que des écrivains illustres, de renommée universelle, et dont le caractère est certainement égal au talent, se sont laissé gagner par la contagion, cédant ainsi au désir de toucher, de séduire, de secouer les nerfs du public. […]
L’effort désintéressé d’un homme pour comprendre la France est un acte qui va bien au delà de la simple littérature et qui a, à mes yeux, un caractère sacré, presque religieux. Si humble que soit cet homme, si étranger que je le suppose à notre race, et sa peau fût-elle de couleur très foncée, je ne puis tolérer qu’il soit mystifié par des intrigants et des pédants, ou que la noble passion qui l’anime tourne à ce conformisme dont justement l’esprit français a horreur, étant donné que sa mission est de le briser sans cesse, à mesure qu’il se reforme, comme un bateau brise-glaces passe et repasse à travers les banquises, afin d’ouvrir une voie libre à la mer.
Chers amis, cette fois encore, l’idée que je vous offre est très simple : pourtant je ne la traiterai pas à la légère, car elle est de celles qu’un Français préfère à toutes les autres, parce qu’elles mettent d’accord l’intelligence et le cœur. Il n’y a qu’un moyen de servir réellement la France, c’est de l’aimer. Et il n’y a qu’un moyen de l’aimer, c’est de la comprendre, je veux dire de chercher à la comprendre, car c’est en vertu de cette volonté et de l’effort qu’elle exige que vous vous trouverez associés à son aventure millénaire, à l’immense déroulement de son histoire, l’histoire d’un peuple dont le génie tendre, lucide et douloureux est le génie de la sympathie.
Si vous aimez la France et son esprit, n’en attendez pas la définition, car cette définition n’existe pas. Mon pays est plein de contradictions, comme n’importe quelle créature humaine, comme la vie elle-même ; la raison seule ne saurait résoudre ces contradictions, il y faut absolument la clairvoyance de l’amour, que le christianisme a divinisée sous le nom de charité. On parle beaucoup de son génie équilibré ; on pourrait bien mieux parler de sa flamme, de la ferveur sacrée qui la jette sans cesse d’expérience en expérience, de risque en risque.
Cette contradiction, comme les autres, est à peine apparente, car l’équilibre est une condition du mouvement, et si le danseur de corde voltige à cinquante mètres au-dessus du sol comme un oiseau ou comme une flamme, c’est qu’il a le sens de l’équilibre dont il paraît défier les lois. Oh ! je sais très bien que beaucoup d’entre vous, en lisant ces phrases, me feront peut-être l’honneur de les trouver harmonieuses, émouvantes, poétiques, mais l’instant d’après les oublieront. Ah! il n’y a qu’un moyen d’aimer et de comprendre la France, mais de même, pour elle, il n’y a qu’un moyen de se faire aimer et comprendre, c’est d’agir, de s’élancer en avant, de montrer la voie.
Il suffit qu’elle s’arrête, ou simplement qu’elle ralentisse son ardent élan historique, pour que les parasites intellectuels qui foisonnent partout sur le monde comme les poux dans la fourrure d’un animal malade, se jettent sur elle comme sur leur proie. Ils sophistiquent sa pensée, à l’imitation des Pharisiens qui sophistiquent l’Évangile, et ils mettent la pensée française hors de la portée des esprits droits et des cœurs simples pour lesquels Dieu l’a faite.
Lorsque j’affirme que la France est révoltée par l’imposture, qu’elle a pour l’imposture, et particulièrement pour les formes supérieures de l’imposture — celles de l’esprit —, une espèce de répulsion nerveuse, capable de la porter à des actes extrêmes, de la faire passer brusquement de l’agitation de la colère à la prostration du désespoir, le moindre petit licencié d’histoire m’accusera de tomber dans un anthropomorphisme enfantin ; mais j’aime mieux être d’accord sur ce point avec Michelet et Péguy qu’avec n’importe quel petit licencié d’histoire.
Car en écrivant que notre peuple est le moins pharisien du monde, c’est-à-dire le peuple qui compte le moins grand nombre de Pharisiens, chez qui le pharisaïsme prospère mal, l’auteur du Mystère de Jeanne d’Arc nous a définis essentiellement, substantiellement, puisque notre horreur naturelle du pharisaïsme explique à la fois nos vertus et nos vices, cette horreur a fait nos héros comme nos anarchistes, des êtres d’une droiture et d’une loyauté incomparables, mais aussi des cyniques et des débauchés. Elle explique également certaines contradictions apparentes de notre histoire, certains retournements prodigieux.
La France est capable de se résigner à bien des injustices, mais elle ne saurait tolérer — au sens exact, j’oserai dire au sens médical de ce mot — cette espèce d’injustice qui prétend s’exercer au nom de la justice. Ainsi, par exemple, l’Inquisition, introduite chez nous par les moines fanatiques d’Espagne, et dont le but principal semble bien avoir été d’enrichir, par les confiscations, le clergé simoniaque d’Italie, nous rendit anticléricaux pour des siècles. Il ne serait pas moins vrai d’affirmer que la féroce hypocrisie des princes protestants du XVIe siècle, qui pillaient l’Eglise sous prétexte de la réformer, nous détourna à jamais du protestantisme.
C’est face à une imposture de ce genre que le grand Drumont disait : "Cela me rend physiquement malade." Et c’est bien une imposture de cette sorte qui rend la France malade, qui l’intoxique, qui l’empoisonne. Comme je le disais naguère, il arrive alors que le venin lui monte à la tête et la jette au paroxysme de la fureur. Mais il se peut aussi que les nerfs lâchent et que la révolte de l’âme nationale s’exprime par l’ironie douloureuse, le scepticisme, et même la stupeur. […]
Je ne me suis jamais senti plus d’estime pour les masses de gauche que pour les masses de droite, et la raison en est bien simple- Il y a eu autrefois des idéalistes de gauche et des idéalistes de droite, mais les méprisables dégénérés qui se recommandent aujourd’hui d’eux ne mériteraient que leur mépris. Comment d’ailleurs les reconnaître ? L’homme jadis flétri par les révolutionnaires sous le nom d’homme d’ordre ne serait pas aujourd’hui Cavaignac, mais M. Thorez. Les gens de droite dénoncés par moi dans Les Grands Cimetières utilisaient contre leurs adversaires des méthodes qu’ils n’avaient cessé de flétrir.
Mais les gens de gauche tout au long du XIXe siècle n’ont cessé d’exalter ces méthodes. "La Révolution est un bloc", déclarait G. Clemenceau solidarisant ainsi les combattants de l’armée du Rhin avec les égorgeurs de septembre. Il est certainement ignoble d’entendre un prêtre approuver l’épuration sans jugement des suspects, mais il n’est pas seulement ignoble, il est comique de voir un homme de gauche prétendre être traité par la Gestapo avec des égards que ses ancêtres et ses modèles n’ont jamais eus pour leurs compatriotes "ci-devant".
Je parle naturellement ici de la masse des gens de gauche et des gens de droite. Il y a dix ans, j’ai pu essayer de me faire illusion sur ces masses de gauche par dégoût pour les masses d’une droite avilie. Je ne vois plus là maintenant qu’une tentation du désespoir. La paix au moins a démontré l’impuissance de ces gens-là, leur hypocrisie au moins égale à celle de leurs adversaires. On dit que la Résistance a eu le cœur à gauche. Que veut-on prouver par là ? Elle l’aurait eu à droite et non à gauche en cas d’occupation par les Russes.
Je le demande à tout lecteur de bon sens et de bonne foi. Si nous pouvions faire exactement le compte des hommes qui se sont prononcés contre Munich, Rethondes et Montoire sans aucune arrière-pensée de haine politique ou de préjugé social, c’est-à-dire inspirés par l’unique souci de leur propre honneur et de l’honneur de la nation, quel en serait le nombre ? Il ne saurait être assurément que très petit. Le chiffre une fois fixé, qui oserait se prétendre absolument sûr que dans cette sélection des sélections les gens de droite seraient moins nombreux que les gens de gauche ! […]
Oh ! certainement, une fois de plus, il y a, grâce à Dieu, des hommes libres un peu partout. Non pas de ceux qui se disent libres parce que la démocratie leur donne cette étiquette, mais réellement libres, et qui le seraient n’importe où et n’importe comment, dans la richesse ou dans la pauvreté, la santé ou la maladie, qui le seraient même dans les chaînes, s’ils vivaient sous un tyran. De tels hommes, je le répète, se trouvent partout. Peut-être, pourtant, eussent-ils été naguère dans mon pays plus simplement, plus naturellement, plus ingénument libres qu’ailleurs, sans rien de prétentieux, d’affecté, de recherché, de tourmenté ; libres presque malgré eux et à leur insu, parce que leur liberté avait pour principe une espèce de liberté intérieure, dont ils n’éprouvaient pas le besoin de refaire l’expérience à tout instant, de même qu’un vrai chrétien ne met pas à tout moment sa foi à l’épreuve.
On les jugeait parfois conformistes, parce qu’ils s’efforçaient de n’attirer l’attention de personne. On les disait conformistes, et ils Tétaient, en effet, dans les circonstances futiles et familières de la vie. Ils étaient conformistes comme ils étaient pacifiques, c’est-à-dire jusqu’à un certain point, et, passé ce point, rien n’aurait pu les faire reculer, sinon la certitude — ou l’illusion — d’avoir accompli leur tâche, de pouvoir revenir sans remords au conformisme et à la paix. […]
Pour définir la vocation spirituelle de la France, je n’ai nullement besoin d’être docteur en théologie, j’ose même dire que Jeanne d’Arc en savait beaucoup plus long sur un tel sujet que saint Anselme ou saint Thomas d’Aquin. La vocation spirituelle de la France est de démasquer l’imposture, et l’une des plus grotesques impostures de ce temps est la prétention des intellectuels catholiques à s’ériger en perpétuels censeurs du désordre de la société moderne, alors qu’ils lui donnent précisément l’exemple d’une anarchie spirituelle qui passe toute mesure, parce qu’on s’efforce de la masquer sous des formules vagues qui, condamnant tout le monde, dispensent de juger personne.
La vocation de la France est de démasquer l’imposture. Vous trouvez peut-être une telle formule un peu simpliste ? Tant pis pour vous ! Elle résume merveilleusement au contraire toute une philosophie pratique de la vie. Dois-je faire remarquer une fois de plus que ce livre n’est pas une apologie de mon pays ? Lorsque j’écris qu’il hait l’imposture, je ne veux nullement dire qu’il la hait seulement par vertu, qu’il est plus vertueux que les autres. Mon pays n’a pas choisi sa vocation, elle lui a été donnée ; s’il se déshonore en y manquant, on ne saurait lui faire un grand mérite de suivre la voie où la Providence l’a engagé il y a des siècles, et qu’il n’a jamais quittée sans payer sa faute d’épreuves effroyables. Pourquoi sa haine de l’imposture ne serait-elle pas devenue, à la longue, une sorte de réflexe héréditaire, une des formes de l’instinct de conservation ? Mais d’abord de quelle espèce d’imposture s’agit-il ? Je réponds sans hésitation : des impostures de l’Esprit.
(1) Journal brésilien de Rio de Janeiro »
Georges Bernanos, La vocation spirituelle de la France
16:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



















































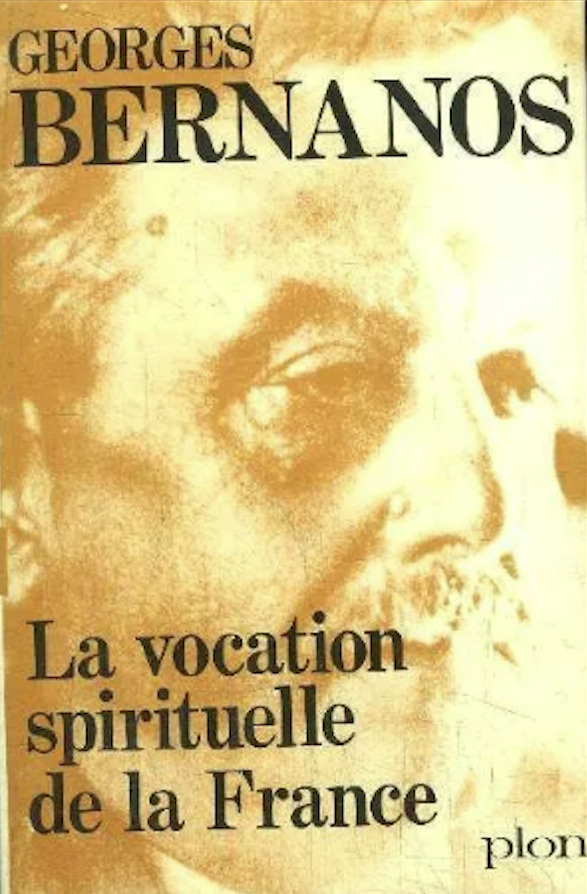

Les commentaires sont fermés.