12/05/2011
Un Corps de Chair
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
Je propose aujourd'hui un long extrait du dernier livre de Jean-Claude Guillebaud dans lequel l'auteur donne d'autres pistes concernant le Corps tel qu'il est perçu par le Christianisme et qui pousse à croire que ça n'est pas Dieu qui a un problème avec la chair, mais bien plutôt l'église au terme de multiples influences qui ne puisent pas leurs origine dans le Message du Christ.
C'est moi qui souligne certains passages pour en indiquer la force.
----------------------------
Le Christianisme oublieux de lui-même
(…) Nous sommes tellement accoutumés à l’insistante pudibonderie catholique dans le domaine sexuel que nous ne comprenons plus ce qu’elle a de paradoxal, eu égard à une partie notable de la tradition. Depuis la Contre-Réforme du XVIIe siècle, mais surtout depuis le XIXe siècle, le discours catholique procède de ce que l’évêque de Poitiers, Albert Rouet, appelle lui-même (pour le condamner) le « jansénisme moral ». Le même évêque, avec une belle insolence, ironise sur la frilosité puritaine qui a poussé l’institution à « corriger » la traduction d’un vers du Te Deum, dont l’origine remontait au Ve siècle. Dans sa littérarité, le texte latin disait « Tu n’as pas eu horreur de l’utérus d’une vierge » (Non horruisti Virginis uterum). Au fil des siècles, la traduction pudique est devenue : « Tu n’a pas dédaigné le sein d’une Vierge 1. » À lui seul, l’aménagement du texte est significatif.
Faisant écho à ces remarques navrées, le théologien Robert Scholtus parle quant à lui du « pas lourd » du catholicisme. De fait, depuis plusieurs siècles, le dogme catholique n’en finit pas de condamner les « débordements de la chair », et in fine le corps lui-même. Dans son Histoire de la sexualité, Michel Foucault a montré qu’en durcissant son « jansénisme moral » au XIXe siècle, le catholicisme se ralliait pour une bonne part à « l’esprit bourgeois », et à une pruderie d’inspiration scientiste. Ce fut le cas au sujet de la masturbation, que les médecins athées comme le docteur Tissot (grand ami de Voltaire) diabolisèrent délibérément en y voyant une pathologie à soigner énergiquement.
Depuis lors, le moralisme ecclésial — effrayant dans les années 1950 — se retrouve dans une proximité (délétère) avec la gnose dualiste dont on a vu qu’elle réapparaissait aujourd’hui sous d’autres habits chez les « nouveaux pudibonds » du cyberespace. Ce dualisme désincarné, certains Pères de l’Église des premiers siècles l’avaient pourtant ardemment combattu. Que s’est-il passé au fil des siècles pour que finissent par prévaloir une vision aussi étroite, un discours de mortification, un parfum aigre de sacristie dont plusieurs générations eurent à subir la pesanteur ? Pourquoi l’Église n’a-t-elle pas compris qu’en cédant à un jansénisme aussi outré, en se faisant « scrutatrice des consciences, voire investigatrice, soupçonneuse, sourcilleuse2 », elle détournait de la foi des générations entières et contribuait ainsi à la sécularisation qu’elle déplore aujourd’hui ?
Le discours abusivement rigoriste de l’Église en matière sexuelle s’inscrit en réalité dans une longue histoire qui, depuis l’origine, a divisé le christianisme dans son entier. La Gnose n’est pas seule en cause. Le courant ascétique fut très actif durant les premiers siècles, à l’intérieur même du christianisme canonique, et s’est perpétué par la suite, en s’appuyant notamment sur une interprétation contestable des Épîtres de Paul, puis des textes d’Augustin, pour aboutir au jansénisme de Port-Royal, puis à la pruderie cléricale du XXe siècle. Ce courant, désigné sous le nom d’encratisme (du grec enkrateia, « continence »), réunissait en lui plusieurs influences dont celle de la secte juive des Esséniens, mais aussi un dualisme venu de Platon et du stoïcisme grec. Plusieurs auteurs chrétiens des premiers siècles, comme Justin ou Tatien, en furent les ardents — et ténébreux — défenseurs.
En revanche, un autre courant, plus accommodant et plus riant, se manifesta dès les deux premiers siècles de notre ère. Il était surtout représenté par la patristique grecque. Clément d’Alexandrie (vers 140-vers 220), auteur des Stromates, en fut le meilleur exemple. Très sévère à l’endroit des encratites, Clément faisait l’éloge de l’union entre homme et femme, et assurait même — contre le rigorisme essénien — que la vie sexuelle n’impliquait aucune espèce d’impureté. Ce courant est resté présent au sein du christianisme. Les jésuites, pour ne citer qu’eux, en furent les lointains héritiers. Cela signifie que le balancement entre les deux sensibilités n’a jamais cessé depuis deux mille ans.
Certaines périodes chrétiennes furent d’ailleurs moins rigoristes qu’on ne l’imagine. Sur des questions comme l’homosexualité ou le « plaisir solitaire », il est arrivé que l’institution catholique se montre paradoxalement plus indulgente que les pouvoirs temporels. Le péché dit de « mollesse » (l’onanisme) n’était que modérément puni dans les « pénitentiels » de l’époque médiévale, ces guides pratiques censés guider les prêtres dans la confession de leurs fidèles3. Quant à l’homosexualité, un historien gay américain de l’université de Yale, John Boswell, mort du sida en 1994, avait montré qu’elle fut moins systématiquement condamnée par l’Église qu’on ne le croit, et cela jusqu’à l’époque médiévale. Dans sa magistrale étude, il citait même le cas d’un pape prenant la défense d’un « inverti » persécuté par le pouvoir temporel. « On peut difficilement soutenir, écrivait-il, que l’attitude relativement indulgente adoptée par d’éminents hommes d’Église du haut Moyen Âge envers l’homosexualité soit due à l’ignorance. En effet, l’homosexualité n’est pas ignorée : elle est traitée comme une faute mineure4. »
Il n’en alla pas toujours ainsi, on le sait bien, dans l’histoire de l’Église, et c’est tout le problème. Bien qu’il fût condamné, depuis la fin du IVe siècle, par plusieurs décrets de l’empereur (chrétien) Théodose Ier, le courant encratite demeura influent pendant de longs siècles. À certaines époques il reprit indirectement le dessus. Ce va-et-vient incessant entre ascétisme et bienveillance tisse toute l’histoire du christianisme. Il permet de comprendre la subite convergence, à partir de la fin du XVIIIe siècle, entre le rigorisme très laïc de l’ « esprit bourgeois » et le discours officiel du catholicisme. La pudibonderie, revendiquée alors par une classe bourgeoise ascendante, soucieuse d’afficher sa « vertu » contre la « dépravation » de l’aristocratie, se trouva en harmonie avec l’un des deux versants du catholicisme, le plus abrupt évidemment. L’Église apporta ainsi à l’esprit bourgeois le renfort solennel de son moralisme, de sa liturgie et de ses encycliques. Une singulière « alliance puribonde » se perpétua aux XIXe et XXe siècles. Elle fut encore renforcée par l’effroi démographique engendré par la défaite de Sedan en 1870. (« Les Allemands font plus d’enfants que nous ! ») Cette panique démographique incita les Français (républicains et catholiques confondus) à privilégier la procréation plutôt que le « plaisir ». C’est contre ce moralisme civique et religieux que les jeunesses européennes se révoltèrent soudainement en 1968.
Pareille hostilité à la chair du discours ecclésial revenait à désavouer tout un pan de la tradition évangélique. On le comprend mieux maintenant. Le christianisme est la seule religion monothéiste à placer au cœur de son message le thème de l’incarnation, c’est-à-dire une glorification de la chair, voire une mystique de la chair. En choisissant, au moment de sa conversion — au tournant des XIIe et XIIIe siècles — de prêcher un matin, sans le moindre vêtement, dans la chaire de la cathédrale d’Assise, François entendait rappeler à tous son souci de « suivre nu, le Christ nu ». À ses yeux, le corps ne pouvait être négativement perçu.
On peut comprendre les réflexions acerbes d’Emmanuel Mounier (dont il sera question plus loin) au sujet des condamnations antichrétiennes de Nietzsche, lequel reprochait au christianisme d’avoir toujours « diffamé » le corps. Mounier assurait que si Nietzsche avait consacré la même énergie à étudier les premiers siècles chrétiens que celle qu’il réserva à l’Antiquité païenne, il eût raisonné différemment. L’héritage que s’employa à combattre l’auteur de L’Antéchrist n’était pas le christianisme, mais sa dénaturation cléricale. Remarquons que les auteurs contemporains qui se réclament de Nietzsche sont redevables du même reproche. La « moraline » chrétienne qu’ils combattent n’est jamais qu’une régression cléricale. Pour le reste, hormis le souci de la procréation qui est lié à l’histoire, l’éthique évangélique en matière de sexe n’est pas si différente de celle de Michel Onfray. Dans les Évangiles, Jésus ne condamne pas la femme adultère mais la sauve de la lapidation. L’interdit majeur de la morale chrétienne, la « limite » absolue du désir physique, c’est le non-désir de l’autre. Le « non » de l’autre ne peut en aucun cas être contourné, ignoré, violenté ou manipulé. En d’autres termes, le respect de l’autre vient nécessairement borner mon hédonisme.
Or, dans sa Théorie du corps amoureux, Onfray plaide pour une « érotique solaire », et même un « solipsisme du plaisir ». Reprenant Nietzsche, il fulmine évidemment contre la « névrose » biblique. Cela étant, il refuse d’être barbare ou tortionnaire façon Sade. Pas question, écrit-il, de « succomber à la violence ». Il réintroduit donc in fine le principe d’un « contrat hédoniste » entre les partenaires sexuels, et légitime du même coup l’obligation de respecter l’autre. Cette obligation procède, selon lui, d’une « éthique de la douceur » et du « respect de la parole5 ». Au-delà des proclamations antireligieuses, dans les faits, la distance n’est pas si grande entre cette « éthique de la douceur » et une éthique chrétienne éclairée. Michel Onfray s’en rend-il compte ? Une chose est sûre : si l’on peut accepter sa condamnation de la pudiponderie cléricale, il est difficile d’admettre que le christianisme tout entier soit impliqué dans ce réquisitoire. On va voir pourquoi.
À propos de crispation cléricale, on note aujourd’hui quelques évolutions dans le discours officiel de l’institution. L’encyclique Deus caritas est de 2006 reconnaissait la place éminente de l’eros. Le pape Benoît XVI lui-même, dans un livre d’entretiens publié à l’automne 2010, condamnait explicitement — et pour la première fois — le « jansénisme » sexuel. Faisant cela, il ne « rompait » pas, comme on l’a dit, avec la tradition chrétienne, il opérait un rééquilibrage en faveur d’un courant qui n’a jamais cessé d’être présent. Reste que cet infléchissement arrive bien tard et qu’il faudra beaucoup de temps avant que la nouvelle approche soit mise en pratique par la hiérarchie catholique. Même condamné par le pape, le « jansénisme » sexuel y reste solidement implanté.
Contre un « christianisme fade »
Voilà plusieurs décennies, en tout cas, que d’innombrables chrétiens avouent leur désarroi, voire leur « sainte colère » à ce sujet. Les protestations de certains d’entre eux contre la pudibonderie catholique ne le cèdent en rien à celles de Nietzsche ou de ses héritiers comme Michel Onfray, même si leur perspective n’est pas la même. On trouve parfois sous leur plume des réquisitoires plus sévères encore que ceux des nietzschéens patentés. Cela peut paraître étrange mais c’est ainsi.
Charles Péguy accordait une grande importance à l’incarnation de Jésus « fait homme », incarnation acceptée jusqu’à la crucifixion, et qui faisait entrer le Christ dans « les conditions organiques de la mémoire des hommes » ; faute de cela, ajoute-t-il, « l’incarnation n’eût pas été intégrale et loyale6 ». Georges Bernanos ironisait sans indulgence sur les « républicains cléricaux » du XIXe siècle, « que l’on voyait ruminer, entre des mandibules flétries, leurs vieux rêves d’une république sacristaine, administrée par les prêtres, qui mettait au service de la seule humanité — bien pensante — une gendarmerie céleste et supplémentaire, les dispensant ici-bas de tout souci national, en leur assurant la gloire et les projets de l’autre monde7 ».
Quantité d’intellectuels ou de romanciers chrétiens ont partagé la déception et la colère de Bernanos face aux frilosités moralisatrices de l’Église. On pense à l’auteur rare et subtil que fut Pierre Boudot, chrétien passionné par l’histoire de l’abbaye de Cluny, qui, après huit siècles de rayonnement, fut vandalisée puis détruite entre 1798 et 1823. Dans cette lente « évaporation » de l’édifice, il voyait un fort symbole des errements de l’Église. « Quand l’être physique est identifié au mal, au graveleux, au salace, à l’anormal (comparé à ce qui est "normé" pour le péché) aucun discours n’est plus possible. L’Église crée ainsi le vide dont la chute du plus ancien de ses monuments sera le symbole8. »
Mais c’est sûrement Emmanuel Mounier (1905-1950) qui, dans L’Affrontement chrétien, pamphlet publié en 1945 (il y a soixante-quinze ans !), a été le plus fougueux sur ce sujet. Il stigmatisait le « contresens » qui aboutit à faire du christianisme l’adversaire de « l’instinct », c’est-à-dire de la chair. Ce contresens donna naissance à ce qu’il appelait un « christianisme fade » : « Si la chair du corps était radicalement viciée dans la filiation humaine, écrit-il, comment oserait-il appeler la chair du Christ une chair sainte, notre corps le temple du Saint-Esprit ? » Contre les « petits bourgeois chrétiens […] très petits, très arrondis, très ennuyeux », il en appelle à un « christianisme de grand air ». Seul celui-ci, ajoute-t-il, serait capable de retrouver la vitalité joyeuse du christianisme médiéval.
Dans un superbe passage, il exprime sa nostalgie pour la chrétienté médiévale, et célèbre « ces siècles drus où la gauloiserie grimpait aux chapiteaux des églises pour grimacer par-dessus les prières, où le seigneur usait sous lui son cheval à la chasse ou à la guerre, avant d’aller l’abattre avec son orgueil au pied d’un ermitage, où le moine maniait le timon dans la tempête et la hache dans la forêt, où les hommes savaient, quand ils péchaient, pécher fortement, et quand ils aimaient, aimer totalement9 ».
L’âpre saveur de la vie
L’hommage rendu par Mounier à cette longue période de l’histoire européenne que le XIXe siècle a injustement diabolisée en la baptisant « Moyen Âge » mérite qu’on s’y arrête. Au sujet du rapport à la chair et à la vie vivante, on a tort de minimiser la verdeur des fabliaux érotiques, l’ambivalence très sensuelle du Roman de la Rose (XIIIe siècle) ou la paillardise roborative d’un ancien moine — mais « bon chrétien » — comme Rabelais (1483-1553). Pétri d’évangélisme, le héros rabelaisien entend « réhabiliter le chrétien dans sa liberté » et partage avec ses contemporains Érasme (1467-1536) et Montaigne (1533-1592) le goût d’un humanisme à la fois gourmand, sensuel et optimiste. En cela, il est plus en accord avec la postérité de Clément d’Alexandrie qu’avec celle des encratites.
Avec le recul, la culture médiévale nous apparaît comme riche d’enseignements de toute nature. L’intelligence de la période médiévale consista à « gérer » la contradiction qui, depuis l’origine, habite le discours catholique. Les deux sensibilités décrites ci-dessus s’y trouvèrent non point exclues l’une par l’autre, mais habilement conjuguées. L’historien Jacques Le Goff, spécialiste du Moyen Âge, décrit parfaitement ce qu’on pourrait appeler le subtil « usage » médiéval du message évangélique, une subtilité très « humaine » dont Mounier déplorait qu’elle fût oubliée au tournant de la Contre-Réforme puis des Lumières.
L’esprit médiéval parvenait de la sorte à rendre habitable la tension qui écartèle, en profondeur, le discours chrétien au sujet du corps. D’un côté, ce dernier est « l’abominable vêtement de l’âme », comme le disait le pape Grégoire le Grand (540-604), et ses débordements sont endigués par l’idéologie plutôt anticorporelle de l’institution. D’un autre côté, la magnificence de la chair est glorifiée et le corps est désigné comme le « tabernacle du Saint-Esprit ». Le clergé, note Le Goff, est ainsi conduit à réprimer les pratiques corporelles, tout en les glorifiant. On n’est plus dans l’ambivalence mais dans la contradiction. Elle sera prise en compte et habilement intégrée à la culture populaire grâce à la complémentarité facétieuse entre Carême et Carnaval. « D’un côté le maigre, de l’autre le gras. D’un côté jeûne et abstinence, de l’autre ripaille et gourmandise. Ce balancement tient sans doute à la place centrale que le corps occupe dans l’imaginaire et la réalité du Moyen Âge10. » La mitoyenneté bondissante entre Carême et Carnaval a été immortalisée par le peintre Pieter Bruegel dans son prodigieux tableau de 1559, Le Combat de Carnaval et de Carême.
En conciliant les deux, en ritualisant la confrontation pacifique entre Carême et Carnaval afin qu’ils deviennent constitutifs, à part égale, de l’habitus populaire, la chrétienté médiévale témoignait d’une compréhension intuitive de la condition humaine. La subtilité de cette transaction, quotidiennement vécue et assumée, permettait de sauvegarder « l’âpre saveur de la vie ». J’emprunte cette expression à l’auteur d’un des meilleurs livres — peut-être le meilleur — jamais écrits sur la vie médiévale, l’historien néerlandais Johan Huizinga. Il publia en 1919 son maître livre, L’Automne du Moyen Âge11. Traduit dans le monde entier, constamment réédité depuis près d’un siècle, cet épais volume n’est pas seulement une somme érudite, il emmène son lecteur dans un voyage très charnel au cœur de la quotidienneté médiévale.
Au fil des pages, on y découvre un univers où la plus extrême brutalité cohabite avec un goût marqué pour les plaisirs du corps et une émotivité qui s’affiche sans retenue. Nous la jugerions contradictoire et puérile. À l’époque, elle donne aux rapports que l’on entretiens avec la mort une étrange vérité. Huizinga cite la décapitation à la hache, en 1411, pendant la terreur bourguignonne, d’un Armagnac, messire Mansart du Bois. Avant de mourir, celui-ci avait pris soin d’absoudre par avance, et même d’embrasser, son bourreau qui l’implorait de le faire. Au vu du spectacle, note un chroniqueur, « foison de peuple y avait, qui quasi tous pleurait à chaudes larmes ». Dans d’autres cas, les supplices infligés à certains auteurs de crimes atroces — écartèlement, banc de torture, bûchers — suscitaient dans l’assistance une joie barbare. Ainsi en 1488, à Mons, où le peuple avait « acheté » un brigand afin d’être sûr qu’il fût écartelé. La chose étant accomplie, « le peuple fust plus joyeulx que si un nouveau sainct estoit ressuscité12 ».
L’historien néerlandais évoque les mille façons dont la société médiévale très chrétienne s’emploie à conjuguer la « violence débordante de la passion » et le raffinement toujours plus exigeant des idéaux courtois. Cette harmonisation n’est jamais achevée, toujours imparfaite. L’idéal chevaleresque dédaigne sciemment le calcul en termes d’utilité militaire, car il est hors de question de sacrifier les droits de l’esthétique à ceux de la stratégie. Il en fut ainsi, au prix de quelques désastres, au moment des croisades. « Les expéditions, qui auraient nécessité surtout des calculs précis et de patients préparatifs, étaient au contraire projetés au milieu d’une excitation d’esprit qui ornait de couleur romanesque un projet vain ou fatal13. »
Qu’il s’agisse du combat ou de l’amour physique, la violence qui habite le corps exige d’être reconnue et stylisée. Cela veut dire que les normes doivent parfois céder le pas à leur propre transgression. La culture courtoise dont se réclamait l’aristocratie avait ainsi intériorisé ses limites, et savait mettre ce « jeu » (au sens mécanique du terme) à profit. « Dans la réalité, écrit Huinzinga, la vie sexuelle des hautes classes demeurait d’une rudesse étonnante. »
Le « scandale » de l’incarnation
À ce stade de l’analyse, rappelons que le « commerce » entretenu par les humains avec leur corps ne se réduit pas à la sexualité. La « mystique de la chair » évoquée plus haut n’a rien à voir avec la permissivité érotique, telle que nous l’entendons maintenant. L’incarnation, au sens propre du terme, n’équivaut pas à la licence amoureuse. Sa portée est plus ample, plus subversive, plus radicale. Elle consiste en une acceptation apaisée de la chair qui nous constitue en tant qu’humain. Ce consentement charnel interdit toute dévalorisation ou chosification du corps. Elle refuse tout dualisme, qui ferait du corps une simple enveloppe, une mécanique ou une prison de l’esprit. En cela, elle s’accorde avec la tradition phénoménologique d’un Edmund Husserl (1859-1938) ou d’un Merleau-Ponty. Nous n’avons pas un corps, nous sommes notre corps.
Michel Henry, déjà cité dans ces pages, illustrait une « rencontre » nouvelle, à propos de l’incarnation, entre la phénoménologie et la tradition chrétienne. La convergence suscita d’ailleurs d’âpres débats. Plusieurs philosophes — dont le regretté Dominique Janicaud — firent reproche à Michel Henry d’avoir « christianisé la phénoménologie ». Ce dernier, loin de s’en émouvoir, s’expliqua longuement et brillamment sur cet aspect de sa réflexion.
Aujourd’hui, devant la montée en puissance d’une pudibonderie d’un autre ordre, celle des technoprophètes, la thématique de l’incarnation retrouve tout son sens et son utilité. Les choses se passent en effet comme si, au bout du compte, la perspective s’inversait. Hier encore accusé de dédaigner le corps, le discours chrétien pourrait en devenir demain le meilleur défenseur. Face à une technoscience fascinée par l’immatériel et irrésistiblement conduite à rejeter le corps, il redeviendrait l’avocat de la vie vivante. Il est armé pour cela. Il faudrait simplement qu’il renoue de manière claire et déterminée avec une part de l’héritage évangélique trop longtemps négligé ou répudié de facto par l’institution.
Durant les dernières décennies, plusieurs auteurs plus ou moins marqués par la culture chrétienne ont écrit qu’ils formaient des vœux pour qu’un tel renversement advînt, et fût compris. Un proche ami d’André Gorz, le juif converti et ancien jésuite Ivan Illich fut du nombre. Dans son dernier livre (posthume), il regrettait que l’Église catholique n’eût pas été capable de reformuler, en le réactualisant, le thème de l’incarnation. Il est vrai qu’Illich — durement critiqué par le Vatican — ne mâchait pas ses mots à l’adresse du cléricalisme en général. Sur le terrain politique, par exemple, il accusait l’institution catholique de légitimer un système capitaliste et productiviste impitoyable aux pauvres. Il haussait même le ton : « Recourir aux Évangiles pour conforter un système social ou politique est un blasphème. »
Au sujet de la chair, il avait très tôt pressenti, comme son ami André Gorz, l’horreur que représentait « l’éviction du corps » par la pensée cybernétique. « De son point de vue chrétien fondé sur l’Incarnation, écrit son biographe, c’est en tant que corps que nous voyons la vérité venir à notre rencontre, et c’est seulement à travers notre corps que nous pouvons la connaître14. »
Afin de mesurer la portée universelle de l’incarnation, il faut comprendre ce qu’elle eut de révolutionnaire dans le contexte des premiers siècles, largement dominés par la pensée grecque. L’affirmation contenue dans l’Évangile de Jean — « le Verbe s’est fait chair » — était considérée comme insensée par les philosophes grecs. Elle ne signifiait pas, comme on le croit parfois, que Dieu avait provisoirement emprunté les attributs corporels d’un humain — si tel était le cas, il n’y aurait eu ni rupture ni subversion. Les dieux de la mythologie grecque, y compris Zeus lui-même, revêtent souvent un corps d’emprunt, avant de l’abandonner pour retourner sur l’Olympe. Le « scandale » chrétien porté par le message johannique signifiait bien autre chose : le Dieu biblique ne s’incarne pas afin d’effectuer un petit tout sur terre ; le corps qu’il revêt n’est pas destiné à servir de truchement, de passerelle ontologique entre le divin et l’humain. L’expression le Verbe s’est fait chair signifie que la chair humaine change de statut. Elle donne lieu à l’existence. Elle est le moyen d’une émergence bouleversante, qui est celle de la vie avec sa profusion et sa capacité de s’éprouver elle-même dans son « auto-affection ».
Michel Henry évoque à juste titre le caractère abyssal de l’affirmation de Jean, qui introduit d’ailleurs un distinguo entre la chair et le corps. Par elle, s’énonce en effet une définition de l’homme entièrement nouvelle, définition qui fondera pour une bonne part la culture occidentale. « Car notre chair, écrit-il, n’est rien d’autre que cela qui, s’éprouvant, se subissant et se supportant soi-même et ainsi jouissant de soi selon des impressions toujours renaissantes, se trouve, pour cette raison, susceptible de sentir le corps qui lui est extérieur, de le toucher aussi bien que d’être touché par lui. » La parole johannique s’approche ainsi au plus près de la vie vivante qui, dans la chair, s’autorévèle en nous. C’est parce qu’il est chair lui-même que l’homme est en mesure de rencontrer la chair du monde et d’en jouir. « Il perçoit chacune de ses qualités, il voit les couleurs, entend les sons, respire une odeur, mesure du pied la dureté d’un sol, de la main la douceur d’une étoffe15. » En ce sens, l’incarnation rompt scandaleusement, en effet, autant avec la pensée grecque qu’avec le judaïsme. Elle est bien folie pour les païens et scandale pour les juifs. À ce titre, elle est fondatrice.
Dans la Grèce antique, la chair définissait l’animalité. C’est précisément parce qu’il est Logos, avant d’être chair, que l’homme se distinguait de l’animal. Pour Alcibiade (450-404 av. J.-C.), compagnon de Socrate, « l’homme n’est rien en dehors de son âme ». Se faire chair, c’est-à-dire devenir en soi-même chair (Michel Henry) revenait donc, pour les Grecs, à détruire la condition humaine et à régresser vers la pure animalité, ce qui est « folie ». On comprend mieux la scène décrite dans les Actes des Apôtres. Lorsque Paul évoque l’incarnation et la résurrection des corps devant les philosophes réunis sur l’Aréopage d’Athènes, ces derniers éclatent de rire et le congédient aussitôt : « Là-dessus, nous t’entendrons une autre fois. » (Actes 17,32.)
Pour la pensée juive, l’incarnation relève du blasphème. Qu’un simple humain, de chair et de sang comme Jésus, puisse prétendre incarner Dieu, avant de subir, comme un esclave, le supplice d’une crucifixion ignominieuse, voilà qui dépasse l’entendement. Pareil blasphème mérite la mort. Le refus horrifié des prêtres du Temple et des pharisiens est donc aussi absolu que celui des philosophes grecs, même si ce n’est pas pour les mêmes raisons. Les dernières paroles du Christ — « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ! » — expriment pourtant une incarnation acceptée jusqu’au bout, jusqu’à la souffrance du corps et à la morsure spécifiquement humaine du sentiment d’abandon.
Le corps, ainsi glorifié par le « scandale » de l’incarnation, est le lieu où tout se noue. Il n’est pas un simple amas de cellules ou de gènes, ni une « illusion » dont il faudrait se déprendre, il est une réalité à la fois souffrante et heureuse, hors de laquelle rien n’advient. L’humain est inscrit dans un corps de chair, au cœur du monde, et de cette chair sourd du désir, s’expriment du manque et un appel à l’altérité. Un professeur de théologie à l’université de Lausanne exprime bien cette centralité admirable du corps. « La chair dit, à sa manière, une vérité hors du monde ; elle a partie liée très concrètement avec ce qui, dans le monde et les corps vibre d’un ailleurs16. » On doit comprendre cet « ailleurs » non point comme une vague désignation du divin ou de la vie éternelle, mais comme une description précise de la vie elle-même, dans son immanence et sa surabondance. La Vie, ainsi comprise et nantie d’une majuscule, est une émergence profuse, une réalité océanique. Elle est la mystérieuse nappe phréatique où s’abreuvent « nos » vies.
De façon troublante, une féministe comme Judith Butler rejoint sans s’en rendre compte cette désignation heureuse de la vie vivante quand elle décrit cette dernière comme un « processus calme ». « Les vies déterminées, ajoute-t-elle, viennent à l’être et disparaissent mais la "Vie" semble être le nom du mouvement infini qui confère la forme et la dissout en général. Aucune vie déterminées n’épuise la Vie16. »
On ne saurait mieux dire. De cette vie vivante, en revanche, la science contemporaine n’a pas grand-chose à dire, et la technoscience encore moins. Ce n’est point parce qu’elle manque d’intelligence ou de cohérence, mais, tout simplement, parce que ce n’est pas son objet. Le grand biologiste qu’est le Prix Nobel François Jacob avait eu la modestie — et le courage — de le reconnaître dans un livre, La Logique du vivant, publié en 1972 : « On n’interroge plus la vie aujourd’hui dans les laboratoires. »
L’incarnation, qui n’appartient pas aux seuls chrétiens, redevient donc plus « scandaleuse » que jamais, au sens combatif du terme.
Jean-Claude Guillebaud, La vie vivante, contre les nouveaux moribonds.
Les Arênes, 2011
Chapitre 8 : La chair du monde
Notes
1. Albert Rouet, J’aimerais vous dire. Entretien avec Dennis Gira, Bayard, 2009, p. 107.
2. J’ai longuement développé ce débat théologique dans La Tyrannie du plaisir, op. cit.
3. John Boswell, Christianisme, tolérance sociale et homosexualité. Les homosexuels en Europe occidentale des débuts de l’ère chrétienne au XIVe siècle, Gallimard
4. Michel Onfray, Théorie du corps amoureux. Pour une érotique solaire, Grasset, 2000 ; rééd. Le Livre de Poche, 2001.
5. Charles Péguy, Note conjointe sur M. Descartes, in Œuvres en prose complètes, III, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, p. 1400.
6. Georges Bernanos, La Grande Peur des bien-pensants, Le Livre de Poche, 1998 [préface de Bernard Frank], p. 96.
7. Pierre Boudot, Au commencement était le Verbe, Grasset, 1980, p. 85.
8. Emmanuel Mounier, L’Affrontement chrétien, op.cit., p. 57.
9. Jacques Le Goff et Nicolas Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, Liana Lévi, 2006, p. 40.
10. Johan Huizinga, L’Automne du Moyen Âge [Harlem, 1919], trad. du hollandais par J. Bastin, © 1989, Éditions Payot, © 2002, Éditions Payot & Rivages, « Petite bibliothèque Payot », 2006.
11. Ibid., p. 49.
12. Ibid., p. 151.
13. David Cayley, « Présentation » in Ivan Illich et David Cayley, La Corruption du meilleur engendre le pire, Actes Sud, 2007, p. 75.
14. Michel Henry, Incarnation, Seuil, 2000, p. 8-9.
15. Pierre Gisel (dir.), Le Corps, lieu de ce qui nous arrive. Approches anthropologiques, philosophiques, théologiques, Labor et Fidès, 2008, p. 10.
16. Judith Butler, « Le corps de Hegel est-il en forme : quelle forme ? », in Judith Butler et Catherine Malabou, Sois mon corps, op. cit., p. 70.
----------------------------
00:26 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



















































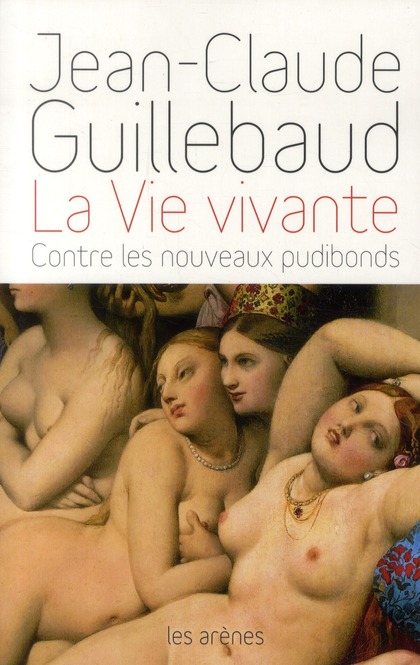

Les commentaires sont fermés.