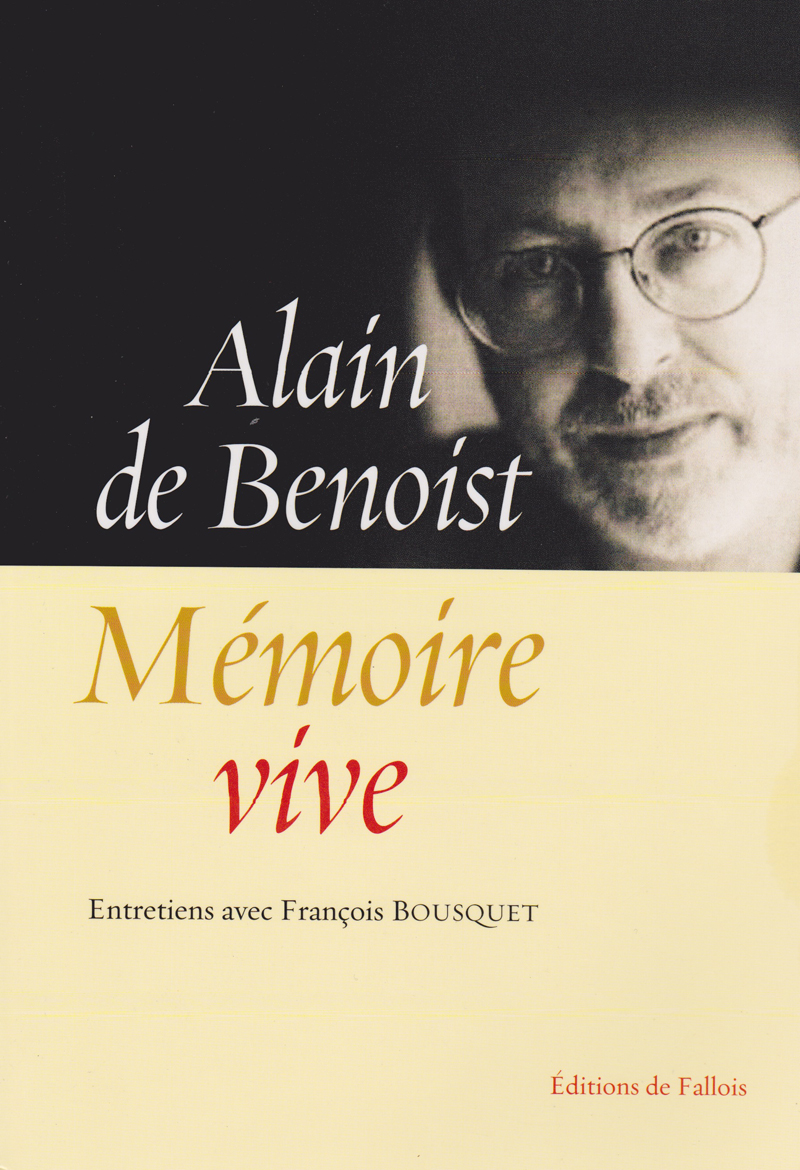17/12/2012
Le vrai héros s’amuse tout seul
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Mais le monde est fait de gens qui ne peuvent penser qu’en commun, en bandes. Il y a aussi des gens qui ne peuvent s’amuser qu’en troupe.
Le vrai héros s’amuse tout seul. »
Charles Baudelaire, Mon coeur mis à nu
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
16/12/2012
Les contradictions juridiques du "mariage pour tous"
=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=
A regarder jusqu'au bout... bien entendu...
Aude Mirkovic : Les contradictions juridiques du "mariage pour tous" 1/4
Aude Mirkovic : Les contradictions juridiques du "mariage pour tous" 2/4
Aude Mirkovic : Les contradictions juridiques du "mariage pour tous" 3/4
Aude Mirkovic : Les contradictions juridiques du "mariage pour tous" 3/4
00:16 Publié dans Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
15/12/2012
J'attends Dieu avec gourmandise
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute éternité. Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite; je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons; les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout ; boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, - comme faisaient ces chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'oeil furieux : sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or : je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé. »
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer
07:03 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
14/12/2012
Chaque époque, chaque culture, chaque tradition possède son ton
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Chaque époque, chaque culture, chaque tradition possède son ton. Elle a les douleurs et les atrocités, les beautés et les cruautés qui lui conviennent. Elle accepte certaines souffrances comme naturelles, s'accommode patiemment de certains maux. La vie humaine ne devient une vraie souffrance, un véritable enfer, que là où se chevauchent deux époques, deux cultures, deux religions. »
Hermann Hesse, Le loup des Steppes
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
13/12/2012
Le refus de sacrifier la réalité de sa propre existence à la conscience aliénée d'autrui
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Il y a honnêteté quand l'homme accepte le fait que l'irréel est irréel et ne peut avoir de valeur. Que ni l'amour, ni la gloire, ni l'argent n'ont de valeur lorsqu'ils ont été acquis par imposture. Que tout tentative d'acquérir une valeur par tromperie revient à mettre ceux que l'on dupe au dessus de la réalité, à se laisser manœuvrer par leur aveuglement, asservir par leur refus de penser et leur démission et, partant, à faire de leur intelligence, leur rationalité et leur perception des ennemis à redouter et à fuir. Qu'il est exclu de vivre dans la dépendance, ou comme une dupe dont le fonds de commerce serait les dupes qu'il a réussi à duper. L'honnêteté n'est ni un devoir social ni un sacrifice, mais la plus profondément égoïste des vertus que l'homme puisse pratiquer : le refus de sacrifier la réalité de sa propre existence à la conscience aliénée d'autrui. »
Ayn Rand, La Grève
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
12/12/2012
La tyrannie d'une hérédité
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Hérédité, milieu. Il existe sans doute peu d'alternatives aussi fécondes et lourdes de conséquences que celle-ci. Le débat est certes d'abord biologique. L'être vivant n'est en somme qu'une certaine formule héréditaire livrée durant toute son existance aux caresses et aux agressions des milieux qu'il traverse. (...)
La sagesse serait sans doute de désamorcer la polémique en posant par principe que l'homme se déduit à 100 % de son hérédité et à 100 % de son milieu. L'homme passse par l'homme, a écrit Pascal. Peut-être pourrait-on exprimer cette même idée par ces 200 % dont le paradoxe mesurerait la part de la liberté. (...)
Les parents fournissent à l'enfant aussi bien son hérédité que le milieu de ses premières années, exerçant ainsi sur lui une influence redoublée – pour le meilleur et pour le pire. Des parents anxieux lèguent à leurs enfants un naturel anxieux, mais en outre ils les font grandir dans l'atmosphère anxieuse qu'ils entretiennent dans la maison. Cette duplication du poids des parents sur les enfants, désastreuse dans le cas de l'alcoolisme par exemple, devient au contraire bénéfique dans celui d'une famille toute entière douée pour la musique. Mais pour une famille de musiciens, combien il y a-t-il d'alcooliques ? (...)
Il n'empêche que la sujétion de l'homme à son milieu paraît beaucoup moins pesante que la tyrannie d'une hérédité. On peut changer le milieu où l'on vit, on peut aussi changer de milieu, mais qui brisera jamais la courbure d'une hérédité, ce dessin tatoué au plus intime de la cellule vivante ? »
Michel Tournier, Le Vent Paraclet
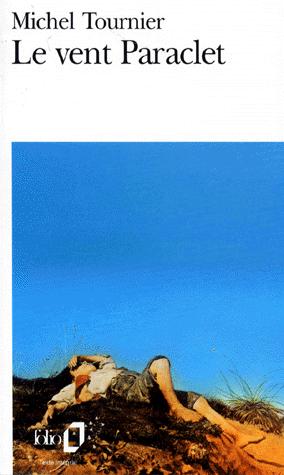
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
11/12/2012
Je ne collabore pas avec la police
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« -- Le 6 février 1993, j’avais été invité à Berlin par une association culturelle libérale de gauche intitulée « Kunst und Kultur », à participer à un débat sur l’immigration qui devait initialement se tenir dans les locaux de l’Université Humboldt. Ma communication s’intitulait : « Contre le racisme et la xénophobie, pour le respect de l’identité des peuples ». Avant même que le débat ne commence, j’ai été littéralement enlevé par une trentaine de jeunes « antifas » vêtus de noir, qui m’ont porté dans la rue et m’ont roué de coups quelques centaines de mètres plus loin. Lorsque mes agresseurs se furent dispersés, je suis rentré à pieds à mon hôtel, lunettes cassées et visage couvert de sang. A peine y étais-je arrivé qu’un groupe de policiers de la Kripo, alertés par les organisateurs, a fait irruption dans ma chambre, mitraillette à la main. J’ai été conduit au siège de la Staatsschutzpolizei de Berlin-Tempelhof où, jusqu’à cinq heures du matin, les policiers m’ont présenté des fichiers photographiques où pouvaient figurer certains de mes agresseurs. J’en ai en effet reconnu plusieurs, mais je n’ai évidemment rien dit.
-- Pourquoi donc ?
-- Je ne collabore pas avec la police. »
Alain de Benoist, Mémoire Vive, entretiens avec François Bousquet
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
10/12/2012
Celui qui vaut moins ne peut que gagner à s'approcher de celui qui vaut plus
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Les écrivains de l'orthodoxie démocratique ressentent de la honte lorsqu'ils lisent que Cervantès se désignait lui-même comme le serviteur du comte de Lemos. Avec le manque de sens historique qui leur est coutumier, ils croient ce terme humiliant pour leur confrérie. Il évoque pourtant une des institutions les plus belles et les plus nobles que les châteaux aient engendrées. Le mot serviteur est aujourd'hui incompréhensible. Qu'un homme soit au service d'un autre homme est considéré comme une situation inférieure, avilissante. C'est que règne une fable convenue, selon laquelle nous sommes tous égaux. Imaginons un instant le contraire. Imaginons que les hommes soient constitutivement inégaux, que les uns (la minorité), vaillent davantage. Tout change aussitôt. Il est aussitôt évident que celui qui vaut moins ne peut que gagner à s'approcher de celui qui vaut plus. C'est pourquoi, au Moyen Âge, se mettre au service d'un autre homme était le plus souvent s'élever et non s'abaisser. »
José Ortega y Gasset, La Castille et ses châteaux
13:37 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La stérilité et la mort
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le goût de la possession est à ce point insatiable qu’il peut survivre à l’amour même. Aimer alors, c’est stériliser l’aimé. La honteuse souffrance de l’amant, désormais solitaire, n’est point tant de ne plus être aimé, que de savoir que l’autre peut et doit aimer encore. A la limite, tout homme dévoré par le désir éperdu de durer et de posséder souhaite aux êtres qu’il a aimés la stérilité ou la mort. »
Albert Camus, L’homme révolté

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
09/12/2012
Profondément conscient de lui-même, radicalement étranger aux autres, terrorisé par l’idée de la mort
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le but de la fête est de nous faire oublier que nous sommes solitaires, misérables et promis à la mort ; autrement dit, de nous transformer en animaux. C’est pourquoi le primitif a un sens de la fête très développé. Une bonne flambée de plantes hallucinogènes, trois tambourins et le tour est joué : un rien l’amuse. A l’opposé, l’Occidental moyen n’aboutit à une extase insuffisante qu’à l’issue de raves interminables dont il ressort sourd et drogué : il n’a pas du tout le sens de la fête. Profondément conscient de lui-même, radicalement étranger aux autres, terrorisé par l’idée de la mort, il est bien incapable d’accéder à une quelconque exaltation. Cependant, il s’obstine. La perte de sa condition animale l’attriste, il en conçoit honte et dépit ; il aimerait être un fêtard, ou du moins passer pour tel. Il est dans une sale situation. »
Michel Houellebecq, Rester vivant
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
08/12/2012
Notre Dieu est venu au-devant
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Madame, lui dis-je, si notre Dieu était celui des païens ou des philosophes (pour moi, c'est la même chose) il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux, notre misère l'en précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing, lui cracher au visage, le fouetter de verges et finalement le clouer sur un croix, qu'importe? Cela est déjà fait ma fille... »
Georges Bernanos, Le journal d'un curé de campagne
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
07/12/2012
C’est ainsi que l’on écrit l’histoire selon la formule
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Nous savions également pour en revenir au Chili, que depuis deux ou trois ans, ça n’allait pas économiquement, c’était la déroute : ménagères en révolte allant jusqu’à prier les soldats de renverser le gouvernement d’Allende, transporteurs et camionneurs en grève, paysans et une grande partie des ouvriers mécontents, etc. Tout cela est oublié. Ce n’est plus la faute de faillite économique, ce n’est plus le mécontentement général ou majoritaire de la population qui a provoqué, la chute du régime. On a oublié. Maintenant c’est la faute de la réaction et des Américains, nous dit-on. C’est ainsi que l’on écrit l’histoire selon la formule.
Le Figaro, Septembre 1973 »
Eugène Ionesco, Antidotes
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
06/12/2012
Sur le chemin je savais qu’il y aurait des filles, des visions, tout, quoi...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
Neal Cassidy & Jack Kerouac
« Un gars de l’Ouest, de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j’aurais avec lui, j’allais entendre l’appel d’une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse ; et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain, et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur le trottoir ou sur un lit d’hôpital, qu’est ce que cela pouvait me foutre ? J’étais un jeune écrivain et je me sentais des ailes.
Quelque part sur le chemin je savais qu’il y aurait des filles, des visions, tout, quoi ; quelque part sur le chemin on me tendrait la perle rare. »
Jack Kerouac, Sur la route
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
05/12/2012
Tout ça me plaisait dans une dimension inquiétante
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ce n’était plus la guerre fantomatique à quoi, depuis mon arrivée à Beyrouth, je m’étais habitué et qui ne venait pas ; ce n’était plus du roman devenu vague rêverie au fond de l’ennui ; c’était l’essence même de toute littérature : la guerre, violente, exigeante, dangereuse, enivrante, aussi, car j’y ai retrouvé les gestes qui étaient les miens, enfant dans les bois de Siom, quand je jouais à la guerre et que je mourais ou tuais avec une ivresse qui me laissait croire que j’étais la proie d’autre chose que de la fièvre du jeu.
Mais à Beyrouth, cette nuit-là, au premier étage du magasin que nous devions tenir, dans le bruit des armes, les éclats, l’odeur de poudre, d’huile et de métal chaud, je sentais les autres miliciens bien plus proches de moi que mes anciens compagnons de jeu.
Tout ça me plaisait dans une dimension inquiétante, voire terrifiante du plaisir : celle qu’on connaît dans les très grandes amours. »
Richard Millet, La confession négative
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
04/12/2012
Le laboureur revient toujours
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Kirchhorst, 2 mai 1945.(...)
Le labeur, le souci de petites choses ne crée pas seulement un contrepoids à l’illusoire, mais aide aussi à préserver la dignité, ou à la rétablir lorsqu’on lui a fait atteinte. Plus la panique croît, et plus on se réjouit d’apercevoir l’homme qui ne fait pas de l’épouvante plus de cas qu’elle ne mérite, et lui refuse ses courbettes – à une époque d’athéisme, cela ne devient pas plus facile, mais plus dur.
Dans mon enfance, j’avais à peine appris à lire, une histoire de la guerre des Boxers me fit grande impression. Si je m’en souviens bien, c’était un officier de l’Etat-major de Waldersee qui racontait une exécution d’otage chinois en train de lire un livre. Ce spectacle l’émut, et il demanda au responsable de l’exécution la vie sauve pour cet homme ; il l’obtint. Il fit part au lecteur de cette mesure de grâce. Le Chinois le remercia courtoisement, mit son livre dans sa poche et quitta le lieu des supplices, qui poursuivirent leur cours. Je me demandai, plus tard : que pouvait-il bien lire ? Il faudrait connaître ce texte. Aujourd’hui, je pourrais concevoir qu’il ait lu un chapitre du Kin-Ping-Meh, ou un manuel de culture des lis. Celui qui sait se reconnaît non à la matière, mais au fait de son savoir. C’est là ce qu’il faut mettre à l’épreuve : il existe des prières creuses, comme il existe un sourire qui convainc.
Les paysans ont repris le chemin de leurs champs, bien qu’ils aient des bandes de fêtards installées chez eux. La récolte est incertaine. Mais le paysan qui laboure en suivant ses chevaux, tandis que les armées passent sur les routes, offre une image imposante de cette continuité, de cette permanence de l’effort humain, si souvent déçue, et qui pourtant est plus importante, plus riche de consolations, plus profondément enracinée que son progrès, qui, bien plutôt, s’en éloigne. Le laboureur revient toujours ; je l’ai vu à l’œuvre durant notre offensive en France, et l’on dit qu’il traçait ses sillons à Waterloo, entre les armées qui se déployaient l’une contre l’autre. »
Ernst Jünger, Tome IV du Journal de Ernst Jünger : "La Cabane dans la vigne", consacré à la période 1945-1948, qui englobe les années d’occupation américaine en Allemagne
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
03/12/2012
L'égalité entre les hommes
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« L'axiome d'un Anglo-Saxon concernant l'égalité entre les hommes me revint en mémoire. Il la cherche, non pas dans la répartition sans cesse changeante de la puissance et des moyens d'agir, mais dans le fait constant que chacun peut tuer chacun des autres. »
Ernst Jünger, Eumeswil

17:45 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sens du tragique
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La morale, l'instinct, et la pure et simple chute des corps règlent notre action. Nos cellules sont composées de molécules, et celles-ci d'atomes. »
Ernst Jünger, Eumeswil

14:37 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Flicaille...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Il est vrai que notre lagune saumâtre grouille d'une flicaille intellectuelle particulièrement nauséabonde. »
Ernst Jünger, Eumeswil

10:24 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Navire de guerre
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« On devrait vivre comme un navire, ayant à son bord tout ce qu'il y a de nécessaire, et toujours prêt au combat. »
Ernst Jünger, Jeux Africains
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
02/12/2012
Ses règles sont continues et toujours nettes
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ses règles sont continues et toujours nettes. L’argent s’attire lui-même, cherche à s’agglomérer aux mêmes endroits, va de préférence aux scélérats et aux médiocres ; puis, lorsque par une inscrutable exception, il s’entasse chez un riche dont l’âme n’est ni meurtrière, ni abjecte, alors il demeure stérile, incapable de se résoudre en un bien intelligent, inapte même entre des mains charitables à atteindre un but qui soit élevé. On dirait qu’il se venge ainsi de sa fausse destination, qu’il se paralyse volontairement, quand il n’appartient ni aux derniers des aigrefins, ni aux plus repoussants des mufles.
Il est plus singulier encore quand, par extraordinaire, il s’égare dans la maison d’un pauvre ; alors il le salit immédiatement s’il est propre ; il rend lubrique l’indigent le plus chaste, agit du même coup sur le corps et sur l’âme, suggère ensuite à son possesseur un bas égoïsme, un ignoble orgueil, lui insinue de dépenser son argent pour lui seul, fait du plus humble un laquais insolent, du plus généreux, un ladre. Il change, en une seconde, toutes les habitudes, bouleverse toutes les idées, métamorphose les passions les plus têtues, en un clin d’œil.
Il est l’aliment le plus nutritif des importants péchés et il en est, en quelque sorte aussi, le vigilant comptable. S’il permet à un détenteur de s’oublier, de faire l’aumône, d’obliger un pauvre, aussitôt il suscite la haine du bienfait à ce pauvre ; il remplace l’avarice par l’ingratitude, rétablit l’équilibre, si bien que le compte se balance, qu’il n’y a pas un péché de commis en moins.
Mais où il devient vraiment monstrueux, c’est lorsque, cachant l’éclat de son nom sous le voile noir d’un mot, il s’intitule le capital. Alors son action ne se limite plus à des incitations individuelles, à des conseils de vols et de meurtres, mais elle s’étend à l’humanité tout entière. D’un mot le capital décide les monopoles, édifie les banques, accapare les substances, dispose de la vie, peut, s’il le veut, faire mourir de faim des milliers d’êtres ! »
Joris-Karl Huysmans, Là-bas
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
01/12/2012
La seule logique de notre monde...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« La disparition de toute hiérarchie supérieure à celle de l’argent et, par conséquent, de tout pouvoir supérieur à celui de l’argent, fait peser de tout leur poids sur nos têtes les nécessité de l’économie. Celles-ci se développent comme une logique propre qui tend à devenir la seule logique de notre monde. Elle étend sur nous ses impératifs auxquels nous sommes en réalité étrangers et nous les impose comme les lois de notre propre vie. Nous marchons comme des forçats sur les berges du beau fleuve Vendre-Vendre-Vendre le long duquel nous halons le bateau des prêteurs. Les yeux fixés sur la balance des exportations, sur les cadrans de la circulation monétaire, les ingénieurs ajustent et généralement raccourcissent la longe qui nous permet nos propres mouvements. Au-dessus d’eux, point de princes, point de fouets qui tournoient. Ils calculent, pilotent, répartissent. Ils gardent pour eux quelques rares clous d’or et nous distribuent des billes d’agates que nous appelons nos joies et nos libertés. »
Maurice Bardèche, Sparte et les sudistes
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
30/11/2012
La "pauv’ fille" au grand cœur qui aura inspiré tant de chansons d’amour
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« La prostitution. Ce mot-là à lui tout seul vaut son pesant de préservatifs. Il fait vendre les journaux et frétiller les "ratés de la bagatelle", comme le chantait si drôlement Patachou. "Le Nouvel Observateur" dénonce cette semaine "les nouvelles filières de la prostitution", ça ne mange pas de pain et ça plaît toujours. On se doutait bien que les choses n’allaient pas être simples à régler et l’angélisme du ministre nous amuse beaucoup. Nicolas Sarkozy aura beau faire le malin, il ne parviendra pas mieux que ses prédécesseurs à nettoyer les trottoirs, à "interdire la prostitution". Quelle drôle d’idée ! On l’a connu mieux inspiré, le cher Nicolas. Qu’il passe par les armes tous les proxénètes qui lui tomberont sous la main, nous ne demandons pas mieux. Pour le reste, qu’il se calme.
Interdire la prostitution, et pourquoi donc ? Il faut la légaliser au contraire, rouvrir les maisons closes de si belle mémoire. La "pauv’ fille" au grand cœur qui aura inspiré tant de chansons d’amour, de romans, de films, de fantasmes, il faut la mettre en maison, à l’abri des salopards qui la massacrent. Il faut nous garder les filles au chaud pour soigner nos cœurs blessés.
Il faut rouvrir d’urgence les maisons closes. Dans un même élan de générosité et d’amour, il faudrait rouvrir aussi les maisons de correction où l’on dressait si bien les mauvais garçons à coups de trique. Le bon temps que celui-là du tapin tranquille. On peut faire confiance à Genet. Il faut rouvrir les maisons de correction. Si l’on manque d’argent, on pourrait fermer les maisons de la culture où l’on joue des pantalonnades subventionnées par nous, où des troupes de gugusses intouchables se payent notre tête à nos frais. »
Pascal Sevran, Le privilège des Jonquilles
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
29/11/2012
J’ai le droit d’exiger l’obéissance parce que mes ordres sont raisonnables
=--=Publié dans la Catégorie "Citadelle : Saint-Exupéry"=--=

« — Je voudrais voir un coucher de soleil… Faites-moi plaisir… Ordonnez au soleil de se coucher...
— Si j’ordonnais, dit le Roi, à un général de voler d’une fleur à l’autre à la façon d’un papillon, ou d’écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n’exécutait pas l’ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort ?
— Ce serait vous, dit fermement le petit prince.
— Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L’autorité repose d’abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d’aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J’ai le droit d’exiger l’obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. »
Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince
07:00 Publié dans Citadelle : Saint-Exupéry | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
28/11/2012
Il habite avec nonchalance le pays des morts
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Mercredi 21 septembre 2011 : J’ai beau me saouler de travail et ne sortir pratiquement pas de cette bibliothèque, je bois à grandes lampées l’élixir de septembre, qui d’ailleurs n’est nulle part si enivrant qu’entre ces pans de livres. Les Pyrénées complaisantes, pour la première fois de la saison, sont apparues dans le soleil au-dessus de la canopée, comme en hiver. Pourtant nous sommes encore en été, je crois bien. Le matin semblait le penser aussi, sans y tenir plus que cela. C’est cela, l’enchantement de septembre : il n’y tient pas. Creusé qu’il est du temps qui fut (weather aussi bien que time), il habite avec nonchalance le pays des morts. Je regrette de m’être laissé influencer une ou deux fois déjà, jadis et naguère, par mon entourage qui a poussé les hauts cris à l’idée d’un volume de ce journal qui se serait appelé Septembre absolu. C’est pourtant bien de cela qu’il s’agit. Toute la journée s’est écoulée dans la splendeur discrète de ce mois détaché des choses, tranquillement revenu de tout, et qui n’en fait pas une affaire. Entré sans manières par les fenêtres, il prenait ses aises entre les rayonnages, dans les fauteuils, sur les tapis, jusqu’entre les dalles de notre carrelage décrié. Nous vivons sans doute les dernières heures de l’absolutisme. C’est aussi ce qui le rend irrésistible. »
Renaud Camus, Septembre absolu
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
27/11/2012
Tristes vies de cons
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Si les gens vivent leurs tristes vies de cons dans ces mornes pays de cons, c’est parce qu’ils ont la trouille. Il leur faut la Sécurité, le Confort et la Dignité. Voilà ce que je pensais. Ils n’aiment pas se fatiguer, ils bouffent comme des vaches, ils boivent l’apéro, ils discutent de conneries à perte de vue, ils jouent aux courses, ils s’intéressent au football, ils prennent du bide sans se dégoûter d’eux-mêmes, ils s’en foutent d’être moches répugnants mous dégueulasses pourvu qu’ils aient une cravate, de se faire chier dix heures par jour et toute la semaine et toute la vie pourvu qu’ils aient la paye et le cinoche avec Maimaire le samedi. »
François Cavanna, Les Ritals
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook