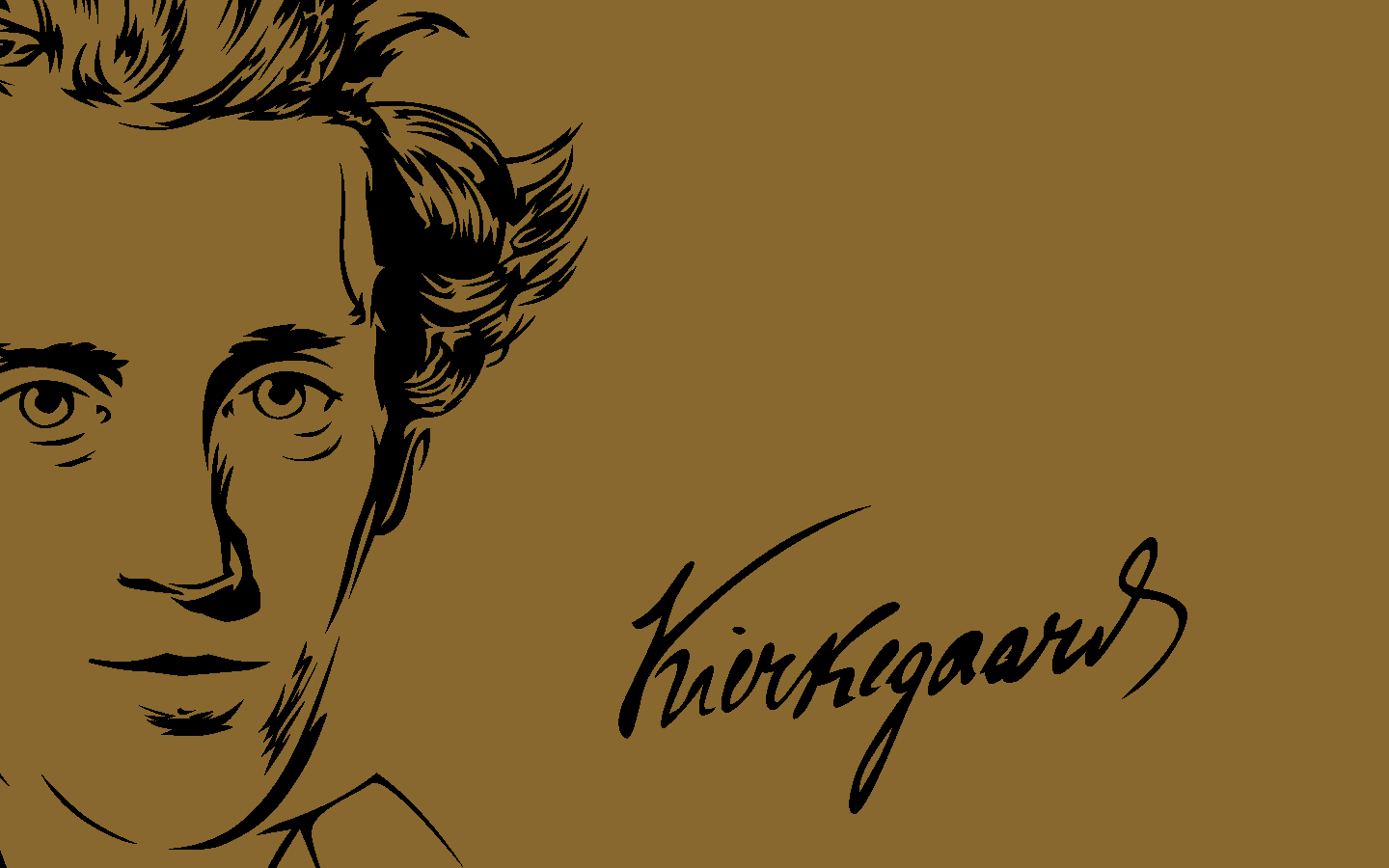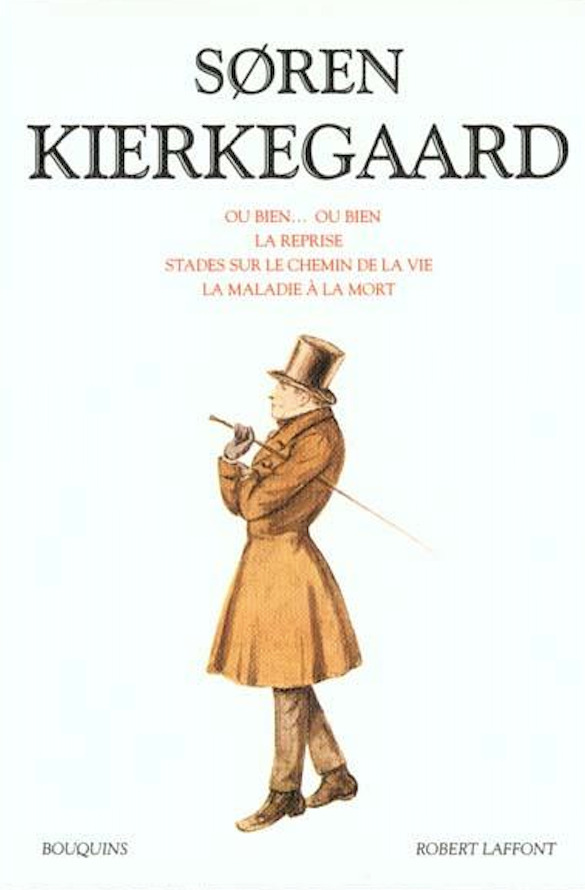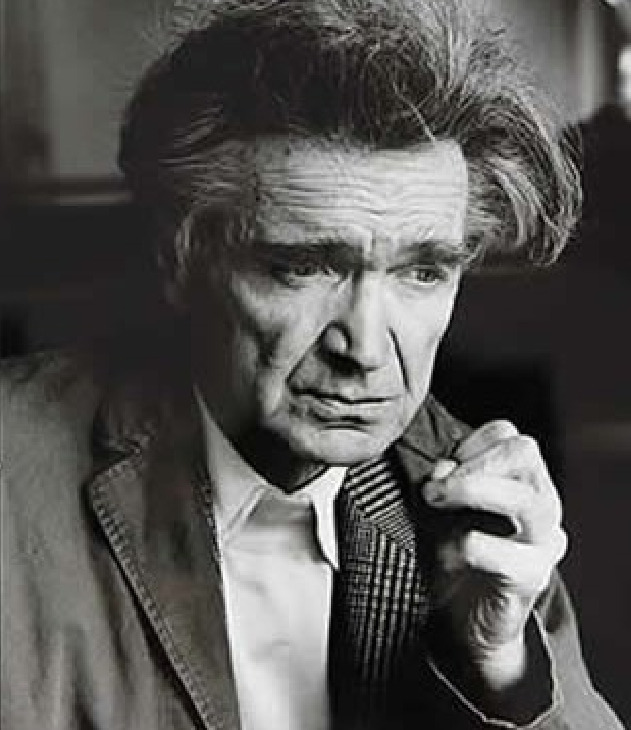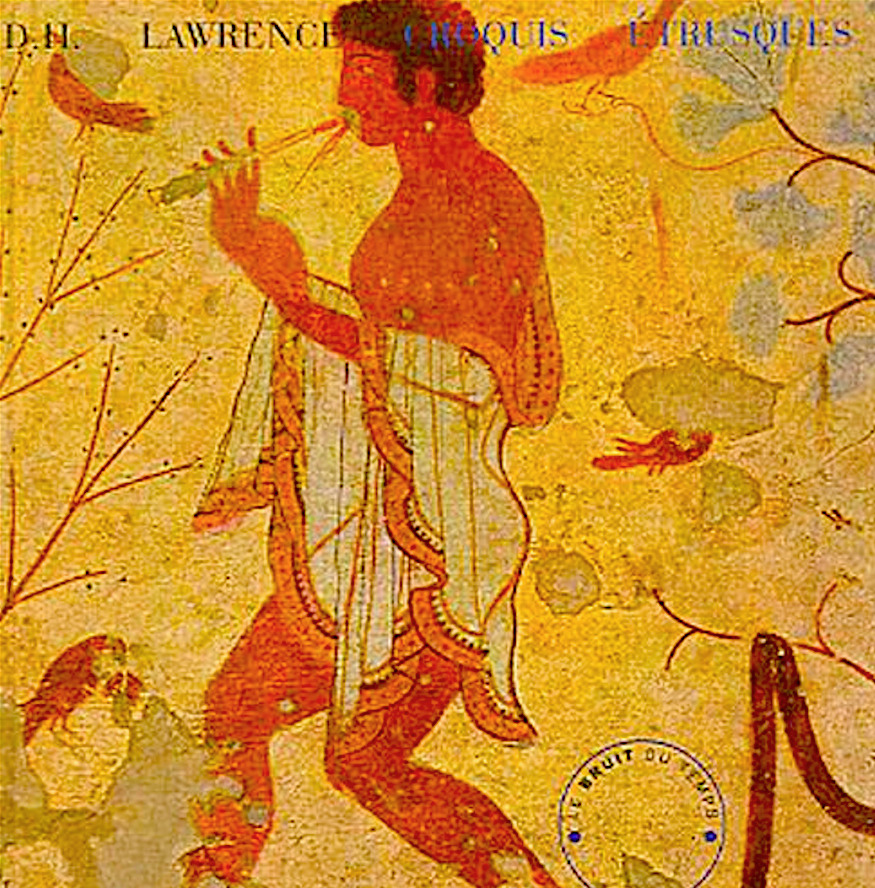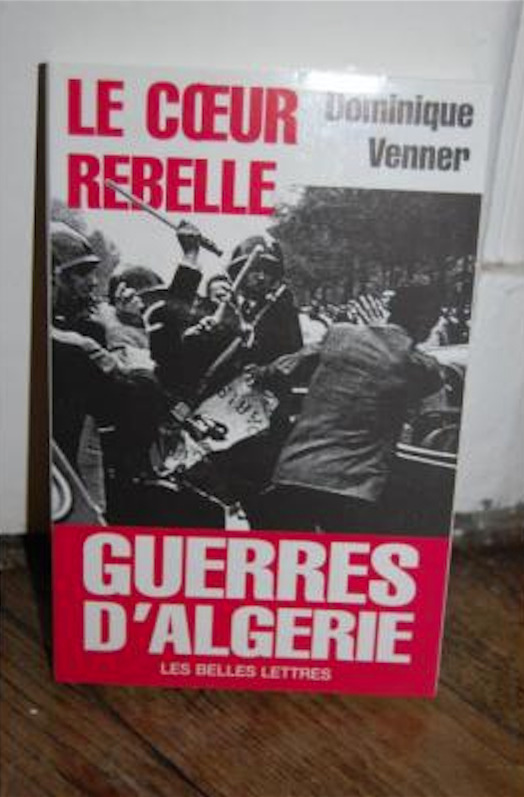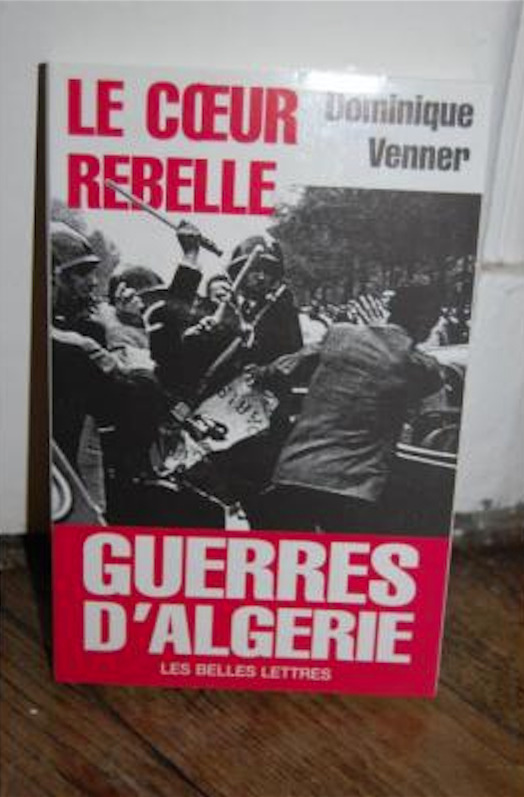26/05/2014
Sans doute ai-je insulté mon pays plus qu’un autre. Plus qu’un autre, il m’a déçu.
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ça commence par un petit garçon plutôt blond qui laisse aller ses sentiments. Le visage de Marlène Dietrich, plein de sperme, s’étale devant lui. Sur le magazine grand ouvert, le long des jambes de l’actrice, des filets nacrés s’entrelacent comme la hongroise d’argent sur le calot d’un hussard. »
« Devant mes yeux dansaient les images des dernières années de la France. Je venais d’avoir vingt ans, ça c’est une vérité. Cet âge ment sans arrêt. Sans doute ai-je insulté mon pays plus qu’un autre. Plus qu’un autre, il m’a déçu. »
Roger Nimier, Les épées
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
25/05/2014
Cette vie est le monde renversé ; elle est cruelle et insupportable...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ma façon d'envisager la vie est complètement absurde. Un esprit méchant, je suppose, a mis sur mon nez une paire de lunettes dont un verre grossi démesurément et dont l'autre rapetisse dans les mêmes proportions. »
« Que va-t-il arriver ? Que réserve l'avenir ? Je l'ignore, je n'ai aucun pressentiment. Quand, d'un point fixe, une araignée se précipite et s'abandonne aux conséquences, elle voit toujours devant elle un espace vide où, malgré ses bonds, elle ne peut se poser. Ainsi de moi ; devant moi, toujours un espace vide ; ce qui me pousse en avant, c'est une conséquence située derrière moi. Cette vie est le monde renversé ; elle est cruelle et insupportable. »
Søren Kierkegaard, Ou bien... ou bien
16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
J'ai grand faim
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« La patience indispensable pour vivre me fait défaut. Je ne puis voir l'herbe pousser et, dès lors, je n'ai pas la moindre envie d'y jeter les yeux. Mes vues sont fugitives comme celles d'un "fahrender Scholastiker" [étudiant ambulant] qui se précipite à toute allure à travers la vie. Dieu, dit-on, rassasie l'estomac avant les yeux, mais je ne m'en aperçois pas : mes yeux sont rassasiés et las de tout, et cependant, j'ai grand faim. »
Søren Kierkegaard, Ou bien... ou bien
14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les pensées des hommes sont ténues et fragiles comme des dentelles
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Laissons les autres se lamenter sur ces temps mauvais ; je me plains de leur misère, car ils sont dénués de passion. Les pensées des hommes sont ténues et fragiles comme des dentelles ; ils sont eux-mêmes pitoyables comme des dentellières. Les pensées de leur cœur sont trop misérables pour être coupables. Ce serait peut-être un péché pour un ver de terre d'en nourrir de pareilles, mais tel n'est pas le cas pour des hommes créés à l'image de Dieu. Ils sont tièdes et modérés dans leurs plaisirs, endormis dans leurs passions ; elles accomplissent leurs devoirs, ces âmes mercenaires, mais elles se permettent pourtant comme les Juifs de rogner un peu la monnaie ; elles pensent que si Dieu tient en ordre ses registres, on peut quand même tricher un peu et s'en tirer. Fi, les vilaines gens ! Aussi bien mon âme revient-elle toujours à l'Ancien Testament et à Shakespeare. Ici, du moins, on sent que ce sont des hommes qui parlent ; ici, on sait haïr, on sait aimer, tuer son ennemi, maudire sa descendance à perpétuité ; ici, on sait pécher. »
Søren Kierkegaard, Ou bien... ou bien
12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Chez les Grecs, la sensualité n'était pas un ennemi à subjuguer, un dangereux rebelle à réduire
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« La sensualité a donc été auparavant de fait dans le monde, mais sans être déterminée par l'esprit. Comment était-elle donc alors ? Elle était sous la détermination de l'âme dont elle relevait. C'est ainsi qu'elle se présentait dans le paganisme et, si l'on en cherche l'expression la plus parfaite, c'est ainsi qu'elle était en Grèce. Mais la sensualité relevant de l'âme n'est pas opposition, exclusion : elle est accord, harmonie. Et du fait même qu'elle est posée comme harmonieuse, elle ne l'est pas comme principe, mais comme encliticon d'accompagnement.
Ces vues auront leur importance pour éclairer les diverses formes de l'éros aux stades successifs de l'histoire ; elles nous amèneront ainsi à poser l'éros immédiat et l'éros musical comme identiques. Chez les Grecs, la sensualité était maîtrisée dans l'individualité harmonieuse, ou plutôt, elle ne l'était pas ; en effet, elle n'était pas un ennemi à subjuguer, un dangereux rebelle à réduire ; libre d'entraves, elle se livrait à la vie et à la joie chez l'homme harmonieusement épanoui. Elle n'était donc pas posée comme principe ; l'âme, en tant qu'élément de l'individualité harmonieuse, était inconcevable sans le sensuel et, pour cette raison, l'éros fondé sur le sensuel n'était pas non plus posé comme principe. L'amour était un facteur universel, à ce titre donné dans la belle individualité. Non moins que les hommes, les dieux connaissaient sa puissance et avaient des aventures d'amour heureux ou malheureux. Mais chez aucun d'eux l'amour n'était posé comme principe ; s'il s'y trouvait, individuellement, c'était comme manifestation partielle de sa puissance universelle, laquelle, cependant, ne résidait nulle part ni, par conséquent, dans la conscience des Grecs ou dans le monde de leurs idées. Mais, sans tenir compte du fait qu'ici encore, l'amour ne se fonde pas sur l'éros basé sur la seule sensualité, mais sur l'âme, il convient de relever une autre particularité que je vais quelque peu mettre en relief. Éros était le dieu de l'amour, mais sans être lui-même épris. Si les autres dieux ou les hommes décelaient en eux sa puissance, ils la lui attribuaient, la lui rapportaient, mais Éros même y restait étranger ; si la chose lui arriva une fois, ce fut une exception ; et bien que dieu de l'amour, il n'eut pas, à beaucoup près, le nombre d'aventures que connurent les autres dieux ou les hommes. Et s'il fut épris, cela dénote avant tout que lui aussi s'inclinait devant la puissance universelle de l'amour, de la sorte à lui étrangère, en un sens : rejetée hors de lui, elle n'avait plus aucun lieu où l'on pût la chercher. Son amour n'est pas non plus fondé sur les sens, mais sur l'âme. Et elle est bien authentiquement grecque, cette idée que le dieu de l'amour n'est pas lui-même épris, alors que tous les autres lui doivent de l'être. Si j'imagine un dieu ou une déesse du désir, je serais fidèle à la pensée grecque en disant que, tandis que tous ceux qui connaîtraient la douce inquiétude ou la douleur du désir en rapporteraient les effets à cette divinité, celle-ci n'éprouverait elle-même aucun désir. Je ne saurais mieux caractériser cette particularité qu'en y voyant le contraire du fait où un individu en représente d'autres : ici, toute la force est rassemblée en une seule personne ; les autres y participent dans la mesure où elles sont liées aux diverses opérations de cette personne. Je pourrais dire encore que cette situation est l'inverse de celle qui est à la base de l'incarnation où l'individu renferme en lui toute la plénitude de vie, laquelle n'a de réalité pour les autres que dans leur contemplation de cet individu incarné. Dans l'hellénisme, c'est donc l'inverse. Ce qui fait la force du dieu n'est pas en lui, mais dans tous les autres individus qui lui rapportent ; il est lui-même pour ainsi dire dénué de force, impuissant, parce qu'il communique sa force à tout le reste du monde. L'individu incarné absorbe en quelque sorte la force de tous les autres dans la mesure seulement où ils la voient en cet individu. Ces vues auront leur importance dans la suite, comme elles ont leur valeur intrinsèque touchant les catégories en usage aux diverses périodes de l'histoire. Nous ne trouvons donc pas dans l'hellénisme la sensualité ; et quand bien même nous l'y aurions trouvé, nous voyons cependant – fait de la plus grande importance pour cette étude – que l'hellénisme n'a pas la force de concentrer la plénitude en un seul individu ; elle la fait rayonner d'un point qui ne la possède pas à tous les autres, de sorte que ce point constitutif se reconnaît presque au fait qu'il est le seul à ne pas avoir ce qu'il donne à tous les autres. »
Søren Kierkegaard, Ou bien... ou bien
10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
S'abstenir de toute intempestive considération
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Il faut vraiment beaucoup de naïveté pour croire à l'utilité de crier et de vociférer dans le monde, comme si notre destin en était changé. Il suffit de l'accepter tel qu'il se présente et de s'abstenir de toute intempestive considération. Dans ma jeunesse, quand j'allais au restaurant, moi aussi je disais au garçon : un bon morceau, du meilleur dans le filet, pas trop gras. Le garçon, sans doute, n'entendait guère ma recommandation ; encore moins y faisait-il attention ; encore moins ma voix parvenait-elle à la cuisine pour attendrir le découpeur. Et même si tout cela se réalisait, il n'y avait peut-être pas un bon morceau dans tout le rôti. Maintenait, je ne crie plus jamais. »
Søren Kierkegaard, Ou bien... ou bien
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
24/05/2014
Une plaisanterie
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le feu prit un jour dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On crut à un mot plaisant et l'on applaudit ; il répéta, les applaudissements redoublèrent. C'est ainsi, je pense, que le monde périra : dans l’allégresse générale des gens spirituels persuadés qu’il s’agit d’une plaisanterie. »
Søren Kierkegaard, Ou bien... ou bien
16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La société qui peut lire son avenir dans son passé est une société en repos
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Comme l’a souligné Marcel Conche, la société qui peut lire son avenir dans son passé est une société en repos, sans inquiétude. Sur cette permanence se fonde le sentiment de sécurité. Au contraire, les nouveautés, le “progrès” apporteront le trouble. À partir du moment où l’on rêve de cité idéale et de lendemains meilleurs, se trouve tué en chacun le contentement. Dès lors, domine le mécontentement de soi et du monde. Ce qui est figuré sur le bouclier d’Achille est au contraire une société heureuse, tout à la joie de vivre comme elle a toujours vécu. Les noces sont joyeuses, l’équité règne, l’amitié civique est générale. Quand la guerre survient, la cité attaquée fait front, tout le peuple se porte sur les remparts, l’ennemi n’a pas d’allié dans la place. »
Dominique Venner, Un Samouraï d’Occident
14:37 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Mourir sans avoir rien à quitter !
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Au jugement dernier on ne pèsera que les larmes. »
« Certains se demandent encore si la vie a un sens ou non. Ce qui revient en réalité à s’interroger si elle est supportable ou pas. Là s’arrêtent les problèmes et commencent les résolutions. »
« La mort n’a de sens que pour ceux qui ont aimé la vie passionnément. Mourir sans avoir rien à quitter ! Le détachement est négation de la vie comme de la mort. Celui qui a vaincu la peur de mourir a triomphé aussi de la vie, elle qui n’est que l’autre nom de cette peur. »
Emil Michel Cioran, Des larmes et des saints
12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le manque d’éducation dans le choix de ses tristesses
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Être incapable de résister à soi-même, voilà où aboutit le manque d’éducation dans le choix de ses tristesses. »
« Nous portons en nous toute la musique : elle gît dans les couches profondes du souvenir. Tout ce qui est musical est affaire de réminiscence. Du temps où nous n’avions pas de nom, nous avons dû tout entendre. »
« Aurai-je assez de musique en moi pour ne jamais disparaître ? »
Emil Michel Cioran, Des larmes et des saints
10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le chemin vers cet état d’éveil où palpite la conscience aiguisée
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Les peuples ne sont pas initiés aux cosmogonies, ni ne se voient révéler le chemin vers cet état d’éveil où palpite la conscience aiguisée. Quoi que vous puissiez faire, jamais la masse des hommes n’atteindra cette vibration de la pleine conscience. Il ne leur est pas possible d’aller au-delà d’un soupçon de conscience. En foi de quoi il faut leur donner des symboles, des rituels et des signes qui empliront leur corps de vie jusqu’à la mesure qu’ils peuvent contenir. Plus leur serait fatal. C’est la raison pour laquelle il convient de les tenir à l’écart du vrai savoir, de crainte que, connaissant les formules sans jamais avoir traversé les expériences qui y correspondent, ils deviennent insolents et impies, croyant avoir atteint le grand tout quand ils ne maîtrisent en réalité qu’un verbiage creux. La connaissance ésotérique sera toujours ésotérique, car la connaissance est une expérience, non une formule. Par ailleurs, il est stupide de galvauder les formules. Même un petit savoir est chose dangereuse. Aucune époque ne l’a mieux montré que la nôtre. Le verbiage est, en définitive, ce qu’il y a de plus désastreux. »
David Herbert Lawrence, Croquis Etrusques
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
23/05/2014
Le lignage, la langue, la religion, la coutume
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Toujours, les hommes se sont posé la question entre toutes fondamentale de ce qu’ils sont. Ils y répondent en invoquant le lignage, la langue, la religion, la coutume, c’est-à-dire leur identité, leur tradition (...) Il n’y a que des hommes concrets, fils d’une hérédité, d’une terre, d’une époque, d’une culture, d’une histoire, d’une tradition qui forment la trame de leur destin.
Un groupe humain n’est un peuple que s’il partage les mêmes origines, s’il habite un lieu, s’il ordonne un espace, s’il lui donne des directions, une frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Ce lieu, cet espace ne sont pas seulement géographiques, ils sont spirituels. Pourtant le site est d’ici et non d’ailleurs. C’est pourquoi l’identité d’un peuple s’affirme notamment dans sa manière de travailler le sol, le bois, la pierre, de leur donner une forme. Sa singularité se manifeste dans ce qu’il bâtit, dans ce qu’il crée, dans ce qu’il fait. Chaque peuple a une façon personnelle de se relier à l’espace et au temps. L’instant de l’Africain n’est pas celui de l’Européen ni de l’Asiatique. »
Dominique Venner, Histoire et tradition des Européens : 30 000 ans d'identité
20:05 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Devant la défaite, la douleur et la mort
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« "Souffrir pour comprendre", écrivait Eschyle dans Agamemnon. Il est implicitement admis que c’est devant la défaite, la douleur et la mort que l’homme se révèle. »
Dominique Venner, Histoire et tradition des Européens : 30 000 ans d'identité
19:22 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une ablation de la mémoire
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« De grands efforts ont été faits pour briser le fil du temps et sa cohérence, pour interdire aux européens de retrouver dans leurs ancêtres leur propre image, pour leur dérober leur passé et faire en sorte qu’il leur devienne étranger. De tels efforts ont des précédents. Du Haut Moyen Âge à la Renaissance, de nombreux siècles ont été soumis à une ablation de la mémoire et à une réécriture totale de l’histoire. En dépit des efforts déployés, cette entreprise a finalement échoué. Celle, purement négative, conduite depuis la deuxième partie du XXe siècle, durera beaucoup moins. Venant d’horizons inattendus, les résistances sont nombreuses. Comme dans le conte de la Belle au bois dormant, la mémoire endormie se réveillera. Elle se réveillera sous l’ardeur de l’amour que nous lui porterons. »
Dominique Venner, Histoire et tradition des Européens : 30 000 ans d'identité
18:40 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La devotio
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« À l’époque romaine archaïque, la devotio était une sorte de suicide accompli pour le salut de la patrie, un serment par lequel un général s’offrait en sacrifice aux dieux en échange de la victoire. »
Dominique Venner, Histoire et tradition des Européens : 30 000 ans d'identité
18:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La mémoire des générations futures
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« L’histoire est créatrice de sens. À l’éphémère de la condition humaine, elle oppose le sentiment d’éternité des générations et des traditions. En sauvant de l’oubli le souvenir des pères, elle engage l’avenir. Elle accomplit un désir de postérité inhérent aux hommes, le désir de survivre à sa propre mort. Ce désir a pour objet la mémoire des générations futures. C’est en espérant y laisser une trace que l’on s’efforce de forger l’avenir. Avec la perpétuation d’une lignée, cela fut l’un des moyens conçus par nos ancêtres pour échapper au sentiment de leur propre finitude. »
Dominique Venner, Histoire et tradition des Européens : 30 000 ans d'identité
17:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'épée spirituelle qui fait pâlir les monstres et les tyrans
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Notre monde ne sera pas sauvé par des savants aveugles ou des érudits blasés. Il sera sauvé par des poètes et des combattants, par ceux qui auront forgé l' "épée magique" dont parlait Ernst Jünger, l'épée spirituelle qui fait pâlir les monstres et les tyrans. Notre monde sera sauvé par les veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps. »
« Avec le feu de la volonté, l'idée courtoise de l'amour, la quête de la sagesse et le sens tragique de la destinée, l'un des traits natifs de l'Europe est l'harmonie entre le clan, la cité et la libre individualité, affirmée déjà au temps de la féodalité achéenne. »
« Accepter le destin d'un cœur ferme n'est pas une vertu, c'est être un homme selon Homère, tout simplement. »
Dominique Venner, Histoire et tradition des Européens : 30 000 ans d'identité
16:49 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
22/05/2014
L’essence d’une civilisation
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« La tradition telle que je l’entends de façon neuve et même "révolutionnaire" n’est pas l’ensemble des us et coutumes, une certaine façon d’agir ou de penser transmise par l’éducation ou l’usage. Elle n’est pas non plus ce qui s’oppose à la modernité. Elle est encore moins un ensemble de principes universels et surnaturels imaginés par des gnostiques. Elle n’est pas le souvenir nostalgique d’un Âge d’or disparu. La tradition telle que je l’entends n’est pas le passé, mais au contraire ce qui ne passe pas et qui revient toujours sous des formes différentes. Elle désigne l’essence d’une civilisation sur la très longue durée, ce qui résiste au temps et survit aux influences perturbatrices de religions, de modes ou d’idéologies importées. »
Dominique Venner, Un Samouraï d’Occident
10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une pensée de grande altitude
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Dans son essai sur "La Mort au Japon", Maurice Pinguet a établi une comparaison entre l’esprit de la noblesse d’épée japonaise et celui de l’artistocratie européenne à son automne, à l’époque baroque, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Cela vaut la peine d’y réfléchir : "Tout en se connaissant les mêmes principes d’honneur et de service que les samouraï, la noblesse d’épée (française) ne réussit pas à faire triompher ses valeurs, car depuis l’échec de la Fronde, c’est une version bourgeoise de la bienfaisance chrétienne qui s’affirme. Elle s’en consolera en brocardant le pharisaisme, en riant des tartufes et de leurs dupes." Ce que firent en effet La Rochefoucauld et les anciens frondeurs réfugiés par dépit dans le jansénisme. "Au Japon", poursuit Pinguet, "l’éthique martiale réussit à s’imposer parce qu’elle mit l’accent sur l’abnégation (...). Celui qui répond de son honneur sur sa vie ne peut être soupçonné de mensonge. Il agit, c’est assez...". Ce n’est pas une pensée banale. C’est même une pensée de grande altitude. »
Dominique Venner, Un Samouraï d’Occident
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
21/05/2014
Le stoïcisme n’est le propre d’aucune catégorie sociale...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Que le personnage principal de "The Queen" appartienne à l’exception, c’est l’évidence. Cette singularité est associée à sa fonction et à l’idée exigeante qui l’habite. Mais cette exceptionnalité souligne chez la reine des sentiments supérieurs qui ne sont l’apanage ni de sa fonction ni de son rang. Les mêmes sentiments, moins spectaculaire, habitent certainement nombre de ses sujets anonymes et bien d’autres personnes ailleurs. Le stoïcisme n’est le propre d’aucune catégorie sociale. Ne pas se plaindre, conserver pour soi ses peines, ne pas étaler ses sentiments, ses humeurs, ses états d’âme, ses drames affectifs ou gastriques. S’interdire de parler d’argent, de santé, de cœur et de sexe, tout le contraire de ce qui s’étale dans les magazines de salons de coiffure et chez les "psys".
Dans son roman "Les Carnets du colonel Bramble", André Maurois, qui avait participé à la Première Guerre mondiale, a tracé un portrait éloquent des jeunes officiers britanniques élevé à l’école du stoïcisme : "On a passé leur jeunesse à leur durcir la peau et le cœur. Ils ne craignent ni un coup de poing, ni un coup du sort. Ils considèrent l’exagération comme le pire des vices et la froideur comme un signe d’aristocratie. Quand ils sont très malheureux, ils mettent un masque d’humour. Quand ils sont très heureux, ils ne disent rien du tout..."
À défaut de contrôler le destin, on leur a appris à se contrôler eux-mêmes. »
Dominique Venner, Un Samouraï d’Occident
23:41 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Tenir debout quoi qu’il arrive
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Les dragons sont vulnérables et mortels. Les héros et les dieux peuvent toujours revenir. Il n’y a de fatalité que dans l’esprit des hommes. »
« La seule vérité est de se tenir debout quoi qu’il arrive, de faire face à l’absurdité du monde pour lui donner une forme et un sens, de travailler et de se battre si l’on est un homme, d’aimer si l’on est une femme. »
Dominique Venner, Le cœur rebelle
14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Être à soi-même sa propre norme
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Comment peut-on être rebelle aujourd’hui ? Je me demande surtout comment on pourrait ne pas l’être ! Exister, c’est combattre ce qui me nie. Être rebelle, ce n’est pas collectionner des livres impies, rêver de complots fantasmagoriques ou de maquis dans les Cévennes. C’est être à soi-même sa propre norme. S’en tenir à soi quoi qu’il en coûte. Veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse. Préférer se mettre tout le monde à dos que se mettre à plat ventre. Pratiquer aussi en corsaire et sans vergogne le droit de prise. Piller dans l’époque tout ce que l’on peut convertir à sa norme, sans s’arrêter sur les apparences. Dans les revers, ne jamais se poser la question de l’inutilité d’un combat perdu. »
Dominique Venner, Le Cœur rebelle
11:13 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
20/05/2014
Un peuple qui a besoin d’aimer et ne trouve rien pour satisfaire son amour
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« C’est une terrible pitié que de voir un peuple qui a besoin d’aimer et ne trouve rien pour satisfaire son amour. Il est permis d’interpréter les malheurs de ce pays dans un langage pompeux, en invoquant les courbes de la natalité, l’absence de pétrole ou la recherche d’un idéal. Mais j’ai le sentiment que nos ancêtres, qui faisaient pourtant d’assez grandes choses, ne se torturaient pas pour trouver un idéal : ils l’avaient dans le sang, ou, si l’on veut, à portée de main, en chair et en os, ou en bois sculpté. Le roi de France, Napoléon, le bon Dieu, étaient des êtres de tous les jours, auxquels on pouvait parler, raconter ses affaires sans s’entendre répondre comme le ferait un idéal moderne : "Monsieur, votre honorée du 10 courant nous est bien parvenu. La loi du 8 septembre 1935, modifiée par le décret du 7 Août 1946, vous donne toutes les précisions sur la question. Reportez-vous au journal officiel. »
Sans doute, les hommes de l’ancienne France connaissaient-ils un grand nombre de lois ; mais ils n’étaient pas perdus dans ces textes comme un écureuil dans sa cage, qui court, affolé, en croyant au progrès parce que le sol bouge sous ses pieds. »
Roger Nimier, Le Grand d'Espagne
10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un pays sinistre
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Qui a bien pu accréditer cette idée que la France était le pays de la gaudriole et du libertinage ? La France était un pays sinistre, entièrement sinistre et administratif. »
Michel Houellebecq, Plateforme
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une attente interminable, vaine
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Bien souvent un amour n'est que l'association d'une image de jeune fille (qui sans cela nous eût été vite insupportable) avec les battements de coeur inséparables d'une attente interminable, vaine, et d'un lapin que la demoiselle nous a posé. »
Marcel Proust, La Prisonnière
05:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook