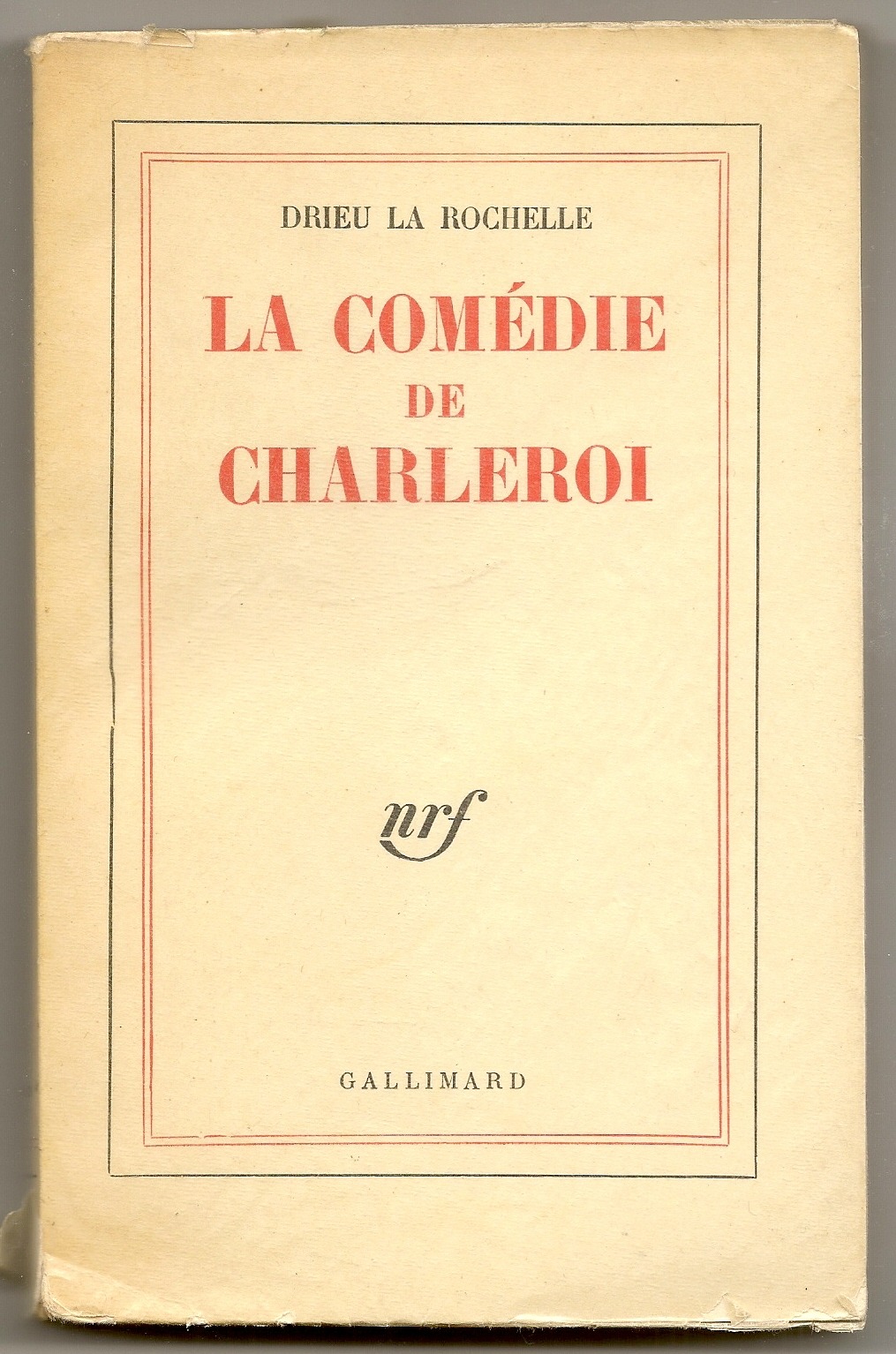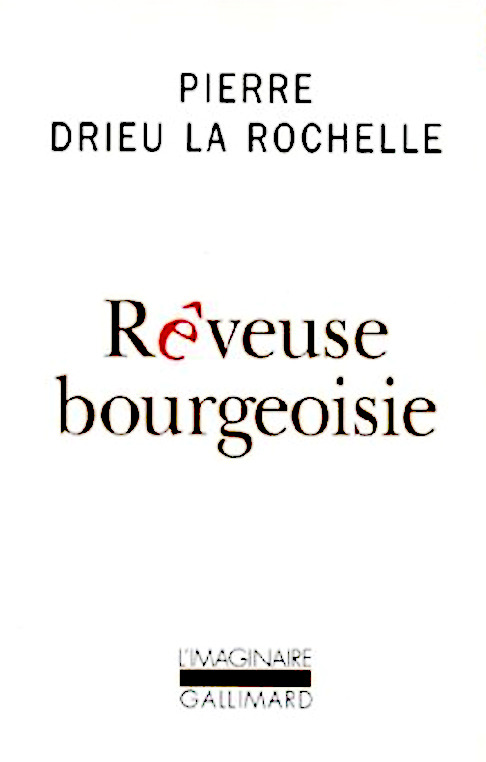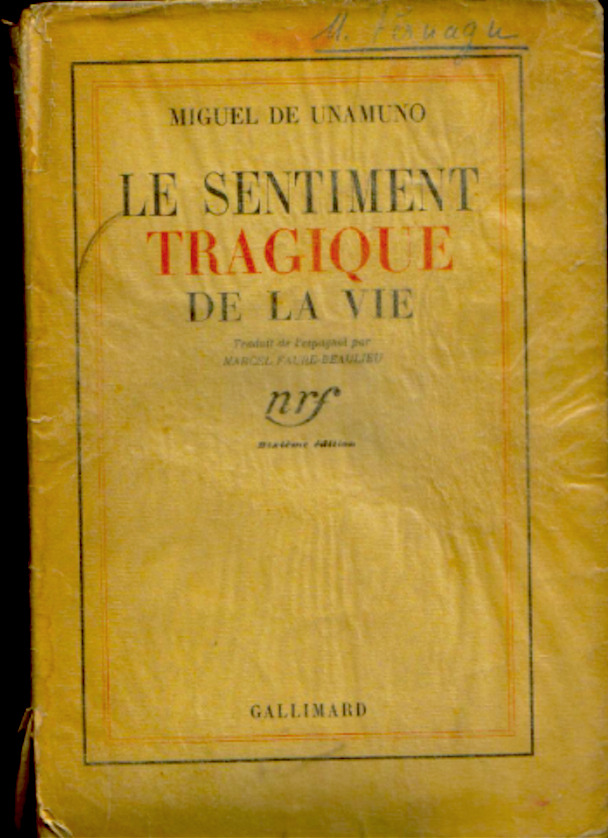20/05/2014
Il y avait eu la charge, depuis : je savais ce que je pouvais, je m’étais composé
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Entendons-nous bien. Certes, il y avait eu un moment avant la charge où, vautré contre la terre, j’avais été plus bas que terre ; je m’étais surpris à souhaiter d’être ailleurs, dans le giron de ma mère ou dans une petite maison bien tranquille dans le midi – dormant douze heures et mangeant de bons biftecks et étant, par exemple, garde-barrière. Mais quel que soit mon penchant pour le self-dénigrement, voire le masochisme, je ne puis assimiler ce moment-là, tout à fait élémentaire, avec le moment où nous sommes. Ce moment élémentaire ne pouvait durer ; et, en effet, il n’avait pas duré. Il ne pouvait durer ; car à quoi ça sert de sauver sa peau ? A quoi sert de vivre, si on ne se sert pas de sa vie pour la choquer contre la mort, comme un briquet ? Guerre – ou révolution, c’est-à-dire guerre encore – il n’y a pas à sortir de là. Si la mort n’est pas au cœur de la vie comme un dur noyau – la vie, quel fruit mou ou bientôt blet ? Donc, ce moment n’avait pas duré. Il y avait eu la charge, depuis : je savais ce que je pouvais, je m’étais composé. La charge m’avait définitivement sorti de ma torpeur du matin ; je ne pouvais plus y rentrer ; je n’y rentrerais jamais. J’étais né à ma valeur. »
Pierre Drieu la Rochelle, La comédie de Charleroi
00:02 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
18/05/2014
Passant de la plainte au bêlement du "cool"
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Est donc raciste celui qui ne pense pas bien - et qui notamment refuse d'admettre que l'individu mondialisé, antiraciste, inculte, veule, abruti par la sous-culture américaine et par l'ignorance, bardé de droits et passant de la plainte au bêlement du "cool", soit encore un homme au sens où la tradition européenne nous avait appris à l'être. »
Richard Millet, De l'antiracisme comme terreur littéraire
16:35 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (12) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Je m’étais mis à fréquenter assidûment les églises de la ville haute, par désœuvrement
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« À cette époque, ma foi n’était que religiosité mêlée de vague superstition, avec un goût prononcé pour l’architecture sacrée. Je m’étais mis à fréquenter assidûment les églises de la ville haute, par désœuvrement, peut-être, autant que pour le calme que ces nefs sombres et silencieuses faisaient renaître en moi après mes journées au bureau. Affecté à Laon pour une année, j’avais accepté avec indifférence cet exil. Je logeais dans la ville haute, non loin de la citadelle. J’aimais le silence des ruelles et des arrière-cours, les gestes lents des citadins, la paix des promenades et, par-dessus tout, l’espèce d’étroit belvédère d’où l’on découvrait, tout autour de la butte, des plaines sans fin : je venais rêvasser là, les soirs de septembre et d’octobre, en regrettant qu’il soit désormais impossible d’écrire l’histoire d’une jeune sentinelle guettant aux horizons bleutés des cavaliers barbares venus du nord. »
Richard Millet, Coeur Blanc, "Octavian"
15:54 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
17/05/2014
La régularité médiocre
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Les petites gens s’effraient de voir sortir les leurs de la régularité médiocre, temple de l’honnêteté dont ils se savent les dépositaires dans la société. »
Pierre Drieu la Rochelle, Rêveuse Bourgeoisie
16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Saturés d'informations accessoires
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« C'est la première fois qu'une époque semble être fière de ne plus être historique, même les punks qui prônaient le No future, et qui le revendiquaient, avaient encore la force de réagir à quelque chose, fût-ce à leur indifférence. Vous n'êtes même pas nihilistes, quelle tragédie! On est obligés de s'adresser à vous comme à des enfants vierges, handicapés, amnésiques, ignorants, incapables de se concentrer. Je le vois bien, dès que je fais allusion à une force du passé, ça suscite un inintérêt flagrant. Vous êtes tout de suite agacés comme par de la nuisance sonore, parce que vous êtes saturés d'informations accessoires qui parasitent votre attention. »
Marc-Edouard Nabe, L'homme qui arrêta d'écrire
14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Basculer de l'autre côté de la vie sans une larme
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le courage du soldat est inséparable de celui des autres. Il fait partie d'une chaîne humaine, et il n'y a pas de salut individuel. C'est pourquoi le courage est pour lui un sentiment qui s'organise, qu'on entretient comme les fusils. On lui dit de se battre et il se bat. On lui dit de mourir et il meurt. Il pratique cet étrange courage qu'il faut pour basculer de l'autre côté de la vie sans une larme. »
Hélie de Saint Marc, Les sentinelles du soir
12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Qui ne méprise pas le mal, ou le bas, pactise avec lui
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Les vertus que vous cultiverez par-dessus tout sont le courage, le civisme, la fierté, la droiture, le mépris, le désintéressement, la politesse, la reconnaissance, et, d’une façon générale, tout ce qu’on entend par le mot générosité.
Le courage moral, qui a une si bonne presse, est une vertu facile, surtout pour celui qui ne tient nul compte de l’opinion. Si on ne l’a pas, l’acquérir est une affaire de volonté, c’est-à-dire une affaire facile. Par contre, si on n’a pas le courage physique, l’acquérir est une affaire d’hygiène, qui sort du cadre que je me suis tracé ici.
Civisme et patriotisme ne font qu’un, si le patriotisme mérité son nom. Vous êtes d’un pays où il y a du patriotisme par saccades, et du civisme jamais ; où le civisme est tenu pour ridicule. Je vous dis : “Si vous êtes patriote, soyez-le sérieusement”, comme je vous dirais : “Si vous êtes catholique, soyez-le sérieusement”. Je ne fais pas grand cas d’un homme qui défend avec vaillance, en temps de guerre, le pays qu’il a affaibli par mille coups d’épingle en temps de paix. N’ayez pas besoin que votre pays soit envahi pour le bien traiter. Conduisez-vous aussi décemment dans la paix que dans la guerre, si vous aimez la paix.
La vanité, qui mène le monde, est un sentiment ridicule. L’orgueil, fondé, n’ajoute rien au mérite ; quand j’entends parler d’un “bel orgueil”, cela me laisse rêveur. Non fondé, il est lui aussi ridicule. La seule supériorité de l’orgueil sur la vanité, c’est que la vanité attend tout, et l’orgueil rien ; l’orgueil n’a pas besoin de se nourrir, il est d’une sobriété folle. A mi-chemin entre la vanité et l’orgueil, vous choisirez la fierté.
La droiture est ceci et cela, et en outre elle est une bonne affaire. Elle obtient tout ce qu’obtient la rouerie, à moindres frais, à moindres risques, et à moindre temps perdu.
Le désintéressement n’a d’autre mérite que de vous tirer du vulgaire, mais il le fait à coup sûr. Toutes les fois que, pouvant prendre, vous ne prendrez pas, vous vous donnerez à vous-même cent et mille fois plus que vous ne vous fussiez donné en prenant. De toutes les occasions dont vous ne voudrez pas profiter, dans le monde invisible vous vous bâtirez une cathédrale de diamant. La France d’aujourd’hui a créé un certain nombre de mots véritablement obscènes, parmi lesquels celui de resquiller. Ne resquillez pas, fût-ce dans le domaine le plus humble, car cela va du petit au grand.
Le mépris fait partie de l’estime. On peut le mépris dans la mesure où on peut l’estime. Les excellentes raisons que nous avons de mépriser. Qui ne méprise pas le mal, ou le bas, pactise avec lui. Et que vaut l’estime de qui ne sait pas mépriser ? J’avais toujours pensé qu’on pouvait fonder quelque chose sur le mépris ; maintenant je sais quoi : la moralité. Ce n’est pas l’orgueil qui méprise ; c’est la vertu. Aussi sera-t-il beaucoup pardonné à celui qui aura beaucoup méprisé. Et encore j’ajoute ceci : qu’il n’y a pas besoin de n’être pas méprisable, pour mépriser. »
Henry de Montherlant, Lettre d’un père à son fils
10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un homme tout court
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Un jour, vous me direz peut-être que les conseils que je vous ai donnés ne sont pas adaptés à un homme moderne. A coup sûr : les vertus que je demande de vous sont les plus nuisibles à qui veut "réussir" dans le monde moderne. Mais je ne vous ai pas fait pour que vous fussiez un homme de tel ou tel monde, mais un homme tout court. »
Henry de Montherlant, Lettre d'un père à son fils
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Larmes et Sperme
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Voilà l’ennui des filles qui font trop bien l’amour : elles nous rendent en larmes, tout le sperme que nous leur donnons. »
Roger Nimier, Le hussard bleu
01:14 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
15/05/2014
C'est sur des irrationalités que la raison construit
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Hegel rendit célèbre son aphorisme d'après lequel tout ce qui est rationnel est réel, et tout ce qui est réel, rationnel. Mais nous sommes nombreux à ne pas être convaincus par Hegel, à continuer à croire que ce qui est réel, ce qui est réellement réel, est irrationnel ; que c'est sur des irrationalités que la raison construit. Hegel, grand auteur de définitions, prétendit avec elles reconstruire l'univers, semblable à ce sergent d'artillerie qui pensait que les canons se fabriquaient en se munissant d'un trou, qu'on recouvrait ensuite de fer. »
Miguel de Unamuno, Du sentiment tragique de la vie
18:34 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
14/05/2014
Recueillir plus d'âmes en un jour que Jésus-Christ en 2000 ans
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Comment le plus infime crétin, le canard le plus rebutant, la plus désespérante donzelle peuvent-ils se muer en dieux et déesses ? Recueillir plus d'âmes en un jour que Jésus-Christ en 2000 ans ? C'est que la foule à genoux a le goût du faux, de l'or et de la merde, plus insignifiante est l'idole plus elle a de chances de conquérir le coeur de la foule... »
Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un Massacre
15:37 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
13/05/2014
Une convulsion de cette société
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Les Allemands séduits par la facilité se remettaient à tirer. Et comment. Quelle dégelée de balles. Ces balles, c'est du minerai, sorti des entrailles de la terre, qui vous jaillit à la figure. Et c'est conjointement une convulsion de cette société. C'est si facile de déchirer un centimètre de chair avec une tonne d'acier. »
Pierre Drieu la Rochelle, La Comédie de Charleroi
16:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une voiture de course
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le seul avantage serait d’acheter une voiture de course qui me permettrait de me tuer : cela me donnerait ce côté humain et touchant qui me manque prodigieusement, si j’en crois les critiques. »
Roger Nimier, Les Enfants tristes
14:26 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
09/05/2014
Une pin-up affriolante derrière, ou devant, chaque objet
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Bref, si Marx avait lu Sade, il aurait sans doute compris que le capitalisme disposait d’une réserve fantastique : la démocratisation de la jouissance de l’objet. (…)
Le personnage de la pin-up n’a, à l’évidence, pas été inventé par hasard au moment de la crise de 1929. Il est au contraire un élément essentiel à la compréhension d’une époque. En d’autres termes, pour comprendre quelque chose au capitalisme sadien dans lequel nous vivons depuis trois générations, il faut regarder, voire même contempler une pin-up dans une de ces nombreuses situations sadiennes soft où ce personnage s’est alors retrouvé jeté.(…) C’est ce personnage culturel sadien devenu mythique, qui a véritablement sauvé le capitalisme de la crise de 1929 et, par là, changé le cours du monde. (…) Le capitalisme, en effet, aurait dû alors mourir, victime d’une crise majeure de surproduction, comme Marx l’avait annoncé. Mais la pin-up arriva et relança progressivement la machine en se montrant capable d’érotiser à outrance n’importe quel objet manufacturé que les consommateurs n’eurent plus qu’à acheter en masse, moyennant le formatage et l’exploitation industrielle de leur énergie libidinale. Le marché est ainsi devenu peu ou prou pornographe : il y avait une pin-up affriolante derrière, ou devant, chaque objet. »
Dany-Robert Dufour, La Cité perverse
16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (6) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nos vies sont immergées dans l’expérience directe des nombres entiers
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« L’enfant sait – nous savons tous – comment certains types d’objets se comportent. Nos vies sont immergées dans l’expérience directe des nombres entiers : combien il y a de pièces de monnaie, de timbres, de cailloux, d’oiseaux, de chats de moutons, d’autobus. Si j’essayais de convaincre un enfant de six ans que je peux mettre trois pierres dans une boîte, en enlever une, et me retrouver avec quatre, il se moquerait tout simplement de moi. Pourquoi ? Ce n’est pas seulement parce qu’il est sûr d’avoir, à de nombreuses reprises, retiré un objet parmi trois pour qu’il en reste deux. Même un enfant comprend que certaines choses qui paraissent fiables finiront par ne plus marcher : un jouet qui fonctionne parfaitement, jour après jour, pendant un mois ou un an, peut toujours se casser. Mais pas l’arithmétique, pas le fait d’enlever un à trois. Ça, il ne peut même pas imaginer que ça ne marche plus. Quand on a vécu dans le monde, quand on a vu comment il fonctionne, la faillite de l’arithmétique devient inconcevable.
Le professeur Hamilton suggère que cela relève de l’âme. Mais que dirait-il d’un enfant élevé dans un environnement d’eau et de brume, qui n’a jamais été en présence de plus d’une personne à la fois, qui n’a jamais appris à compter sur ses doigts et ses orteils. Je doute qu’un tel enfant ait la même certitude que nous, que vous et moi, qu’il lui semble aussi impossible que l’arithmétique l’induise un jour en erreur. Supprimer totalement les nombres entiers de son monde nécessiterait qu’on le place dans un cadre très étrange, avec un niveau de manque qui atteindrait la cruauté, mais est-ce que ce serait suffisant pour qu’il perde son âme ?
Un ordinateur programmé pour faire de l’arithmétique comme l’a décrit le professeur Hamilton, est soumis à des privations encore plus grandes que celles que l’on a infligées à cet enfant. Si j’avais été élevé avec les mains et les pieds attachés, la tête dans un sac, avec quelqu’un qui me hurlait des ordres, je ne crois pas que j’aurais une bonne appréhension du réel – mais je serais néanmoins mieux préparé à cette tache qu’un ordinateur. C’est une grâce formidable qu’une machine soumise à un tel traitement ne soit pas capable de penser : si elle le pouvait, les chaînes qu’on lui a fait porter serait d’une oppresivité criminelle. »
Greg Egan, Nouvelle, Oracle, publiée dans le recueil Océanique
12:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le voile a glissé sans qu’elle voulût le voir tomber
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le voile a glissé sans qu’elle voulût
Le voir tomber.
D’une main le saisit et de l’autre
Nous fit signe
D’avoir à craindre Dieu, en réprimant
Notre curiosité avide.
Une main aux doigts teints,
Souple, aux extrémités déliées
Comme fruits de l’anam
Qui semblent ne pouvoir
se nouer, tant est grande
leur délicatesse. Puis, de ses longs cheveux noirs
à demi bouclés se couvrant,
elle se ploya comme la vigne s’appuie
sur l’étançon qui la soutient.
Enfin elle te regarda comme
Pour te rappeler que, malgré sa prière,
Tu aurais pu obtenir
Ce que tu n’as pas essayé de prendre…
Lourd regard d’attente qu’un malade
Adresse à ceux qui le visitent. »
Al-Nābiġa al-D̠ubyānī, poème compilé dans "La Poésie Arabe", anthologie traduite et présentée par René Khawam
10:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Territorialisées contre Globalisés...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ce serait une erreur de ne définir les classes que comme des ensembles d’individus regroupés par un intérêt matériel commun. La lutte des classes, soulignait Edouard Berth, n’est pas la révolte des pauvres contre les riches, comme l’imaginait Blanqui, mais bien, comme l’a montré Marx, la révolte des producteurs contre le système capitaliste. Elle n’oppose pas seulement des groupes d’intérêts divergents, mais aussi des types humains opposés (c’est aussi pour cette raison qu’il ne saurait y avoir d’intérêts communs entre eux).
Le grand clivage social actuel est celui qui oppose des classes populaires encore "territorialisées", dont le mode de vie et de sociabilité se limite en général à un périmètre restreint, à une Nouvelle Classe globalisée, engendrée elle-même par un néocapitalisme financiarisé et de plus en plus déterritorialisé. »
Alain de Benoist, in "Réfléchir et Agir", numéro 44
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
08/05/2014
L'intolérance musulmane...
17:07 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dans la flamme
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« L'ordre humain ressemble au Cosmos en ceci, que de temps en temps, pour renaître à neuf, il lui faut plonger dans la flamme. »
Ernst Jünger, Sur les falaises de marbre
17:05 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Rien ne compromet davantage, n’affaiblit de l’intérieur, et n’affadit la lutte contre le racisme que cette façon de mettre le terme à toutes les sauces
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« […] rien ne compromet davantage, n’affaiblit de l’intérieur, et n’affadit la lutte contre le racisme que cette façon de mettre le terme, si j’ose dire, à toutes les sauces, en confondant une théorie fausse, mais explicite, avec des inclinations et des attitudes communes dont il serait illusoire d’imaginer que l’humanité puisse un jour s’affranchir ni même qu’il faille le lui souhaiter […] »
« […] parce que ces inclinations et ces attitudes sont, en quelque sorte, consubstantielles à notre espèce, nous n’avons pas le droit de nous dissimuler qu’elles jouent un rôle dans l’histoire : toujours inévitables, souvent fécondes, et en même temps grosses de dangers quand elles s’exacerbent. J’invitais donc les lecteurs à douter avec sagesse, avec mélancolie s’ils voulaient, de l’avènement d’un monde où les cultures, saisies d’une passion réciproque, n’aspiraient plus qu’à se célébrer mutuellement, dans une confusion où chacune perdrait l’attrait qu’elle pouvait avoir pour les autres et ses propres raisons d’exister. […] il ne suffit pas de se gargariser année après année de bonnes paroles pour réussir à changer les hommes, […] en s’imaginant qu’on peut surmonter par des mots bien intentionnés des propositions antinomiques comme celles visant à “concilier la fidélité à soi et l’ouverture aux autres” ou à favoriser simultanément “l’affirmation créatrice de chaque identité et le rapprochement entre toutes les cultures”. »
Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné
16:51 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Confondre le racisme défini au sens strict et des attitudes normales, légitimes même, et en tout cas inévitables
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« […] je m’insurge contre l’abus de langage par lequel, de plus en plus, on en vient à confondre le racisme défini au sens strict et des attitudes normales, légitimes même, et en tout cas inévitables. Le racisme est une doctrine qui prétend voir dans les caractères intellectuels et moraux attribués à un ensemble d’individus, de quelque façon qu’on le définisse, l’effet nécessaire d’un commun patrimoine génétique. On ne saurait ranger sous la même rubrique, ou imputer automatiquement au même préjugé l’attitude d’individus ou de groupes que leur fidélité à certaines valeurs rend partiellement ou totalement insensibles à d’autres valeurs.
Il n’est nullement coupable de placer une manière de vivre et de penser au-dessus de toutes les autres, et d’éprouver peu d’attirance envers tels ou tels dont le genre de vie, respectable en lui-même, s’éloigne par trop de celui auquel on est traditionnellement attaché. Cette incommunicabilité relative n’autorise certes pas à opprimer ou détruire les valeurs qu’on rejette ou leurs représentants, mais, maintenue dans ces limites, elle n’a rien de révoltant. Elle peut même représenter le prix à payer pour que les systèmes de valeurs de chaque famille spirituelle ou de chaque communauté se conservent, et trouvent dans leur propre fonds les ressources nécessaires à leur renouvellement.
Si comme je l’ai écrit ailleurs, il existe entre les sociétés humaines un certain optimum de diversité au-delà duquel elles ne sauraient aller, mais en dessous duquel elles ne peuvent non plus descendre sans danger, on doit reconnaître que cette diversité résulte pour une grande part du désir de chaque culture de s’opposer à celles qui l’environnent, de se distinguer d’elles, en un mot d’être soi ; elle ne s’ignorent pas, s’empruntent à l’occasion, mais, pour ne pas périr, il faut que, sous d’autres rapports, persiste entre elles une certaine imperméabilité. »
Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné
16:38 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même leur négation
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« La lutte contre toutes les formes de discrimination participe de ce même mouvement qui entraîne l'humanité vers une civilisation mondiale, destructrice de ces vieux particularismes auxquels revient l'honneur d'avoir créé les valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie (...) Sans doute nous berçons-nous du rêve que l'égalité et la fraternité régneront un jour entre les hommes sans que soit compromise leur diversité. Mais si l'humanité ne se résigne pas à devenir la consommatrice stérile des seules valeurs qu'elle a su créer dans le passé (...), elle devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même leur négation. Car on ne peut, à la fois, se fondre dans la jouissance de l'autre, s'identifier à lui, et se maintenir différent. »
Claude Lévi-Strauss, Race et culture
16:19 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Si l’immigration est officiellement interrompue en 1974, le regroupement familial, autorisé en 1975, accroît dans les faits le nombre d’arrivants
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Selon le discours en vogue, la France aurait toujours été un creuset de population. Du point de vue historique, cette assertion est fausse. Du VIe au XIXe siècle, le fond du peuple français est demeuré le même. Au XIXe siècle apparaît une immigration saisonnière, les travailleurs retournant dans leur pays après leur labeur. La première grande vague migratoire a lieu après la Première Guerre mondiale. Elle est constituée d’ Italiens, d’Espagnols, de Polonais et de ressortissants d’autres nations de l’Est. Ceux-ci s’assimilent peu à peu, par le biais de l’école, du service militaire et de la guerre -certaines institutions exerçant une force intégratrice : l’Église catholique, les syndicats, et même le Parti communiste. A partir de 1946, la seconde vague migratoire vient d’Algérie. Sous la IVe République, contrairement à ce qui se répète, ce n’est pas le patronat qui fait venir cette main-d’œuvre : ce sont les pouvoirs publics, afin de trouver une issue à l’explosion démographique de la population musulmane d’outre-Méditerranée. Après 1962, l’Algérie indépendante, le flux migratoire reprend en vertu de la libre circulation stipulée par les accords d’Evian. Si l’immigration est officiellement interrompue en 1974, le regroupement familial, autorisé en 1975, accroît dans les faits le nombre d’arrivants. D’autres courants migratoires apparaissent, issus d’Afrique noire ou d’Asie. Et en vertu de la loi, tout enfant né en France de parents étrangers peut, à sa majorité, accéder à la nationalité française. »
Jean Sévillia, Le terrorisme intellectuel
16:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
07/05/2014
Le tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s’exposent dans la Cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place. On n’achète une charge à l’armée si cher, que parce qu’on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir.
Mais quand j’ai pensé de plus près et qu’après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs j’ai voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé qu’il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près.
Quelque condition qu’on se figure, si l’on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant qu’on s’en imagine, accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher. S’il est sans divertissement et qu’on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu’il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort et des maladies, qui sont inévitables. De sorte que s’il est sans ce qu’on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit.
De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n’est pas qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on s’imagine que la vraie béatitude soit d’avoir l’argent qu’on peut gagner au jeu ou dans le lièvre qu’on court, on n’en voudrait pas s’il était offert. Ce n’est pas cet usage mol et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu’on recherche ni les dangers de la guerre ni la peine des emplois, mais c’est le tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit. »
Blaise Pascal, Pensées
16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Des manigances qui vous ont toujours un fumet de moralisme
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Michel pensait encore aux honnêtes ahuris qui rêvaient de vaporiser des symphonies de parfums durant des concerts, de jouer du Beethoven devant du Tintoret. "Tous à fourrer dans le même sac. Des manigances qui vous ont toujours un fumet de moralisme". Ces préparatifs entravent l’émotion chez tous les êtres de quelque délicatesse. On ne pénètre jamais mieux les chefs d’œuvre que lorsqu’on les aborde de face, très simplement, aussi seul que possible, en s’oubliant soi-même et en pensant d’abord au métier du peintre ou du musicien. Ça n’a pas une allure aussi exhaustive, mais c’est bien plus difficile et bien plus rare, parce qu’il faut être capable de lire, d’écouter la langue des héros. Tandis que Dieu sait quelles ritournelles, quelles rhapsodies de métaphores et de symboles à deux sous la ligne, entendent les "âmes élevées" devant Tristan ou Rembrandt. »
Lucien Rebatet, Les deux étendards
14:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook