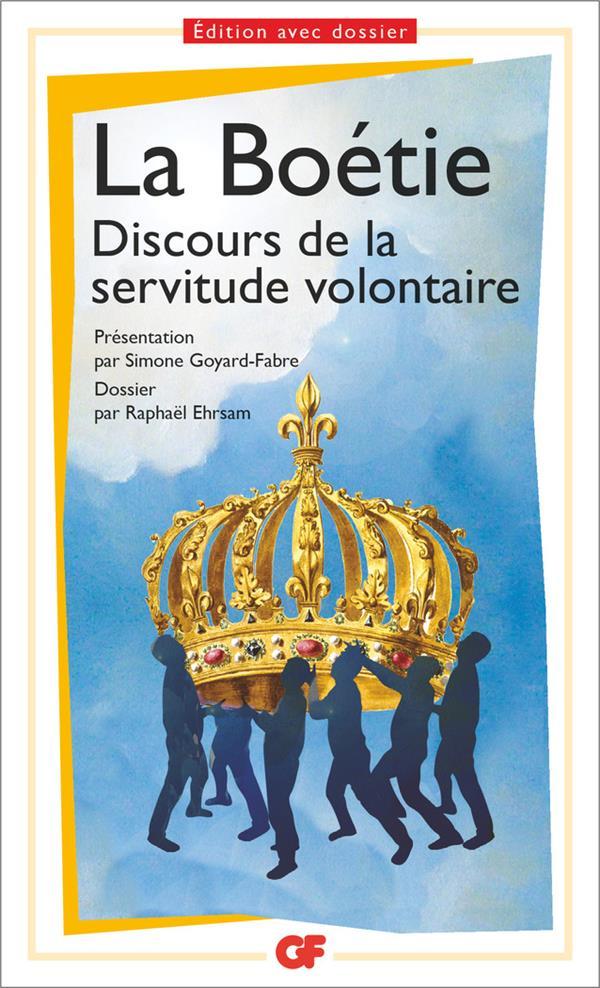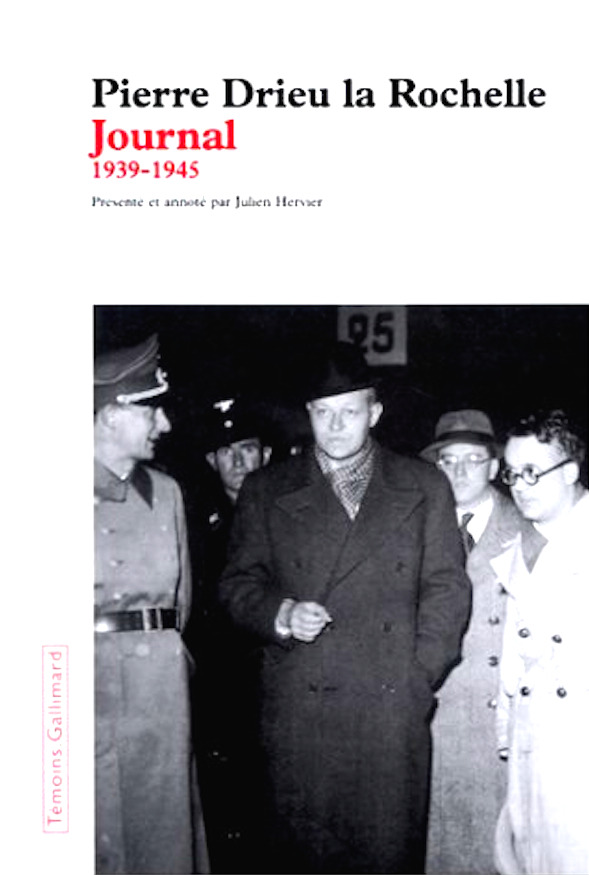14/05/2020
Une vie, une œuvre : Georges Bernanos (1888-1948), le dernier témoin de la pitié sacrée [1987]
09:30 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
13/05/2020
Alain Finkielkraut évoque Charles Péguy
09:30 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
12/05/2020
Un élu qu’appelle le large
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Il est bon aussi d’aimer ; car l’amour est difficile. L’amour d’un être humain pour un autre, c’est peut-être l’épreuve la plus difficile pour chacun de nous, c’est le plus haut témoignage de nous-même ; l’œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C’est pour cela que les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore aimer ; ils doivent apprendre. De toutes les forces de leur être, concentrées dans leur cœur qui bat anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un temps de clôture. Ainsi pour celui qui aime, l’amour n’est longtemps, et jusqu’au large de la vie, que solitude, solitude toujours plus intense et plus profonde.
L’amour ce n’est pas dès l’abord se donner, s’unir à un autre. (Que serait l’union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants ?) L’amour, c’est l’occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l’amour de l’être aimé. C’est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu’appelle le large. Dans l’amour, quand il se présente, ce n’est que l’obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir (zu horchen und zu hämmern Tag und Nacht). Se perdre dans un autre, se donner à un autre, toutes les façons de s’unir ne sont pas encore pour eux. Il leur faut d’abord thésauriser longtemps, accumuler beaucoup. Le don de soi-même est un achèvement : l’homme en est peut-être encore incapable. »
Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète
15:05 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Henri Guillemin : Charles Péguy
09:30 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
11/05/2020
Charles Péguy, La solitude du juste
15:00 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
10/05/2020
La Foi prise au mot (KTO) : Jacques Maritain
21:43 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Acquis corps et âme à son Principe
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« La Technique prétendra tôt ou tard former des collaborateurs acquis corps et âme à son Principe, c’est-à-dire qui accepteront sans discussion inutile sa conception de l’ordre, la vie, ses Raisons de Vivre, Dans un monde tout entier voué à l’Efficience, au Rendement, n’importe-t-il pas que chaque citoyen, dès sa naissance, soit consacré aux mêmes dieux ? La Technique ne peut être discutée, les solutions qu’elle impose étant par définition les plus pratiques. Une solution pratique n’est pas esthétique ou morale. Imbéciles ! La Technique ne se reconnaît-elle pas déjà le droit, par exemple, d’orienter les jeunes enfants vers telle ou, telle profession ? N’attendez pas qu’elle se contente toujours de les orienter, elle les désignera. Ainsi, à l’idée morale, et même surnaturelle, de la vocation s’oppose peu à peu celle d’une simple disposition physique et Mentale, facilement contrôlable par les Techniciens. Croyez-vous, imbéciles, qu’un tel système, et si rigoureux, puisse subsister par le simple consentement ? Pour l’accepter comme il veut qu’on l’accepte, il faut y croire, il faut y conformer entièrement non seulement ses actes, mais sa conscience. Le système n’admet pas de mécontents. Le rendement d’un mécontent — les statistiques le prouvent — est inférieur de 30 % au rendement normal, et de 50 ou 60 % au rendement d’un citoyen qui ne se contente pas de trouver sa situation supportable – en attendant le Paradis — mais qui la tient pour la meilleure possible. Dès lors, le premier venu comprend très bien quelle sorte de collaborateur le technicien est tenu logiquement de former. Il n’y a rien de plus mélancolique que d’entendre les imbéciles donner encore au mot de Démocratie son ancien sens. Imbéciles ! Comment diable pouvez-vous espérer que la Technique tolère un régime où le technicien serait désigné par le moyen du vote, c’est-à-dire non pas selon son expérience technique garantie par des diplômes, mais selon le degré de sympathie qu’il est capable d’inspirer à l’électeur ? La Société moderne est désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre. Quelle place le politicien roublard, comme d’ailleurs l’électeur idéaliste, peuvent-ils avoir là-dedans ? Imbéciles ! Pensez-vous que la marche de tous ces rouages – économiques, étroitement dépendants les uns des autres et tournant à la vitesse de l’éclair va dépendre demain du bon plaisir des braves gens rassemblés dans les comices pour acclamer tel ou tel programme électoral ? Imaginez-vous que la Technique d’orientation professionnelle, après avoir désigné pour quelque emploi subalterne un citoyen jugé particulièrement mal doué, supportera que le vote de ce malheureux décide, en dernier ressort, de l’adoption ou du rejet d’une mesure proposée par la Technique elle-même ? Imbéciles ! Chaque progrès de la Technique vous éloigne un peu plus de la démocratie rêvée jadis par les ouvriers idéalistes du Faubourg Saint-Antoine. »
Georges Bernanos, La France contre les Robots
18:13 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
09/05/2020
Une grande masse désespérante
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« C’était partout la même chose : crime et trahison, trahison et crime – des hommes qui étaient vivants, mais ni propres ni nobles, des hommes qui étaient propres et nobles, mais pas vivants. Au milieu, une grande masse désespérante, ni noble ni vivante, mais simplement propre. Elle ne péchait ni activement ni délibérément, mais par passivité et ignorance, en acceptant l’immoralité ambiante dont elle tirait profit. Si elle avait été noble et vivante, elle n’aurait pas été ignorante, et elle aurait refusé de partager les profits de la trahison et du crime. »
Jack London, Ce que la vie signifie pour moi
00:32 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Des différences de représentation
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Mais pourquoi auriez-vous besoin de mes services, puisque, à vous en croire, vous êtes le pouvoir, puisque vous incarnez l'action, sinon pour vous convaincre, et ceux qui vous entourent, et ceux aussi qui dépendent de vous, que vous avez le pouvoir et en usez à votre gré. Vous avez senti obscurément que le pouvoir n'est rien sans une image dont il tire toute sa réalité. Une certaine façon d'écrire l'histoire, qu'il vous faut à tout prix forger et contrôler. Sans cette image de vous-même à laquelle vous aspirez si fort que vous vous êtes leurré jusqu'à croire que vous pouviez la trouver en moi, vous n'êtes rien d'autre que l'expression passagère d'une nécessité à laquelle vous n'entendez rien. En fait de pouvoir, là où vous êtes, vous en disposez moins, si étrange qu'il puisse paraître, que le plus obscur de vos sbires. Vous avez parlé avec trop de cynisme des grandes idées dont vous couvriez une politique fort douteuse, pour espérer encore vous soustraire aux conséquences de vos propres propos. Qu'y a-t-il derrière vos efforts pour rassembler les hommes, sinon une série de meurtres et de manœuvres diverses d'intimidation ? Qu'est-ce, à cet égard, qui distingue le grand politique du petit criminel crapuleux, sinon des différences de représentation ? »
Jacques Abeille, Les jardins statuaires
00:19 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
03/05/2020
Servitude...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté mais "gagné" sa servitude. »
Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
02/05/2020
Des milliers de jeunes putes potentielles
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« J'étais chez Sweet le jour du bombardement de Pearl Harbor. J'y avais passé la nuit et j’étais encore au lit. Le gentil serpent à la peau brune, m’avait apporté mon petit déjeûner. Je finissais de manger lorsque Sweet entra dans la chambre. II s’assit au bord du lit.
– Berg, dit-il, l’oncle Sam vient de se faire couper la gorge. Les Yeux-Bridés ont mis le feu à Pearl Harbor. Les putes vont ramasser plus d’argent que jamais. Mais j’ai l’impression qu’à long terme, les macs auront à souffrir de cette guerre.
– Qu’est-ce qui te fait dire ça ? demandai-je.
– Tu sais, une pute, ce n’est jamais qu’une ex-honnête fille. Au cours de sa vie, un bon mac use beaucoup de putes. Si les macs ne trouvent plus assez de filles honnêtes à mettre sur le trottoir, les écuries vont rapetisser. Avec la guerre, les usines d'armement feront appel à des milliers de jeunes putes potentielles. Les filles qui y travailleront gagneront de l’argent. Elles vont prendre goût à leur indépendance et la défendre dur comme fer. Les macs ne pourront plus les convaincre d’aller tapiner. Les honnêtes femmes plus âgées iront elles aussi travailler dans les usines. Elles sont des milliers à avoir des filles de moins de vingt ans. Avec l’argent qu’elles gagneront, elles auront de quoi remplir le ventre de ces jeunes pétasses. Elles leur achèteront de belles fringues et les filles n’auront pas la moindre envie de se coller entre les mains d’un mac. Elles préféreront maquereauter Maman. Le pire, c’est que ces usines vont inciter les putes qui bossent pour les macs de stricte obédience à se tirer et à rentrer dans le rang. Si la guerre dure longtemps, les macs n’auront plus qu’à devenir pédés s’ils veulent encore avoir quelqu’un à faire tapiner. Berg, le vrai paradis des macs, c’est un grand bassin plein de jeunes morues loqueteuses et affamées.
La guerre faisait rage. Les usines d’armement tournaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Des milliers de bonnes femmes, jeunes et vieilles, y trimaient comme des esclaves. En ce qui me concernait, mon bassin regorgeait toujours de très beaux poissons. J’avais trois filles qui tapinaient pour moi depuis les origines et trois nouvelles recrues. »
Iceberg Slim, Pimp
16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Séparation
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Un signe, mon amour, pour ne pas t'oublier ?
C'est toi que je voudrais mais tu n'es plus à toi.
Je ne veux pas la fleur dans tes cheveux fanée,
Je n'ai plus qu'un désir : ne pense plus à moi !
Pourquoi faire durer l'inutile douleur
De savoir à jamais passé notre bonheur ?
Quel ruisseau jamais roule les mêmes eaux ?
A quoi bon le tourment de regrets éternels
Quand traverser sans bruit ce monde est notre lot,
Ombres d'un songe amer, songes d'ombres mortelles ?
Pourquoi penser à moi et compter désormais
Ces années que les morts ne sentent plus passer ?
Que je meure aujourd'hui ou je meure demain
Cela ne change rien, c'est mourir que je veux
Et que meurent en ton coeur nos rêves de bonheur.
Que les années passées ne soient plus à tes yeux
Qu'un abîme d'oubli qui ne te fait plus peur,
Que rien ne te rappelle que nous nous sommes aimés
Et que tu me pardonnes de t'avoir adorée.
Laisse-moi maintenant, entouré d'étrangers,
Refermer sur mes yeux mes paupières glacées.
Lorsque je serai terre, à la terre rendue,
De celui que je fus on ne parlera plus.
A travers les murs froids, de triste ritournelles
Mendieront pour mon âme un repos éternel.
Il me serait plus doux, s'approchant de ma bière,
Qu'on me dise ton nom, penché sur mes paupières,
Que l'on me jette alors au fossé si l'on veut.
Plus jamais désormais ne serai malheureux.
Qu'un vol noir de corbeaux monte dans le lointain,
Obscuriccant le ciel devant mes yeux éteints,
Qu'une tempête vienne, des confins de la terre,
Disperser dans les airs mes cendres et sur la terre...
Et toi reste à jamais la fleur que j'ai aimée,
Aux grands yeux mouillés, au sourire si frais ;
Tu étais une enfant, reste-le, s'il te plaît,
Jette-moi à l'oubli, je ne suis que passé. »
Mihai Eminescu, "Séparation" in Poésies
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
26/04/2020
La source vive et spontanée qu'on rêve dans son adolescence
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Je n'avais pas trente ans que ces jours de fête me paraissaient horribles. C'est le moment de l'année où l'homme sent le plus sa solitude.
Solitude que j'ai voulue, de toute la force de mon égoïsme et de par toute la puissance de ma fatalité ! Impossible de m'attacher à une femme, impossible de m'abandonner à elle. Je n'en trouvais aucune assez belle. Assez belle intérieurement ou extérieurement. J'ai tout sacrifié à une idée folle de la beauté.
Je savais bien d'ailleurs qu'il y a de beauté que celle que nous donnons aux êtres, je savais bien que je pouvais mettre de la beauté dans une femme, mais je boudais, j'en voulais à la nature de ne pas me donner ce qu'il me fallait moi-même créer.
J'ai repoussé comme une illusion qui ne pourrait jamais me satisfaire jusqu'au fond du cœur cette nécessité pour l'homme de créer la femme. Je me disais avec lassitude : “Oui, j'arriverai à me faire une femme qui sera ma femme, indubitablement marquée de mon sceau. Mais que sera-ce ? Seulement une petite guenon qui répétera mes gestes, mes idées, mes sentiments. Jamais ce ne sera la source vive et spontanée qu'on rêve dans son adolescence.”
Ainsi, j'ai voulu rester seul pour que soit pleinement et âprement reconnue la solitude de l'homme qui ne peut peupler la terre que de ses invocations : dieux et femmes.
Je n'ai pas compris que l'homme donne forme à la femme, mais qu'elle lui apporte sa substance, sa vie, cette magnifique matière brute de sa spiritualité qui appelle le ciseau. »
Pierre Drieu la Rochelle, Journal, 1939-1945
01:29 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
22/04/2020
Les langues se croisaient comme se croisent les vols des hirondelles
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Etais-je vieillissant, victime d’une sorte d’andropause ? Cela aurait pu se soutenir, et je décidai pour en avoir le cœur net de passer mes soirées sur Youporn, devenu au fil des ans un site porno de référence. Le résultat fut, d’entrée de jeu, extrêmement rassurant. Youporn répondait aux fantasmes des hommes normaux, répartis à la surface de la planète, et j’étais, cela se confirma dès les premières minutes, un homme d’une normalité absolue. Ce n’était après tout pas évident, j’avais consacré une grande partie de ma vie à l’étude d’un auteur souvent considéré comme une sorte de décadent, dont la sexualité n’était de ce fait pas un sujet très clair. Eh bien, je sortis tout à fait rasséréné de l’épreuve. Ces vidéos tantôt magnifiques (tournées avec une équipe de Los Angeles, il y avait une équipe, un éclairagiste, des machinistes et des cadreurs), tantôt minables mais vintage (les amateurs allemands) reposaient sur quelques scénarios identiques et agréables. Dans l’un des plus répandus, un homme (jeune ? vieux ? les deux versions existaient) laissait sottement dormir son pénis au fond d’un caleçon ou d’un short. Deux jeunes femmes de race variable s’avisaient de cette incongruité, et n’avaient dès lors de cesse de libérer l’organe de son abri temporaire. Elles lui prodiguaient pour l’enivrer les plus affolantes agaceries, le tout étant perpétré dans un esprit d’amitié et de complicité féminines. Le pénis passait d’une bouche à l’autre, les langues se croisaient comme se croisent les vols des hirondelles, légèrement inquiètes, dans le ciel sombre du Sud de la Seine-et-Marne, alors qu’elles s’apprêtent à quitter l’Europe pour leur pèlerinage d’hiver. L’homme, anéanti par cette assomption, ne prononçait que de faibles paroles ; épouvantablement faibles chez les Français ("Oh putain !", "Oh putain je jouis !", voilà à peu près ce qu’on pouvait attendre d’un peuple régicide), plus belles et plus intenses chez les Américains ("Oh my God !", "Oh Jesus Christ !"), témoins exigeants, chez qui elles semblaient une injonction à ne pas négliger les dons de Dieu (les fellations, le poulet rôti), quoi qu’il en soit je bandais, moi aussi, derrière mon écran iMac 27 pouces, tout allait donc pour le mieux. »
Michel Houellebecq, Soumission
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
16/04/2020
Paul Serey : « Avec le confinement, l’individu se retrouve isolé, mais en aucun cas solitaire »
=--=Publié dans la Catégorie "PARENTHÈSE"=--=
&
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
Paul Serey est écrivain. L’année dernière, il a fait paraître Le Carrousel des ombres aux éditions des Équateurs, un récit halluciné sur les traces du Baron Ungern. En pleine crise du Coronavirus, les journaux de confinement émanant du monde des lettres se multiplient. Paul Serey prend le contre-pied de cette démarche nombriliste et formule une réflexion de fond sur la nature des sociétés contemporaines.
PHILITT : Alors que nous entamons la troisième semaine de confinement général, il semble de bon ton d’interroger les écrivains, voire de leur demander de publier leur « journal de confinement ». Comment vivez-vous cet épisode ? Qu’est-ce qui pourrait inspirer un écrivain dans la période que nous vivons ?
Paul Serey : S’il s’agit pour moi de décrire ma propre vie comme un diariste, alors, factuellement, cela pourrait ne présenter aucun intérêt. Je dois dire que mon mode de vie, mon emploi du temps n’ont pas changé, n’était ma sortie hebdomadaire au bistrot sur laquelle je me vois obligé de tirer un trait.
Mais dire que rien n’a changé serait faux. Et c’est sur un point assez évident que doit se concentrer l’écrivain s’il doit décrire sa vie au jour le jour pendant cette période qui est autrement plus complexe pour chacun qu’un simple confinement. Nous sommes en effet plongés dans une certaine atmosphère. Et cette atmosphère est loin d’être neutre. Notre soi disant solitude, qui n’est à mon avis que matérielle, qui n’est qu’un isolement très relatif, est constamment polluée par la rumeur qui nous parvient de l’extérieur et par un je-ne-sais-quoi d’inquiétant qui tient à l’aspect insaisissable de l’épidémie et à son pouvoir de mort. Autrement dit parler de la solitude sans faire surgir cette ambiance pathologique, sans y voir le biais que constitue l’inquiétude serait passer complètement à côté du sujet.
L’individu se retrouve esseulé, isolé, mais en aucun cas solitaire au sens positif que l’on peut donner à la solitude vécue intérieurement, qui est une ascèse : une mortification du corps et un exercice spirituel exigeant, lesquels nous portent vers le haut, l’absolu ou Dieu selon nos croyances.
Deux choses sont donc essentielles pour l’écrivain, s’il devait écrire, dans la mesure où il est isolé : l’inquiétude et la rumeur dont sont sujets et objets les simples gens. L’inquiétude, parce que c’est un sentiment et qu’il transforme notre vision du monde et la façon dont nous l’interprétons ; la rumeur parce que c’est justement elle qui nous parvient de l’extérieur, d’un lointain, et qu’elle est à la fois sujet et objet de l’inquiétude évoquée précédemment.
Si je devais écrire, je décrirais par conséquent mon intranquillité, cette inquiétude diffuse qui me fait soudain voir le monde d’une façon autre. Et, à cette aune, j’interpréterais la rumeur qui me parvient dans mon huis clos. Mais qu’on me comprenne bien. Il ne s’agit pas nécessairement d’une impression qui serait vague, dans une atmosphère flottante. Je pourrais parfaitement décrire un certain nombre de faits, qu’ils soient ceux de ma vie quotidienne ; comme les changements d’aperception des plus simples objets ou modifications de mon comportement ; ou des événements dont l’écho parvient jusqu’à moi, comme l’agitation politique ou les emballements provoqués par la peur, ou que je peux vivre dans la vie réelle, comme la désertification du territoire ou les contrôles policiers, par exemple.
Même si, vous l’avez deviné, je pense que l’écrivain doit nécessairement faire la part belle à l’irrationalité de certains phénomènes de perception personnelle ou de développement de la rumeur, cela ne doit pas l’empêcher d’avoir une analyse rationnelle de son propre comportement et du monde qui l’entoure. Le brouhaha et les phénomènes psychiques engendrés par la peur ne sauraient lui faire perdre pied et lui épargner le sang froid et la responsabilité qu’il a en tant qu’interprète et descripteur de la réalité.
PHILITT : Qu’est ce que cette épidémie révèle de nos sociétés postmodernes selon vous ?
Paul Serey : Nous voilà dans le vif du sujet. Je ne prétends pas détenir la vérité. Mon interprétation est personnelle et l’histoire continue son chemin – Dieu sait ce qu’elle nous révélera !

Jude Law dans le film Contagion
Je crois que regarder le monde selon le seul angle politique serait une formidable erreur. Le politique n’a qu’une importance marginale dans ce qui se révèle actuellement. Le politique n’influence le cours de l’histoire que de façon limitée car il est largement déterminé par ce que j’appellerai les faits objectifs. Le fait objectif essentiel que l’on doit perpétuellement garder à l’esprit est la naissance et le développement de la société technologique. La démocratie moderne, représentative, n’est née, de façon chaotique et violente, que parce qu’elle est le mode de gestion le mieux adapté à ce qui est le phénomène le plus déterminant qui soit aujourd’hui : le système technologique. Et ce pour une raison simple : la démocratie exige de la part des simples gens une discipline qui confine à la soumission, beaucoup plus que dans le monde féodal, sous la monarchie absolue, voire sous la dictature. La démocratie représentative est à l’exact opposé de l’anarchie, parce qu’elle nécessite, à cause du développement technologique, lequel est autonome, la docilité des citoyens.
Pour vous donner une image de ce que j’avance, disons que les sociétés pré-industrielles étaient comme des organismes primitifs, comme un ver de terre par exemple. Le ver de terre, vous pouvez lui asséner un coup de couteau, il se scindera et les deux morceaux continueront de vivre indépendamment. La société technologique est un organisme complexe. Mettons un mammifère. Otez-lui un organe et il mourra. Cette société ne peut donc pas se permettre de perdre un de ses éléments vitaux. Il lui faut contrôler et tenir en place tout son organisme, sous peine de mourir. L’anarchie est donc ce que la mégamachine craint le plus. La mégamachine, à cause de sa complexité, est très fragile. Et c’est ça que nous révèle l’épidémie : la fragilité d’un système qui s’effondrerait si jamais l’un de ses monstres venait semer la pagaille.
L’épidémie est le grand révélateur. Le bain chimique qui nous dévoile, de plus en plus précisément, la photographie du système. Ce que nous commençons à voir, c’est l’extrême intrication de cette machinerie. C’est son extrême complexité. Nous voyons, et c’est cela même qui rend son analyse particulièrement ardue, une multiplicité d’engrenages, créés par le développement technologique autonome, qui se grippent d’un coup et, à cause de leur complexité même, que les pouvoirs politiques en place ne peuvent plus contrôler. L’on peut même déjà deviner que c’est le système lui-même qui, parce qu’il est incontrôlable, s’autodétruira. Ce système est si volatile qu’il engendre lui-même les monstres qui le dévoreront.
Beaucoup de gens commencent à voir à quel point ce système est malsain, mais une large majorité continueront simplement à vouloir le réformer, alors qu’il faudrait le détruire. La peur, la panique qui s’empare d’une majorité des citoyens ne suffira pas à créer ce nouveau fait objectif qui pourrait faire s’écrouler le système technologique : la révolution. Cette révolution, que j’appelle de mes vœux, n’aura pas lieu si le peuple accepte encore le moindre asservissement à la mégamachine.
Or, l’homme ordinaire, parce qu’on lui a lavé le cerveau, parce qu’on lui a donné le goût du confort, est prêt à se passer de sa propre autonomie, de sa liberté, pour maintenir le système technologique en place. Tout au mieux peut-on espérer un changement de régime. Mais il est plus que probable que nous n’aurons que des réformes, modérées de surcroît. Le système n’a intérêt à se réformer que pour pouvoir mieux se préserver. Le pouvoir politique fait visiblement de son mieux à cet égard. Mais nous ne pouvons que constater son incompétence, sa corruption, son hypocrisie et ses mensonges. La propagande, la filouterie, la magouille feront passer cette fièvre par pertes et profits.
Bref, l’épidémie nous révèle que le système est faillible. Il n’est qu’à regretter que selon toute vraisemblance cette faille ne sera pas exploitée. Je crois même que la mégamachine, qui ne vit que de ses crises, en profitera pour croître encore et contrôler et asservir de plus en plus les populations. On en voit déjà les prémices…
PHILITT : Le confinement implique pour ceux qui demeurent seuls un face-à-face peut-être douloureux avec eux-mêmes. On réapprend un peu la phrase pascalienne déclarant que tout le malheur des hommes est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre… On est en plein dedans non ?
Paul Serey : Certainement. Mais rester rester seul dans sa chambre dans cette atmosphère est tout autre chose qu’une paisible retraite. Néanmoins vous avez raison. Si l’homme du commun s’était battu pour conserver son autonomie, il goûterait pleinement le plaisir de se retrouver seul dans une chambre, sans avoir rien d’autre à faire que de jouir de la simple joie d’être en vie.
De nombreuses études anthropologiques montrent que dans les sociétés primitives, lorsque l’homme avait achevé sa journée de labeur, il avait le temps de s’adonner au plaisir de ne rien faire. Il avait non seulement plus de temps libre que l’homme moderne, mais en profitait d’autant plus pleinement qu’il avait le contrôle sur sa propre vie. Bien sûr, de nombreux dangers le guettaient, sans doute était-il parfois inquiet, mais n’avoir à se préoccuper que de l’essentiel, n’avoir qu’un travail purement nécessaire et utile, lui donnait la satisfaction indispensable pour jouir de son temps libre.
L’homme moderne, celui du système technologique, est privé par ce même système de son autonomie. Le système est cet homme qui, derrière votre dos, joue votre partie d’échec à votre place. Il joue à votre place et vous perdez le contrôle de la partie. Sans doute joue-t-il mieux que vous et sans doute appréciez-vous ce confort, mais vous avez perdu votre autonomie. Votre vie vous échappe. De là naît une angoisse terrible, que le système soigne à coups de psychotropes et de divertissements.
L’homme du commun est angoissé. Il ne peut plus réellement se regarder en face. Il ne peut que fuir, que se fuir. Se divertir, comme on dit. C’est le monde de Netflix, de World of warcraft et de YouPorn. S’affronterait-il aux grandes œuvres, à Pascal, qu’il serait incapable d’y comprendre quoi que ce soit. Et s’il y comprenait quelque chose, il éprouverait un vertige tel, une telle souffrance de se voir ainsi humilié, dénudé, qu’il cesserait aussitôt, déprimé. C’est une chose terrible que de se confronter à une grande œuvre, à une pensée puissante ou fulgurante… J’en ai peur moi-même…
Pourtant, j’aimerais tant que les gens se mettent à penser. Qu’ils comprennent dans quel monde nous vivons. Qu’ils se révoltent. Qu’ils détruisent ce système abominable. Mais je suis pas persuadé que cela soit possible. Oui, c’est un grand malheur de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre…
PHILITT : Une idée de lecture ou d’occupations pour nos lecteurs ?
Paul Serey : Je n’ai pas vocation à prodiguer de bons conseils… Je ne sais pas si les gens « prendront conscience » de quoi que ce soit. Mais peut-être, peut-être, est-ce l’occasion de reprendre le contrôle sur sa vie. Faire une activité utile, créer. Un potager, de la poésie, de la musique. Je ne conseillerais pas à tout le monde de rester seul dans sa chambre à réfléchir. C’est un exercice trop difficile et dangereux. Mais oui, jardiner si l’on en a l’occasion. S’aérer. Réapprendre les joies simples, les simples gestes. Faire attention à ne jamais être vulgaire ; autrement dit réapprendre à s’estimer. Se distraire juste ce qu’il faut. Regarder quelques bons films. Lire de la science fiction, des romans d’anticipation (Je pense notamment à Orwell, Huxley ou K-Dick), genre qui me paraît assez accessible et utile pour entamer une progressive réflexion sur l’avenir… Pour les chrétiens, les gens de foi, prier. Le monde a besoin de la prière. Pour tous, prendre soin de ses proches. Donner autant d’amour que possible…
------------------------
SOURCE : PHILITT
------------------------
01:21 Publié dans Lectures, Parenthèse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
11/04/2020
Inversion...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le christianisme devient une force permanente d’anti-subversion. C’est la mise au service de l’Etat par Louis XIV ou Napoléon. La mise au service du capitalisme par la bourgeoisie du XIX ème siècle. Dans le domaine des cultures, nous trouvons exactement la même inversion. Le christianisme s’imbibe comme une éponge de toutes les cultures et de leurs avatars. Dominé par la culture gréco-romaine, il est devenu terrien et féodal (le système des bénéfices), dans le monde féodal, avec, nous le verrons, toutes les croyances qui le peuvent garantir. Il est devenu urbain, bourgeois, argentifère avec le système capitaliste, et maintenant il devient socialiste avec la diffusion du socialisme. Il a servi a diffuser la culture occidentale dans le monde tant que l’Occident a été conquérant et qu’il asservissait le monde. Maintenant il se laisse pénétrer par les valeurs des cultures africaines, orientales, amérindiennes… il est du côté des "plus faibles", toujours habile à trouver sa justification, et nous auront demain un christianisme islamisé, exactement comme aujourd’hui nous avons un christianisme marxisé, hier un christianisme rationaliste (libéral) et avant-hier un christianisme aristotélisé après platonisé ; dérision du "se faire tout à tous". »
Jacques Ellul, La subversion du christianisme
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
10/04/2020
Quand il n'y a pas assez de contrevenants, on en fabrique
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Gouverner des hommes innocents est impossible. Le seul pouvoir d'un Etat, c'est de mettre les contrevenants hors d'état de nuire. Et quand il n'y a pas assez de contrevenants, on en fabrique. Il suffit de déclarer tellement de choses hors la loi qu'il devient impossible de vivre sans l'enfreindre. »
Ayn Rand, La Grève
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
09/04/2020
Petitement...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Je veux dire qu'ils finissent par ne connaître que ce qu'ils voient. Pire encore - leurs rêves ont dégénéré jusqu'à se faire semblables aux jours identiques qu'ils vivent petitement. Et ceux qui s'ennuient dans leur richesse n'imaginent pas ceux qui crèvent dans leur misère. »
Jacques Abeille, Les jardins statuaires
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
08/04/2020
Ma vie n’est pas quelque chose que l’on doive mesurer
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps, et, par la même occasion, celui des performances que l’on exige de moi. Ma vie n’est pas quelque chose que l’on doive mesurer. Ni le saut du cabri ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n’est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n’accomplit pas de performance : ce qui est parfait œuvre en état de repos. »
Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Homogénéisation
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« La notion des droits de l’homme est aujourd’hui la référence politique et morale commune en Occident. Tous les partis, toutes les écoles, toutes les "sensibilités" s’en réclament. Une telle unanimité sur un principe ultime de moralité et de légitimité est extrêmement rare sous nos climats. Peut-être faut-il remontent jusqu’à la période qui précède le Grand Schisme en Occident, peut-être faut-il remonter jusqu’aux alentours de l’an 1300 pour retrouver une homogénéité comparable des croyances. Ce fait d’opinion est important à relever. Il nous oblige à corriger un lieu commun selon lequel notre monde serait le cadre d’une explosion de diversité, d’une bigarrure, et d’un métissage croissants. Cela peut être vrai pour certains aspects superficiels de la vie contemporaine. Mais c’est certainement faux en ce qui concerne le principe des évaluations morales, qui est plus homogène que jamais. Ceux qui célèbrent la diversité qui leur semble le trait à la fois le plus plaisant et le plus noble de la société actuelle invoquent toujours ce qu’ils appellent "le droit à la différence". Au moment même où ils croient favoriser la différence, ils font tout le contraire, ils contribuent à l’homogénéisation de la société puisqu’ils traitent de la différence dans le langage des droits de l’homme. Si la "différence", laissons le terme sans définition puisque ses partisans le laissent en général indéterminé, est la matière ou l’objet, d’un droit de l’homme, alors on contribue à définir l’homme comme l’être qui a des droits, on enveloppe l’idée de la différence dans l’idée des droits, on travaille à accroître l’empire déjà sans rival de l’idée des droits de l’homme. Or, pour le dire en passant, la différence – gardons le mot – peut être appuyée d’une tout autre notion que celle de droit, et même d’une notion, en un sens, contraire, celle de devoir. »
Pierre Manent, Cours familier de philosophie politique
00:49 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
07/04/2020
Remède et poison...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ce qui est un remède pour l'un peut être un poison pour l'autre. On ne peut arriver à une vie saine et accomplie par l'application de règles et de principes généraux, car c'est toujours à l'individu de l'assumer. La solution est en chacun, et si vous savez vous y prendre dans votre propre cas, vous savez aussi comment faire dans d'autres cas. Il n'existe pas de principe général qui s'applique partout, et chaque position psychologique n'est vraie que si vous pouvez aussi la retourner en son contraire. Ainsi une solution qui serait tout simplement impossible pour moi peut se révéler la plus juste pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas l'arbiter mundi, et je laisse le créateur engager lui-même la réflexion sur la diversité et les paradoxes de sa création. »
Carl Gustav Jung, Correspondance
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les saints
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ce qui importe c’est de savoir ce qu’est exactement l’homme chrétien. Car il y a un type de l’homme chrétien, et ce type est consacré par l’Eglise elle même : c’est le saint. Les saints sont l’armée de l’Eglise. Juge-t-on la force d’un peuple sur la qualité de ses diplomates ? et bien les diplomates de l’Eglise ne valent pas grand-chose ; et précisément parce qu’ils sont médiocres, ils cèdent difficilement la place ; ils ressemblent à ces jongleurs maladroits qui recommencent vingt fois leur tour. Mais l’Eglise en arme, c’est l’Eglise debout et les saints au premier rang. »
Georges Bernanos, Lettre aux anglais
01:36 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ah ! Avoir un cheval, et partir au galop...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Ah ! avoir un cheval, et partir au galop, en chantant, peut-être vers quelqu’un que l’on aime, au coeur de toute la simplicité et de toute la paix du monde ; n’était-ce pas comme l’occasion offerte à l’homme par la vie même ? Évidemment non. Et, pourtant, une seconde, cela avait paru ainsi.
“Qu’est-ce que Goethe dit au sujet du cheval ? ” demanda-t-il.
“Las de la liberté, il accepta d’être sellé et bridé, et dut, pour sa peine, endurer jusqu’à la mort un cavalier.” »
Malcom Lowry, Au-dessous du volcan
01:27 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
06/04/2020
Le long des peupliers impairs...
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Le long des peupliers impairs
Combien de fois suis-je passé ?
Tous tes voisins me connaissaient,
Il n'y a que toi qui m'ignorais !
Et que de fois j'ai regardé
Vers ta fenêtre qui brillait !
Tout l'univers me comprenait,
Il n'y a que toi qui refusais.
Combien de fois ai-je espéré
Une réponse murmurée !
Un jour, un seul jour de ta vie,
Un jour de toi m'aurait suffi !
Être amis une heure, être amants,
Une heure, une heure seulement !
Te voir un instant me sourire,
Un seul instant et puis mourir !
D'un doux rayon de ton oeil clair
J'aurais su faire au firmament
Une étoile qui éclaire
La route à venir du temps.
Tu aurais eu vie éternelle
Et combien d’autres en plus d’elle !
Et quel beau marbre auraient donc fait
Tes bras si blancs, tes bras glacés !
Visage à jamais adoré,
Telles ces fées inégalées
Remontant jusqu’à nous
Des tréfonds du passé !
J’avais pour toi les yeux d’un chien
Car je t’aimais d’amour païen,
Du même amour que les miens
Avaient connu aux temps anciens.
Mais aujourd’hui peu m’importe
De ne plus voir souvent ta porte,
Ni de savoir que ton regard
Se retourne en vain pour me voir.
Car aujourd’hui tu ne m’attires
Ni par l’allure ni par le corps,
Je te regarde sans désir,
Pour toi mes yeux sont ceux d’un mort.
Tu aurais dû t’envelopper
De ton charme sacré
Et faire jaillir dans la nuit
Le feu de l’amour infini. »
Mihai Eminescu, "Le long des peupliers impairs..." in Poésies
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
05/04/2020
Ange gardien
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Quand mon âme, la nuit, veillait dans les extases,
Je voyais comme en rêve un ange gardien fier,
Vêtu d'un long manteau d'ombres et de lumière,
Ouvrir sur moi ses ailes et sourire comme un frère,
Mais dès que je te vis, dans ton vêtement clair,
Trop belle enfant drapée d'amour et de mystère,
Mon ange s'est enfui, vaincu par tes yeux verts,
Serais-tu donc démon pour qu'un seul regard vert,
Filtrant sous les longs cils de ton oeil grand ouvert
Ait pu faire s'enfuir mon bel ange si fier
Lui qui veillait sur moi, fidèle comme un frère ?
A moins que tu ne sois...! Veux-tu clore tes paupières
Et que je reconnaisse ton beau visage clair ?
Tu es lui, voilà tout le mystère. »
Mihai Eminescu, "Ange gardien" in Poésies
08:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook