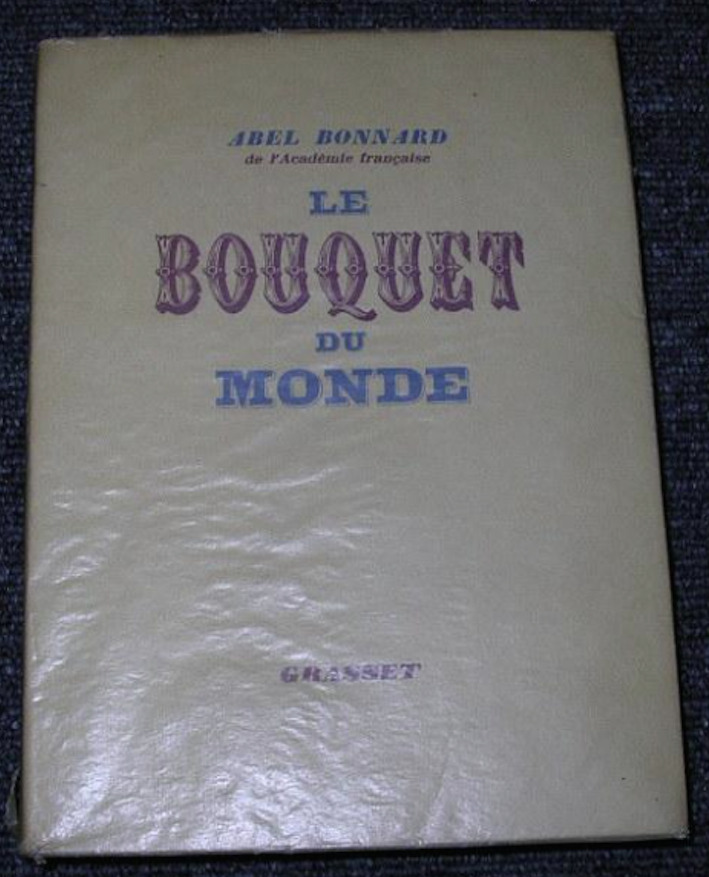04/01/2012
La Politique selon Dave Mustain
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Pour moi, les choses sont assez simples. Je veux pouvoir porter une arme ; écouter la musique que je veux ; manger, boire et être heureux ; et ne faire de mal à personne (sauf, bien entendu, si c'est de la légitime défense). C'est un résumé du Sermon sur la Montagne : traite autrui comme tu voudrais qu'il te traite. »
Dave Mustain, Splendeur et misère d'une icône trash
21:22 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Aujourd'hui j'ai vu Sainte-Sophie. A peine entré dans le monument, je n'ai plus eu à y faire un pas. Je lui appartenais tout entier.
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Aujourd'hui j'ai vu Sainte-Sophie. A peine entré dans le monument, je n'ai plus eu à y faire un pas. Je lui appartenais tout entier. Les autres édifices, quand ils sont d'une aussi vaste étendue, demandent que le visiteur les parcoure, afin de s'emparer successivement de toutes leurs perspectives. Ici l'on est aussitôt sous la domination de l'immense coupole ; elle rend tout l'édifice unanime. Quand un monument arrive à cette beauté souveraine, il n'est plus au pouvoir de personne de lui arracher son âme. On a pu faire du Parthénon une église, puis une mosquée, il n'a jamais daigné le savoir. A Sainte-Sophie, l'Islam n'est rien. Il a eu beau pendre à ses parois d'énormes inscriptions, elle témoigne à jamais pour cette somptueuse civilisation byzantine où l'art ne se sépare pas du faste ; les chapiteaux sont plus brodés encore que sculptés, les tribunes se creusent comme des grottes enchantées, l'oeil cherche encore les mosaïques sous le badigeon qui les a couvertes. Sainte-Sophie reste à jamais la grande Église, celle qui mettait en présence l'Empereur et Dieu, l'Autocrator et le Pantocrator, et où la hiérarchie des fonctionnaires était si exactement continuée par celle des Dominations et des Trônes qu'on ne devait pas voir exactement où elles s'attachaient l'une à l'autre.
A l'exception de cet édifice, presque tout ce qui représentait Byzance a péri. On la retrouve encore dans une magnifique citerne, dans quelques églises que l'Islam, au lieu de les détruire, s'est contenté d'envahir, et dans les remparts. Il est une de ces églises qui est restée dans mon souvenir. C'est la Kharié-Djami. Elle dépendait d'un couvent et date du temps des Comnène, mais presque toutes les mosaïques dont elle est décorée sont moins anciennes et ne remontent qu'au XIVè siècle. On la trouve tout près des murailles, au bout d'un de ces quartiers qui traînent et se défont dans la solitude. Il était midi quand j'y arrivai. Le vieux muezzin, penché sur le balcon du minaret, distribuait d'une voix cassée son appel aux quatre horizons. Après quoi il redescendit dans la mosquée, où quelques fidèles faisaient leur prière, avec les prosternations prescrites. Cependant, les mosaïques des deux narthex me racontaient l'histoire du Christ et celle de la Vierge. »
Abel Bonnard, "Constantinople", in Le bouquet du monde
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
03/01/2012
Nous ne renoncerons pas à Jésus-Christ, mais nous ne renoncerons pas davantage à Epicure et à Pyrrhon. Que les barbus se mettent bien ça dans le ciboulot.
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Les idéologues musulmans puisent leur énergie missionnaire dans cette conviction que l’Europe déchristianisée, ignorante de sa propre tradition religieuse, est un fruit blet prêt à tomber dans le vert tablier de Mahomet. L’effacement de la foi chrétienne laisse un vide et il est naturel que les plus excités d’entre les islamistes soient persuadés que ce vide, ils n’auront aucune difficulté à le combler. L’ancien chancelier allemand Helmut Kohl a, lors d’un récent séjour à Rome, déclaré que s’il avait été un des auteurs de la Constitution européenne il se serait battu pour qu’y figurât une explicite référence à nos racines chrétiennes. Et il a ajouté : "Au lieu de céder au laïcisme à la française, nous devons le combattre."
C’est vrai, il y a des Français ringards qui s’imaginent qu’il suffit de tonner contre le Vatican pour acquérir un brevet d’esprit libre. Il y a une France jacobine pour qui l’histoire de notre pays commence en 1789 et qui nous casse les pieds avec les "valeurs républicaines" dont elle a en permanence la bouche pleine. Cette France sectaire et vieillotte nous ennuie.
Il convient toutefois ne pas tomber dans un excès opposé. Certes, le christianisme aura été, de Madrid à Moscou, de Stockholm à Palerme, un des creusets où s’est formé le génie européen, et pour s’en convaincre il suffit de visiter à Amsterdam l’exposition qui réunit présentement Rembrandt et le Caravage. Il n’est cependant pas le seul, et le paganisme gréco-romain en est un autre. Les Psaumes et le Sermon sur la Montagne sont pour nous, depuis plus de deux mille ans, une inépuisable source d’élévation spirituelle, mais le Contre les moralistes de Sextus Empiricus et les Lettres à Lucilius de Sénèque ne le sont pas moins. On m’affirme que dans l’Iran d’aujourd’hui la lecture de poètes tels que Saadi, Omar Khayyam, Abou Nawas, qui chantent le vin, l’amour, les jeunes personnes, le scepticisme, le dolce farniente, est proscrite. Si c’est vrai, je le déplore pour les Iraniens, mais nous, en Europe, personne ne nous empêchera de continuer à lire Théocrite et Horace qui font partie de notre héritage, de notre univers esthétique et moral au même titre que Dante et Bossuet. Nous ne renoncerons pas à Jésus-Christ, mais nous ne renoncerons pas davantage à Epicure et à Pyrrhon. Que les barbus se mettent bien ça dans le ciboulot. »
Gabriel Matzneff, Sextus Empiricus contre les barbus (Chronique du 21/03/2006 )
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
02/01/2012
Le socialisme est réactionnaire au sens le plus profond
=--=Publié dans la Catégorie "Friedrich Nietzsche"=--=
« Le socialisme est le frère cadet et fantasque du despotisme agonisant, dont il veut recueillir l'héritage ; ses aspirations sont donc réactionnaires au sens le plus profond. Car il désire la puissance étatique à ce degré de plénitude que seul le despotisme a jamais possédé, il surenchérit même sur le passé en visant à l'anéantissment pur et simple de l'individu ; lequel lui apparait comme un luxe injustifié de la nature qu'il se croit appelé à corriger pour en faire un organe utile de la communauté. A cause de cette affinité, il se montre toujours au voisinage de tous les déploiements excessifs de puissance, comme le vieux socialiste Platon, à la cour du tyran de Sicile.»
Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, § 473
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (12) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
01/01/2012
Chez les peuples usés mentalement
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Chez des races vigoureuses, énergiques, arrivées au point culminant de leur développement, on observe, aussi bien sous des institutions républicaines que sous des institutions monarchiques, l’extension considérable de ce qui est confié à l’initiative personnelle, et la réduction progressive de ce qui est confié à l’Etat. "Chez les peuples usés mentalement", le gouvernement est toujours un pouvoir absorbant tout et régissant les moindres détails de la vie du citoyen. Le socialisme n’est que l’extension de cette conception. »
Gustave le Bon, Psychologie du Socialisme
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
31/12/2011
Le langage symbolique
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Si l'on reconnaît l'insuffisance du langage ordinaire pour exprimer "l'inexprimable", il reste tout de même, pour approcher ce mystère, la ressource du langage symbolique, qui suggère beaucoup plus que ce qu'il dit, comme une parole qui meurt sous le poids trop grand de la contemplation silencieuse qu'elle contient. C'est pourquoi le langage symbolique, riche de la pluralité de son sens, constitue le langage initiatique par excellence, le véhicule indispensable de tout enseignement traditionnel. »
Lucien Méroz, René Guénon ou la sagesse initiatique
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
30/12/2011
L'esprit du siècle
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Il faut marcher avec son siècle, disent les hommes qui prennent pour un siècle les courts moments où ils ont vécu. Mais, depuis Tacite, on appelle l'esprit du siècle tous les désordres qui y dominent. Ce n'est pas avec un siècle, c'est avec tous les siècles qu'il faut marcher. »
Louis de Bonald, Réflexions sur l’intérêt général de l'Europe
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Au contact du nihilisme à l’œuvre en Occident
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« J’ai quitté l’enseignement public non seulement parce que je m’y ennuyais à mourir, mais parce que je n’y supportais plus d’y voir la langue française piétinée au point de n’être plus qu’un instrument de propagande de la pensée dominante. J’ai vu mourir une culture. J’ai dit, et je le maintiens, quoique cette affirmation m’ait naguère valu le pilori, que l’évacuation de la dimension littéraire de la langue au profit de sa démocratisation utilitaire a eu lieu en grande partie pour ne pas désespérer les enfants d’immigrés. Une langue sacrifiée à la paix civile, c’est la mort d’une culture millénaire. Je n’en rends nullement les immigrés responsables ; les semeurs de vent, ce sont les idéalistes post chrétiens et les marchands d’esclaves au pouvoir. Les reliquats hystériques du gauchisme ont fait le reste : évacuer la dimension spirituelle de la culture. On comprend dés lors que nous soyons méprisés par ces mêmes immigrés : comment l’Islam, quand bien même il n’en serait pas l’allié objectif, ne trouverait-il pas à se renforcer au contact du nihilisme à l’œuvre en Occident ? »
Richard Millet, L’opprobre
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
29/12/2011
Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'Arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. A cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait de toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. »
Albert Camus, L'étranger
Standing on the beach
With a gun in my hand
Staring at the sea
Staring at the sand
Staring down the barrel
At the arab on the ground
I can see his open mouth
But I hear no sound
I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an arab
I can turn
And walk away
Or I can fire the gun
Staring at the sky
Staring at the sun
Whichever I chose
It amounts to the same
Absolutely nothing
I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an arab
I feel the steel butt jump
Smooth in my hand
Staring at the sea
Staring at the sand
Staring at myself
Reflected in the eyes
Of the dead man on the beach
The dead man on the beach
I'm alive
I'm dead
I'm the stranger
Killing an arab
07:04 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
28/12/2011
Un cas extrême de nouvel alignement
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Une approche frappante de l’approche contemporaine de cette guerre de quatorze siècles a été donnée le 8 octobre 2002, par le premier ministre français de l’époque, Jean-pierre Raffarin, dans son discours sur l’Irak à l’assemblée nationale. Evoquant devant les députés la figure de Saddam Hussein, il releva qu’un des personnages historiques favoris de Saddam Hussein était son compatriote Saladin, lui aussi originaire de la ville de Tikrit. Au cas ou les députés auraient ignoré qui était Saladin, Jean-pierre Raffarin tînt à préciser qu’il fut celui "qui défit les croisés et libéra Jérusalem". Qu’un premier ministre catholique présente la prise de Jérusalem par Saladin comme une libération de la domination des croisés, français de surcroît pour la plupart, témoigne d’un cas extrême de nouvel alignement, sinon des loyautés, du moins des perceptions des choses. »
Bernard Lewis, L’Europe et l’Islam, Le débat, mai 2008
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
27/12/2011
Qu'il soit anathème !
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. »
Saint Paul, Épitre aux Galates, 1 : 8 (Sainte Bible)
12:55 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
26/12/2011
Un roman pour la vie
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
La parole est à ma douce Irina... 
--------------
J'ai lu "La Grève" (Atlas Shrugged) d'Ayn Rand, je voulais en faire un compte-rendu parce que c'est un roman à côté duquel on ne peut pas passer, et puis un ami m'a fait lire son compte-rendu de lecture.
Non par paresse (enfin, quoique...) mais surtout parce que je l'ai trouvé pertinent, je souhaiterais vous le faire partager (en attendant de me coller à mon propre compte-rendu que je mettrai en ligne dès que je le pourrai).
Histoire quand même de vous mettre l'eau à la bouche, de vous faire franchir le pas, et surtout de passer outre aux critiques de toute sorte concernant l'idéologie d'Ayn Rand.
Certes, son système de pensée est pleinement développé dans ce roman et ceux qui la connaissent et l'apprécient y trouveront leurs repères. Mais c'est aussi un roman, bien écrit (et dans ce cas extrêmement bien traduit) où les personnages sont tous hauts en couleurs (y compris ceux qu'on apprend à détester au fil de la lecture), le suspense est là du début à la fin, l'amour aussi (un côté un peu "soap" d'ailleurs, mais il faut remettre ça dans le contexte, n'oublions pas que ce roman a été écrit dans les années 50) et la philosophie d'Ayn Rand, qui ne peut laisser indifférent.
Bref, que de bons ingrédients qui ne vous feront pas regretter votre achat (pour ceux qui franchiront le pas !)
Merci Vincent.
--------------
" La Grève, d’Ayn Rand, est-elle un roman à thèse, en ce sens qu’elle y illustrerait et y défendrait ses idées ? Oui. Mais le condamner pour ce seul motif aurait quelque chose d’absurde, comme si le roman et l’expression de conceptions philosophiques était incompatibles, et comme si tout grand roman n’était pas, en son fond, l’expression, explicite ou non, d’une vision du réel et de l’homme. À ce compte, il faudrait condamner tout Balzac et Zola, jeter Camus à la poubelle. Le vrai problème serait-il qu’elle n’y défend pas les « bonnes » thèses ? Écartons ces polémiques stériles. Et tentons de répondre à cette question de la manière la plus factuelle possible : La Grève est-elle, oui ou non, un bon roman ?
La charge critique de l’expression – en soi péjorative – de « roman à thèse » repose sur l’insinuation que le texte visé serait en réalité plus une thèse qu’un roman, le plaquage d’une narration artificielle sur une armature théorique préexistante qui constituerait le seul niveau de lecture pertinent. Un prétexte, en un mot, à l’expression plus ou moins directe des théories de l’auteur. Or, si Ayn Rand a des idées bien établies, si elle les exprime en certains endroits de manière explicite et si elles la poussent à recourir quelquefois à des facilités que l’on est en droit de regretter – ainsi les pseudo-défenseurs de l’intérêt général qu’elle met en scène sont l’incarnation d’une médiocrité intégrale, et j’aurais aimé qu’elle se donne une adversité plus consistante que ces fantoches –, ce serait réellement faire injure à son œuvre que de la réduire à ses seules dimensions théoriques. Si les déboires du réseau de chemin de fer transcontinental que dirige Dagny Taggart, une femme d’affaire dotée d’une force de caractère peu commune, semblent constituer de prime abord l’intrigue principale, le lecteur découvre progressivement qu’il n’en est rien. Elle n’est qu’une des nombreuses intrigues que contient ce roman luxuriant, qui toutes finissent par trouver leur unité et leur pleine signification avec la résolution de la question lancinante qui ponctue tout le texte : « Qui est John Galt ? » L’intérêt du lecteur est donc non seulement motivé par la curiosité qui le pousse à savoir comment Dagny Taggart et Hank Rearden, son partenaire sidérurgiste, vont résoudre les problèmes entrepreneuriaux qu’ils rencontrent, mais aussi par cette intrigue de type policière qui y est instillée. Roman industriel, roman policier, La Grève appartient aussi pour partie aux genres de la science et de la politique-fiction : ainsi, Hank Rearden est-il l’inventeur d’un métal révolutionnaire, le Rearden Metal, aux intrigants reflets bleu-vert, incomparablement plus léger et plus résistant que l’acier ; plus tard dans l’intrigue, il découvre avec Dagny, dans une usine abandonnée, les restes d’un moteur de type inédit, capable de produire une quantité d’énergie qui était jusque-là inconcevable ; tout cela sur fond de multiplication des républiques populaires et de tentatives de plus en plus poussées du gouvernement américain, au nom de l’« égalité des chances », pour régenter toute l’économie. Enfin, et ce serait manquer un aspect essentiel de La Grève que de ne pas en faire mention, ce roman est aussi un grand roman d’amour. Dagny, toute impitoyablement rationnelle qu’elle soit dans la conduite de ses affaires, n’est pas qu’un pur intellect. Elle est, au fil du roman, initiée à des sentiments de plus en plus élevé, fondé sur l’admiration qu’elle voue à ses partenaires et sur le partage de valeurs fondamentales – au premier chef, celle de l’amour de la vie –, qui s’incarne dans des relations charnelles passionnées, d’une très grande intensité. J’ai rarement lu des scènes érotiques aussi fortes et aussi bien menées. Même la description du désir masculin est d’une confondante précision. Dans ces pages, magnifiques, Ayn Rand parvient à chanter la quintessence de la vie comme peu d’autres auteurs l’ont réussi avant elle, et elle réussit dans ces instants de grâce à donner à son lecteur un avant-goût de ce vers quoi toute son œuvre tend : le paradis terrestre, ou plus précisément la restauration de la terre comme paradis.
Outre de véritables morceaux de bravoures littéraires, comme l’extraordinaire description du voyage qu’effectuent Hank et Dagny à bord de la motrice du train inaugurant la première ligne construite en Rearden Metal, j’ai particulièrement apprécié l’art consommé des dialogues – excellemment traduits par Sophie Bastide-Foltz – qui se manifeste dans toute cette œuvre. Appuyés sur des analyses psychologiques d’une rare finesse, qui insufflent une âme à des personnages dont on aurait pu craindre qu’ils soient totalement engoncés dans un manichéisme sans nuance, ils donnent lieu à des échanges d’une vigueur que j’ai rarement vues. Je n’y ai pas trouvé de scories, de ces phrases insipides que l’on rencontre dans de trop nombreux romans et qui n’ont pour seul but que de produire un « effet de réel » superflu et lassant. Toutes les répliques se tiennent, notamment grâce à une implacable exigence logique qui permet d’aller creuser les fissures des mots et de révéler les impostures que certains dissimulent. De fait, ces dialogues, sous une forme très vivante et souvent jubilatoire – les duels verbaux de Dagny et de Lillane, la redoutable et perverse épouse de Hank, sont un chef-d’œuvre du genre –, constituent une authentique enquête sur le langage lui-même, à travers la mise en contraste de deux manières de l’employer : celui, clair, précis, objectif, des entrepreneurs confrontés à des faits auxquels ils se doivent de faire face, et celui, sans substance, vague, pleins de doubles sens et de sous-entendus, truffé de grandes notions incantatoires devant lesquelles toute volonté devrait plier à l’instant, des « parasites » et des « pillards » – entendons des politiques et de ces entrepreneurs corrompus qui comptent plus sur la manipulation et l’intrigue pour conquérir le pouvoir et bâtir leur fortune que sur leur travail et leur compétence.
La moindre des surprises que réserve La Grève n’est pas, en effet, la découverte qu’Ayn Rand n’y déploie pas une apologie inconditionnelle du dollar mais qu’elle y mène une vaste réflexion morale nettement plus subtile. « Faire de l’argent » n’est pas pour elle un but qui justifie tous les moyens. Le traitement qu’elle inflige au frère de Dagny, Jim, ou à l’un des concurrents de Hank, Orren Boyle, est sans ambiguïté sur ce point : ces personnages sans talent, ces hommes sans qualité, ne parviennent à leurs fins qu’en usant de basses manœuvres et en manipulant la notion d’« intérêt général » à leur profit. Leur sens de la justice sociale n’est qu’un paravent destiné à casser des concurrents plus talentueux qu’eux. Mais ces personnages sont encore bien plus que de simples figures d’hypocrites manipulateurs : ils incarnent l’anti-individu par excellence. Ainsi Jim n’est animé par aucune intériorité, par aucun désir, par aucun but personnel, si ce n’est celui d’être aimé inconditionnellement, sans raison, pour rien. Sa conception pervertie de l’amour, fondée sur son néant spirituel, est un nihilisme de fait. Elle se couple à l’idée qu’on ne peut aimer au sens plein que des êtres faibles et méprisables, sous prétexte qu’il n’y a aucun « mérite » à aimer quelqu’un pour ses qualités. Par conséquent, si jamais la personne sur laquelle il a jeté son dévolu se révèle moins nulle qu’il ne l’imaginait, il s’emploie sadiquement à la détruire. Jim n’est qu’un conformiste : il ne fait que désirer ce que tout le monde désire (l’amour, le succès, la reconnaissance sociale), en estimant – comme tout le monde – qu’il n’y a pas moins droit que ses voisins, et qu’il est donc fondé à s’emparer de ce qui lui est dû. À l’inverse, un individu authentique est d’abord une personne qui n’est pas engluée dans le mimétisme social, et donc, parce qu’elle est capable de nager à contre-courant, qui est le vecteur de la création et de l’innovation. Conséquent avec lui-même, cet individu assume l’entière responsabilité, sociale et financière, de cette attitude. Il est prêt à accepter, temporairement ou définitivement, la condition de paria, comme il est prêt à accepter la ruine et la pauvreté. Il estime que rien ne lui est dû tant qu’il n’a pas établi la preuve objective de ses qualités. Mais si la réussite survient, grâce à ses compétences personnelles et à sa volonté acharnée, il entend en contrepartie en recueillir le maximum de fruits. Gagner de l’argent, dans ce cadre, est la matérialisation du mérite personnel, la juste récompense de l’effort consenti. Le dollar est donc bien plus que le symbole d’une monnaie : il est le symbole d’un système de valeurs où la qualité des individus reçoit sa pleine récompense, et où les droits du créateur sur les produits de son intelligence sont pleinement reconnus – y compris les droits de ne pas l’exploiter ou de le détruire. Le capitalisme est donc préférable au collectivisme non parce qu’il est plus efficace que lui, mais parce qu’il est, fondamentalement, plus moral. Comment, en effet, être heureux, comment avoir confiance dans la vie et dans les autres si, du jour au lendemain, des apôtres de l’étatisme peuvent faire main basse sur vos biens et vous priver de toute perspective de progrès personnel ? Comment, alors, ne pas se sentir dépossédé de sa propre existence ? Rappelons que, née en Russie en 1905, Ayn Rand eut une connaissance de première main de ce que signifiait concrètement vivre sous un régime collectiviste totalitaire.
Certes, on pourrait reprocher à Ayn Rand d’avoir accentué l’aspect héroïque, presque surhumain, de ses principaux personnages : ils sont jeunes, beaux, supérieurement intelligents, et capables de maîtriser leurs passions même les plus violentes. Mais, outre que par ces aspects ils rattachent le texte, par-delà l’apothéose moderne du bon sens bourgeois et de la figure donquichottesque du raté magnifique, à la grande tradition de l’épopée classique, leur mentalité dénuée de toute complaisance, leurs propos d’apitoiement sur eux-mêmes lui confère une extraordinaire énergie. Si elle jette sur le monde un regard sans concession, Ayn Rand est tout sauf une cynique, et encore moins une désespérée. Dans La Grève le monde se nimbe d’un immense « c’est possible ». Et quel bien fou cela fait ! Cette mise en scène d’individus forts, animés par des idéaux exigeants dont ils assument personnellement les conséquences – au lieu de les faire subir aux autres sans le moindre scrupule –, a quelque chose de salvateur en ces temps de grisaille, de petitesse, de culpabilisation galopante et d’altruisme menteur. La prise en main de son existence, le refus d’une fatalité sourde, le désir de vivre réellement – c’est-à-dire, indissociablement avec l’intensité accrue de la vie, dans la connaissance rigoureuse du réel – sont des principes d’une incontestable valeur, dont l’expression aussi claire a quelque chose de soulageant : oui, il existe encore quelque chose de la grandeur humaine. Et l’effacement de l’individu n’est plus l’horizon indépassable du meilleur des mondes. Je n’ai plus besoin de disparaître pour que le monde devienne vivable : au contraire, pour perdurer il a besoin de moi.
Brillant, atypique, iconoclaste, La Grève est donc plus qu’un roman qui prend la doxa collectivo-humanitariste à contrepied : elle est la seule véritable épopée que le xxe siècle ait produite, et la preuve que la littérature peut encore exister sans devoir afficher de posture ironique, arborer des grimaces nihilistes, s’embourber dans des marigots kitsch. La foi en l’homme qui y est exprimée, précisément parce qu’elle donne l’impression d’être surannée, fournit aussi l’occasion d’un retour salutaire sur le prétendu « humanisme » dont nous faisons profession : quelle humanité aimons-nous vraiment, si cette figure d’homme rationnel, indépendant et respectueux de la liberté d’autrui nous rebute a priori à ce point ? Quand bien même on ne la partagerait pas de manière intégrale, cette vision énergique et positive de l’homme laisse, malgré ses outrances, le lecteur bienveillant sur un réel enthousiasme, un enthousiasme dont je gage qu’il puisse devenir, pour certains, un viatique pour longtemps."
Vincent Morch
22:30 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le désir de voir disparaître des types tels que moi
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Quelle insanité ai-je proférée en constatant que ce pays n’est pas encore le Brésil ou Cuba mais une nation de race blanche avec des minorités étrangères ! Que l’émigration africaine soit, par exemple, un drame pour les immigrés comme pour les français de souche, qu’une immigration chrétienne soit préférable à une immigration musulmane, voilà qui ma parait relever du bon sens, tout comme le fait que la France ne doive pas se renier elle-même pour maintenir la paix civile menacée par ces minorités. Je me rappelle que le moment où j’ai compris que la France était morte (ou appelée à devenir tout autre chose que ce qu’on m’avait appris qu’elle était depuis des siècles) eut lieu lorsque, enseignant et évoquant tel épisode de l’histoire de France, j’ai cessé de pouvoir dire "nous", sans rien trouver qui remplaçât ce signe d’appartenance heureuse et, dès lors, entrant dans une sorte de déréliction que nul discours politique ne pouvait apaiser. La France que vous me proposez d’aimer, celle que vous me désignez comme la France de demain en me montrant ce groupe de jolies maghrébines et de jeunes noires habillées de manière provocante, cette France là m’est étrangère : pour reprendre votre langage pour le retourner contre vous qui me pensez "raciste" , je dirais que j’y vis dans un apartheid mental, moi que le destin muséal et multiculturel de ce pays horrifie, qui ne crois nullement au repli sur soi, qui ait été élevé dans le cosmopolitisme Beyrouthin. Mais je suis bien obligé de reconnaître que tout ce que j’aime est piétiné quotidiennement au nom du consensus antiraciste et par peur de déplaire à l’islam. C’est vous qui avez fait mourir ce pays en moi, bâtisseurs d’empires boursiers, gauchistes apostats et technocrates si inconséquents que vous avez laissé ce déliter cette langue qui, à elle seule, disait Joseph de Maistre, , définit une nation. George Orwell, lui, pour me référer à un auteur moins compromettant, disait que la dégradation d’une langue va de pair avec la décomposition politique. Qu’est-ce qui agitait donc l’angélique prêcheur qui me vantait la créolisation de la France ? Moins la haine de la France que son désir de voir disparaître des types tels que moi qui errent comme un loup sur les terres du passé, prétendait-il, alors que j’ai toujours été à la lisière, à l’orée, prêt à bondir dans le futur. »
Richard Millet, L’opprobre
15:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Il ne nous est acceptable que par ses femmes et ses mystiques
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Là ou l’islam est soluble, c’est dans l’innombrable multiculturel des USA. Plaçons le dans une petite société fragile telle le Québec, il devient le vecteur même de sa destruction, révélant par là sa vérité : 300 000 musulmans sur quelques millions de Québécois déchristianisés et nous avons une problématique Libanaise. Si l’on excepte le moment dialectique de l’Empire ottoman, où, après son établissement, les autres religions ont été tolérées, force est de constater que depuis le VIIème siècle, l’islam ne fait que détruire les sociétés où il s’implante, et aujourd’hui plus que jamais, parce que, ayant digéré Mac Donald’s, Disney et Microsoft, il rencontre un vide spirituel sidéral. Il ne nous est acceptable que par ses femmes et ses mystiques - transactions qui ont lieu dans le secret des chambres ou de l’esprit, et qui m’empêchent de voir cet autre comme l’ennemi absolu. »
Richard Millet, L’opprobre
01:09 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
25/12/2011
N’ayant que Dieu pour témoin de mes pensées, et auquel je puisse m’adresser, je déclare ici en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments.
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
TESTAMENT DU ROI LOUIS XVI
Ecrit de sa main à la Tour du Temple le 25 décembre 1792
« Au nom de la très Sainte Trinité, du Père, du fils et du Saint Esprit. Aujourd’hui vingt-cinquième de décembre mil sept cent quatre vingt douze. Moi, Louis, XVIème du nom, Roi de France, étant depuis plus de quatre mois enfermé avec ma famille dans la Tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le onze du courant avec ma famille. De plus impliqué dans un Procès dont il est impossible de prévoir l’issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n’ayant que Dieu pour témoin de mes pensées, et auquel je puisse m’adresser. Je déclare ici en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments.
Je laisse mon âme à Dieu mon créateur, et je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d’après ses mérites, mais par ceux de Notre Seigneur Jésus Christ qui s’est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier.
Je meurs dans l’union de notre sainte Mère l’Église Catholique, Apostolique et Romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint Pierre auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le Symbole et les commandements de Dieu et de l’Église, les Sacrements et les Mystères tels que l’Église Catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n’ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d’expliquer les dogmes qui déchirent l’Église de Jésus-Christ, mais je m’en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m’accorde vie, aux décisions que les supérieurs Ecclésiastiques unis à la Sainte Église Catholique, donnent et donneront conformément à la discipline de l’Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon coeur nos frères qui peuvent être dans l’erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ suivant ce que la charité Chrétienne nous l’enseigne.
Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés, j’ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m’humilier en sa présence, ne pouvant me servir du Ministère d’un Prêtre Catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et surtout le repentir profond que j’ai d’avoir mis mon nom, (quoique cela fut contre ma volonté) à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l’Église Catholique à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de coeur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s’il m’accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du Ministère d’un Prêtre Catholique, pour m’accuser de tous mes péchés, et recevoir le Sacrement de Pénitence.
Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance (car je ne me rappelle pas d’avoir fait sciemment aucune offense à personne), ou à ceux à qui j’aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu’ils croient que je peux leur avoir fait.
Je prie tous ceux qui ont de la Charité d’unir leurs prières aux miennes, pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés.
Je pardonne de tout mon coeur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en aie donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle, ou par un zèle mal entendu, m’ont fait beaucoup de mal.
Je recommande à Dieu, ma femme, mes enfants, ma Soeur, mes Tantes, mes Frères, et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang, ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma soeur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s’ils viennent à me perdre, et tant qu’ils resteront dans ce monde périssable.
Je recommande mes enfants à ma femme, je n’ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux ; je lui recommande surtout d’en faire de bons Chrétiens et d’honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs de ce monde ci (s’ils sont condamnés à les éprouver) que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leurs regards vers la seule gloire solide et durable de l’Éternité. Je prie ma soeur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants, et de leur tenir lieu de mère, s’ils avaient le malheur de perdre la leur.
Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu’elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher.
Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu’ils doivent à Dieu qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissants de tous les soins et les peines qu’elle se donne pour eux, et en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma soeur comme une seconde mère.
Je recommande à mon fils, s’il avait le malheur de devenir Roi, de songer qu’il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu’il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport aux malheurs et aux chagrins que j’éprouve. Qu’il ne peut faire le bonheur des Peuples qu’en régnant suivant les Lois, mais en même temps qu’un Roi ne peut les faire respecter, et faire le bien qui est dans son coeur, qu’autant qu’il a l’autorité nécessaire, et qu’autrement, étant lié dans ses opérations et n’inspirant point de respect, il est plus nuisible qu’utile.
Je recommande à mon fils d’avoir soin de toutes les personnes qui m’étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c’est une dette sacrée que j’ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu’il y a plusieurs personnes de celles qui m’étaient attachées, qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient, et qui ont même montré de l’ingratitude, mais je leur pardonne, (souvent, dans les moment de troubles et d’effervescence, on n’est pas le maître de soi) et je prie mon fils, s’il en trouve l’occasion, de ne songer qu’à leur malheur.
Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m’ont montré un véritable attachement et désintéressé. D’un côté si j’étais sensiblement touché de l’ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n’avais jamais témoigné que des bontés, à eux et à leurs parents ou amis, de l’autre, j’ai eu de la consolation à voir l’attachement et l’intérêt gratuit que beaucoup de personnes m’ont montrés. Je les prie d’en recevoir tous mes remerciements ; dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement, mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître.
Je croirais calomnier cependant les sentiments de la Nation, si je ne recommandais ouvertement à mon fils MM de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait portés à s’enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry des soins duquel j’ai eu tout lieu de me louer depuis qu’il est avec moi. Comme c’est lui qui est resté avec moi jusqu’à la fin, je prie MM de la Commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse, et les autres petits effets qui ont été déposés au Conseil de la Commune.
Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient, les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J’ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur coeur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser.
Je prie MM de Malesherbes, Tronchet et de Sèze, de recevoir ici tous mes remerciements et l’expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu’ils se sont donnés pour moi.
Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant Lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. »

------------------------
------------------------

16:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
24/12/2011
Paul Celan : "Dans la lanière de prière blanche"
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Le Seigneur de cette heure
était
une créature d’hiver, c’est
pour lui plaire
qu’est arrivé ce qui est arrivé –
ma bouche en grimpant s’est accrochée avec les dents, une fois encore
quand elle t’a cherchée, toi, trace de fumée,
là-haut,
silhouette de femme,
toi en voyage vers mes
pensées de feu dans le gravier noir
au-delà des mots de fission à travers
lesquels je t’ai vue marcher, haut
perchée sur tes jambes avec
ton opiniâtre tête aux lèvres
lourdes
sur le corps
tenu vivant par mes
mains
mortellement précises.
Dis à tes
doigts qui t’accompagnent
jusqu’aux gouffres, combien
je t’ai connue, combien je t’ai
poussée loin dans les profondeurs, où
mon rêve le plus amer
a de cœur couché avec toi, dans le lit
de mon inarrachable nom. »
Paul Celan, Renverse du souffle
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
22/12/2011
L’opinion des foules tend donc à devenir de plus en plus le régulateur suprême de la politique
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« L’opinion des foules tend donc à devenir de plus en plus le régulateur suprême de la politique. Elle arrive aujourd’hui à imposer des alliances, comme nous l’avons vu pour l’alliance russe, presque exclusivement sortie d’un mouvement populaire.
C’est un symptôme bien curieux de voir de nos jours papes, rois et empereurs, se soumettre au mécanisme de l’interview, pour exposer leur pensée, sur un sujet donné, au jugement des foules. On a pu dire jadis que la politique n’était pas chose sentimentale. Pourrait-on le dire actuellement encore en la voyant prendre pour guide les impulsions de foules mobiles ignorant la raison, et dirigées seulement par le sentiment ?
Quant à la presse, autrefois directrice de l’opinion, elle a dû, comme les gouvernements, s’effacer devant le pouvoir des foules. Sa puissance certes est considérable, mais seulement parce qu’elle représente exclusivement le reflet des opinions populaires et leurs incessantes variations. Devenue simple agence d’information, elle renonce à imposer aucune idée, aucune doctrine. Elle suit tous les changements de la pensée publique, et les nécessités de la concurrence l’y obligent sous peine de perdre ses lecteurs. Les vieux organes solennels et influents d’autrefois, dont la précédente génération écoutait pieusement les oracles, ont disparu ou sont devenues feuilles d’informations encadrées de chroniques amusantes, de cancans mondains et de réclames financières. Quel serait aujourd’hui le journal assez riche pour permettre à ses rédacteurs des opinions personnelles, et quelle autorité ces opinions obtiendraient-elles prés de lecteurs demandant seulement à être renseignés ou amusés et qui, derrière chaque recommandation, entrevoient toujours le spéculateur ? La critique n’a même plus le pouvoir de lancer un livre ou une pièce de théâtre. Elle peut nuire mais non servir. Les journaux ont tellement conscience de l’inutilité de toute opinion personnelle, qu’ils ont généralement supprimé les critiques littéraires, se bornant à donner le titre du livre avec deux ou trois lignes de réclame, et dans vingt ans, il en sera probablement de même pour la critique théâtrale.
Epier l’opinion est devenue aujourd’hui la préoccupation essentielle de la presse et des gouvernements. Quel effet produira tel événement, tel projet législatif, tel discours, voilà ce qu’il faut savoir. Ce n’est pas facile car rien n’est plus mobile et plus changeant que la pensée des foules. On les voit accueillir avec des anathèmes ce qu’elles avaient acclamé la veille. »
Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
21/12/2011
Nous autres français
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« "Nous autres français, par exemple, nous sommes Romains par la langue, Grecs par la civilisation, Juifs par la religion" écrit Renan dans "l'islam et la science". Soit. Et si cet assemblage était un miracle civilisationnel auquel rien ne pouvait s'ajouter sans le faire déchoir. »
Richard Millet, Fatigue du sens

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
20/12/2011
Les femmes, ce sexe dur et froid
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« C’est Véronique qui m’a prêté ces Lettres à Casanova, et c’est également elle qui m’a apporté hier, à la piscine, le fragment d’un livre sur le maréchal de Richelieu paru en 1791, Véritable vie privée du maréchal de Richelieu, une plaquette parue au Mercure de France en 2004 et que j’ai commencé à lire ce matin.
L’auteur, anonyme, écrit à propos d’une maîtresse du duc de Richelieu : "Son amant alors était tout pour elle ; le mari qu’elle avait tant aimé avait perdu les charmes qui l’embellissaient, le temps de la séduction était passé, et l’on sait qu’il ne peut revenir." Cette observation sur la manière dont, chez une femme, s’évanouit le désir est très fine, très juste. J’ai dès ma jeunesse été frappé par ce refroidissement sans remède qui fait qu’une femme qui, quelques semaines auparavant, se livrait dans mes bras aux plus voluptueuses folies refuse après la rupture de m’accorder ne fut-ce qu’un baiser. J’ai décrit cela dans Ivre du vin perdu, et je l’ai expérimenté des dizaines de fois. C’est une disposition spécifiquement féminine. Un homme, lui, n’agit pas de la sorte : revoyant une ex-maîtresse, même s’il ne l’aime plus, même s’il l’a oubliée, il peut, si cette femme est encore belle, éprouver pour elle une bouffée de désir, avoir envie de recoucher, ne serait-ce qu’une foi, avec elle.
Nous sommes faibles et tendres, prompts à nous enflammer, nous les hommes.
Les femmes, ce sexe dur et froid. »
Gabriel Matzneff, Carnets noirs

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
17/12/2011
Novlangue
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Quelques-uns des mots B avaient de fines subtilités de sens à peine intelligibles à ceux qui n’étaient pas familiarisés avec l’ensemble de la langue. Considérons, par exemple, cette phrase typique d’un article de fond du Times : Ancipenseur nesentventre Angsoc. La traduction la plus courte que l’on puisse donner de cette phrase en ancilangue est : "Ceux dont les idées furent formées avant la Révolution ne peuvent avoir une compréhension pleinement sentie des principes du Socialisme anglais."
Mais cela n’est pas une traduction exacte. Pour commencer, pour saisir dans son entier le sens de la phrase novlangue citée plus haut, il fallait avoir une idée claire de ce que signifiait angsoc. De plus, seule une personne possédant à fond l’angsoc pouvait apprécier toute la force du mot : sentventre (sentir par les entrailles) qui impliquait une acceptation aveugle, enthousiaste, difficile à imaginer aujourd’hui ; ou du mot ancipensée (pensée ancienne), qui était inextricablement mêlé à l’idée de perversité et de décadence.
Mais la fonction spéciale de certains mots novlangue comme ancipensée, n’était pas tellement d’exprimer des idées que d’en détruire. On avait étendu le sens de ces mots, nécessairement peu nombreux, jusqu’à ce qu’ils embrassent des séries entières de mots qui, leur sens étant suffisamment rendu par un seul terme compréhensible, pouvaient alors être effacés et oubliés. La plus grande difficulté à laquelle eurent à faire face les compilateurs du dictionnaire novlangue, ne fut pas d’inventer des mots nouveaux mais, les ayant inventés, de bien s’assurer de leur sens, c’est-à-dire de chercher quelles séries de mots ils supprimaient par leur existence.
Comme nous l’avons vu pour le mot libre, des mots qui avaient un sens hérétique étaient parfois conservés pour la commodité qu’ils présentaient, mais ils étaient épurés de toute signification indésirable.
D’innombrables mots comme : honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion, avaient simplement cessé d’exister. Quelques mots-couvertures les englobaient et, en les englobant, les supprimaient.
Ainsi tous les mots groupés autour des concepts de liberté et d’égalité étaient contenus dans le seul mot penséecrime, tandis que tous les mots groupés autour des concepts d’objectivité et de rationalisme étaient contenus dans le seul mot ancipensée. Une plus grande précision était dangereuse. Ce qu’on demandait aux membres du Parti, c’était une vue analogue à celle des anciens Hébreux qui savaient – et ne savaient pas grand-chose d’autre – que toutes les nations autres que la leur adoraient de "faux dieux". Ils n’avaient pas besoin de savoir que ces dieux s’appelaient Baal, Osiris, Moloch, Ashtaroh et ainsi de suite... Moins ils les connaissaient, mieux cela valait pour leur orthodoxie. Ils connaissaient Jéhovah et les commandements de Jéhovah. Ils savaient, par conséquent, que tous les dieux qui avaient d’autres noms et d’autres attributs étaient de faux dieux.
En quelque sorte de la même façon, les membres du Parti savaient ce qui constituait une bonne conduite et, en des termes excessivement vagues et généraux, ils savaient quelles sortes d’écarts étaient possibles. Leur vie sexuelle, par exemple, était minutieusement réglée par les deux mots novlangue : crimesex (immoralité sexuelle) et biensex (chasteté).
Il n’y avait pas de mot, dans le vocabulaire B, qui fût idéologiquement neutre. Un grand nombre d’entre eux étaient des euphémismes. Des mots comme, par exemple : joiecamp (camp de travaux forcés) ou minipax (ministère de la Paix, c’est-à-dire ministère de la Guerre) signifiaient exactement le contraire de ce qu’ils paraissaient vouloir dire.
Il était rarement possible en novlangue de suivre une pensée non orthodoxe plus loin que la perception qu’elle était non orthodoxe. Au-delà de ce point, les mots n’existaient pas.
Le fait que le choix des mots fût très restreint y aidait aussi. Comparé au nôtre, le vocabulaire novlangue était minuscule. On imaginait constamment de nouveaux moyens de le réduire. Il différait, en vérité, de presque tous les autres en ceci qu’il s’appauvrissait chaque année au lieu de s’enrichir. Chaque réduction était un gain puisque, moins le choix est étendu, moindre est la tentation de réfléchir.
Prenons comme exemple un passage bien connu de la Déclaration de l’Indépendance :
"Nous tenons pour naturellement évidentes les vérités suivantes : Tous les hommes naissent égaux. Ils reçoivent du Créateur certains droits inaliénables, parmi lesquels sont le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la recherche du bonheur. Pour préserver ces droits, des gouvernements sont constitués qui tiennent leur pouvoir du consentement des gouvernés. Lorsqu’une forme de gouvernement s’oppose à ces fins, le peuple a le droit de changer ce gouvernement ou de l’abolir et d’en instituer un nouveau."
Il aurait été absolument impossible de rendre ce passage en novlangue tout en conservant le sens originel. Pour arriver aussi près que possible de ce sens, il faudrait embrasser tout le passage d’un seul mot : crimepensée. »
George Orwell, Appendice à 1984, Les principes du Novlangue

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
16/12/2011
Je ne pus résister à la tentation de lui glisser ma main entre les jambes
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Quand Fillmore revint avec sa négresse, elle avait les yeux de braise. Je compris à la façon dont Fillmore la regardait qu’elle avait dû en mettre un sacré coup, et je commençais à me sentir en appétit moi aussi. Fillmore dût se rendre compte de mes sentiments, et quelle épreuve ce devait être pour un homme de rester la, rien qu’à regarder tout le temps, car brusquement il tira un billet de cent francs de sa poche et, le faisant claquer sur la table, il dit : « Ecoute, vieux, tu as probablement plus besoin de tirer un coup que nous tous. Prends ça et choisis celle que tu veux ! » Je ne sais pourquoi ce geste me le rendit plus cher que tout ce qu’il avait jamais pu faire pour moi, et il avait fait beaucoup ! J’acceptais l’argent dans l’esprit ou il m’était donné, et je fis promptement signe à la négresse de se préparer pour une autre passe. Cela mit la princesse encore plus en rage que n’importe quoi, sembla-t-il. Elle voulait savoir s’il n’y avait personne dans ce bordel d’assez bon pour nous, hormis la négresse ! Je lui répondis brutalement : « Non » Et c’était vrai –la négresse était la reine du harem. Il suffisait de la regarder pour se mettre à bander. Ses yeux semblaient nager dans le sperme. Elle était saoule de toutes les demandes qu’on lui faisait. Elle ne pouvait plus se tenir droite, du moins me le semblait-il. En montant l’étroit petit escalier tournant derrière elle, je ne pus résister à la tentation de lui glisser ma main entre les jambes : et ainsi, nous continuâmes à monter, elle se retournant pour me regarder avec un sourire joyeux, et tortillant un peu le cul lorsque cela la chatouillait trop fort. »
Henry Miller, Tropique du Cancer
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
15/12/2011
Au combat la bête se fait jour
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« Au combat, qui dépouille l’homme de toute convention comme des loques rapiécées d’un mendiant, la bête se fait jour, monstre mystérieux resurgi des tréfonds de l’âme. Elle jaillit en dévorant geyser de flamme, irrésistible griserie qui enivre les masses, divinité trônant au dessus des armées. Lorsque toute pensée, lorsque tout acte se ramènent à une formule, il faut que les sentiments eux-mêmes régressent et se confondent, se conforment à l’effrayante simplicité du but : anéantir l’adversaire. Il n’en sera pas autrement tant qu’il y aura des hommes.
Les formes extérieures n’entrent pas en ligne de compte. Qu’à l’instant de s’affronter on déploie les griffes et montre les dents, qu’on brandisse des haches grossièrement taillées, qu’on bande des arcs de bois, ou qu’une technique subtile élève la destruction à la hauteur d’un art suprême, toujours arrive l’instant où l’on voit flamboyer, au blanc des yeux de l’adversaire, la rouge ivresse du sang. Toujours la charge haletante, l’approche ultime et désespérée suscite la même somme d’émotions, que le poing brandisse la massue taillée dans le bois où la grenade chargée d’explosif. Et toujours, dans l’arène où l’humanité porte sa cause afin de trancher dans le sang, qu’elle soit étroit défilé entre deux petits peuples montagnards, qu’elle soit le vaste front incurvé des batailles modernes, toute l’atrocité, tous les raffinements accumulés d’épouvante ne peuvent égaler l’horreur dont l’homme est submergé par l’apparition, l’espace de quelques secondes, de sa propre image surgie devant lui, tous les feux de la préhistoire sur son visage grimaçant. Car toute technique n’est que machine, que hasard, le projectile est aveugle et sans volonté ; l’homme, lui, c’est la volonté de tuer qui le pousse à travers les orages d’explosifs, de fer et d’acier, et lorsque deux hommes s’écrasent l’un sur l’autre dans le vertige de la lutte, c’est la collision de deux êtres dont un seul restera debout.
Car ces deux êtres se sont placés l’un l’autre dans une relation première, celle de la lutte pour l’existence dans toute sa nudité. Dans cette lutte, le plus faible va mordre la poussière, tandis que le vainqueur, l’arme raffermie dans ses poings, passe sur le corps qu’il vient d’abattre pour foncer plus avant dans la vie, plus avant dans la lutte. Et la clameur qu’un tel choc mêle à celle de l’ennemi est cri arraché à des cœurs qui voient luire devant eux les confins de l’éternité ; un cri depuis bien longtemps oublié dans le cours paisible de la culture, un cri fait de réminiscence, d’épouvante et de soif de sang. »
Ernst Jünger, La guerre comme expérience intérieure
07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
14/12/2011
De nouveaux Munich
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« Les générations actuelles sont les plus médiocres que la France ait jamais connues. On ne saurait les justifier qu'aux dépens de la France. Je préfère justifier la France à leurs dépens.
(...)
Il m'est indifférent de ne pas me trouver d'accord avec ces générations. Je crains plutôt d'elles de nouveaux Munich, elles ont Munich dans le sang. »
Georges Bernanos, Français, si vous saviez
07:01 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
11/12/2011
On essaie d’en sourire ; on fait le philosophe. On en reste accablé.
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=

« L’effort de l’homme, l’objet où il met son point d’honneur, c’est d’agir à l’encontre de la nature ou de la raison. Le mâle est fait pour les amours courtes et multiples : on lui impose, dans le mariage, un amour unique et constant. L’enfant, naturellement, méprise ses parents et se désintéresse d’eux ; on lui impose de les respecter, de les aimer, de les nourrir, de se sacrifier pour eux s’il le faut, un demi-siècle durant. L’adolescent, dès l’âge de douze ans, ressent l’appel du plaisir ; on ne lui permet aucun moyen d’y répondre avant, mettons, dix-huit ans. La jeune fille doit être devenue femme à un certain âge : si elle y pourvoit sans la mairie, on la montre du doigt. L’homosexualité est la nature même : on la fait passer pour vice ou maladie ; elle mène à la prison, au bûcher.
Ce ne sont là que quelques exemples. Ajoutez les religions, toutes fondées sur la contre-nature et la contre-raison. Ajoutez les idéologies politiques et sociales, deux fois sur trois insanes, toujours grosses de catastrophes, le bon sens se vengeant d’avoir été outragé trop longtemps. Quoi d’étonnant si, dans ces conditions, l’humanité ne cesse de souffrir ? On naît sous cette cloche de superstitions et d’idées fausses, on y grandit, on y continue ; on se dit qu’on y mourra, que, pas un seul jour de sa vie, on n’aura vécu autrement que gouverné par des idées d’imbéciles et des mœurs de sauvages, enfreintes ou seulement dénoncées non sans risques. On y jette ses enfants, sans défenses, ou avec des défenses aussi dangereuses pour eux que le mal même. On se dit que cela a toujours été ainsi, que cela sera toujours ainsi, sur toute la surface de la terre. On essaie d’en sourire ; on fait le philosophe. On en reste accablé. »
Henry de Montherlant, Carnets. 1930-1944. 1957

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
10/12/2011
Il ne peut rien omettre
=--=Publié dans la Catégorie "Lectures"=--=
« [le poète] connaît seulement des phénomènes qui surgissent devant lui et dont il souffre tout en tirant son bonheur de cette souffrance. Il voit et sent. Sa perception du réel a l’accent du sentiment, son sentiment a la clairvoyance de la perception du réel. Il ne peut rien omettre. A aucun être, aucune chose, aucun fantôme, aucun spectre enfanté par l’esprit humain, il ne doit fermer les yeux. On dirait que ses yeux n’ont pas de paupières. Aucune pensée qui l’assiège, il ne doit la chasser comme si elle appartenait à l’ordre des choses. Car, dans son ordre des choses, toute chose doit s’ajuster. En lui tout doit et veut se réunir. C’est lui qui noue en lui les éléments du temps. C’est en lui qu’est le présent, ou il n’est nulle part. »
Hugo von Hofmannsthal, Le poète et l’époque présente

07:00 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook